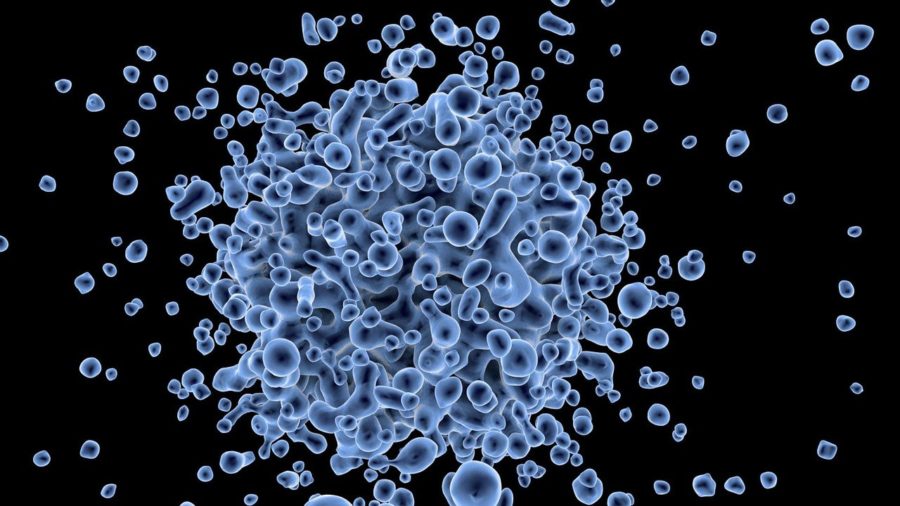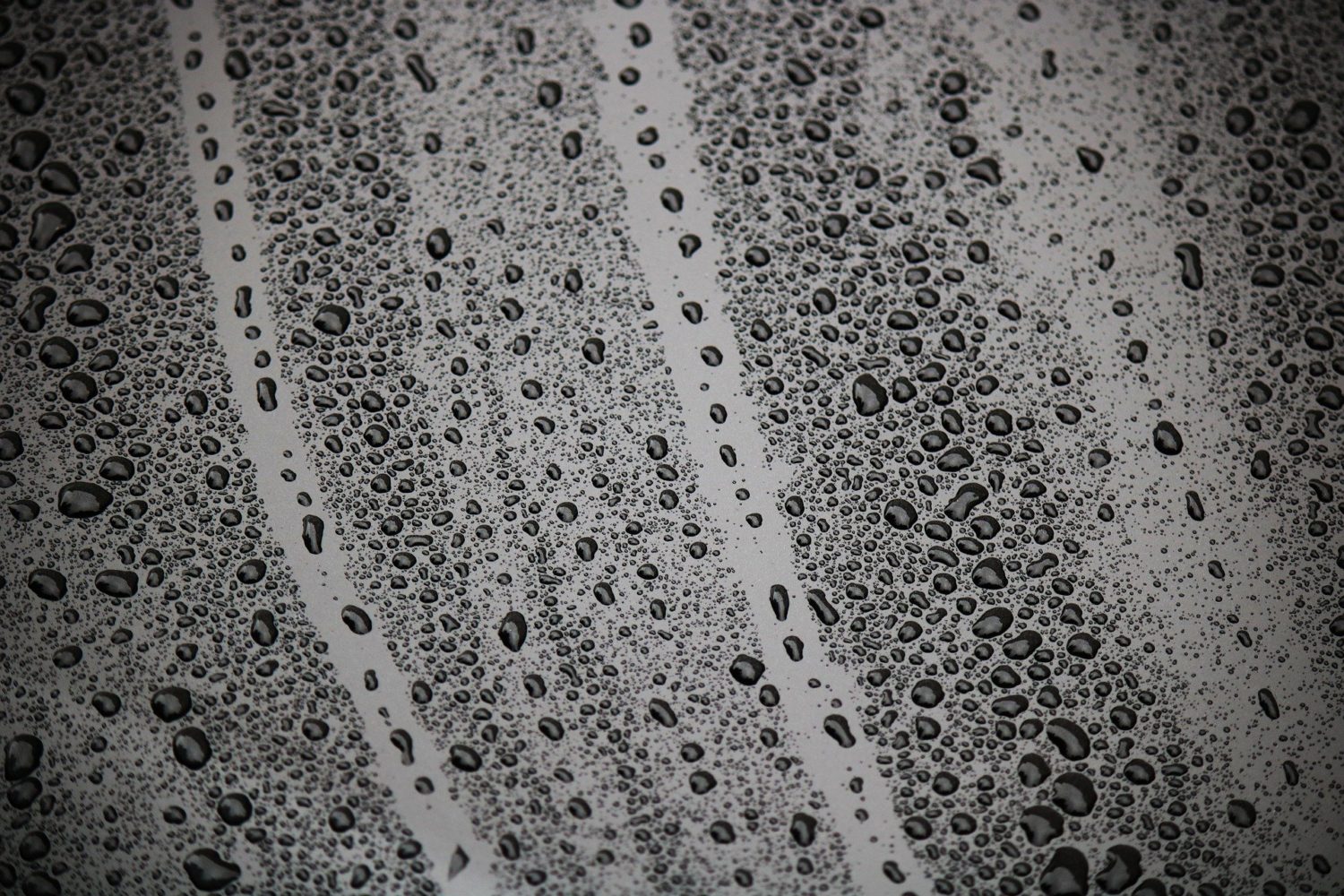Théagène, sur notre droite, est effondré. Son moral est vraiment au plus bas. Il entre, bouscule, s’effondre en soufflant. La porte claque, le fauteuil branle. Il nous parle de l’évolution récente de cette épidémie qui ravage la cité tout entière. « Tout est perdu » clame-t-il. « Nous sommes vaincus, nous sommes à terre. C’en est fait de l’humanité tout entière ».
Auteur/autrice : Hervé Hulin

Cet homme depuis toujours est plutôt laid, de petite taille, la silhouette tordue et sans esprit ; il n’a pas de notoriété, n’est pas visible sur les réseaux sociaux, ne passe jamais à la télé, et sa personne a peu à offrir. C’est là tout ce qu’on dit de lui. Le destin, toujours à ses mystères, tourne soudain et le voici à la tête d’un capital de douze millions, et propriétaire d’une vaste étendue foncière. (suite…)

Eleanor Catton est néozélandaise et née en 1985. Les Luminaires est son second roman, publié en 2011. Il a obtenu le prestigieux Booker Prize, ce qui, pour une si jeune personne, on en conviendra facilement, est un coup de maître. Elle a d’ailleurs dès ses premières publications, moissonné des prix littéraires à tour de bras.

Arthénice est active pour sa cause. Elle y est très engagée, et ne passe pas une journée sans y avoir fait don de plusieurs heures ; elle voue son énergie, son temps, sa jeunesse à cette action. Puisqu’Arthénice est une militante. Elle agit pour changer bien des injustices, et ne ménage pas sa peine à cet effet. Pour quelle cause est-elle donc aussi dévouée ? (suite…)
I. Extase marine.
II. Paris, la nuit.
III. Fœtus.
IV. Joe Africanus.
V. Trêve.
VI. Prière à la Lune.

I. Extase marine
Le long sillon d’écume arasant les rochers,
Mugit et claque comme un suaire blanchâtre
Jaspé de veinules, sous un soleil saumâtre,
Et l’eau de ce marbre est celui des mausolées.

Nycandre connaît tout sur tout, et, grâce à ce talent rare, connaît la réponse à tous vos problèmes. Il sait donner un avis éclairé sitôt qu’il devine un doute chez ses amis, ses proches, ou ses collègues. Il pourrait même dire qu’il aime ça, voire, soutient-il parfois, ne fait qu’assurer une vocation que son naturel lui a donné. Il vous dira ce qu’il faut, ce qui se doit, à la rigueur, ce qui convient. L’inconnu des situations se limite avec naturel à la portée de son horizon. (suite…)

De tant de beaux matins discrète donatrice
Notre Lune a sombré sous le coup de midi
Mais n’a pas attendu sommeillant aux aguets
Le retour du solstice
Son reflet trois-couleurs si vite évaporé
Laisse une ultime parhélie
Trembler sous le deuil attendri
Lune abolie Que reste -t-il de sa rosée ?
Une douce lueur à l’étoffe embuée
(suite…)
Nos contemporains se sont lassés de l’amour, de la tension délicate du désir, de ses secrets, de la pudeur des corps, des jeux étranges de la séduction, ils ont inventé la pornographie. Ils se sont fatigués de l’intelligence que la nature leur avait confiée, du goût de chercher dans les énigmes, de dépasser les inconnues d’une situation dans toutes ses équations, de rapprocher les causes et les effets, de l’effort d’un esprit qui se mobilise et travaille vers toutes sortes de vérité, ont fini par préférer au goût toujours nouveau d’être instruit, le seul principe d’être informé ; alors ils ont inventé internet. Ils se sont écœurés de la démocratie, de ses institutions, de la passion des idées ou du compromis, et des travaux des lois et de la citoyenneté; alors ils ont inventé les réseaux sociaux. Qu’inventeront-ils sitôt qu’ils se seront lassés de l’humanité ?
©hervehulin2022

Une vie très heureuse ne le sera jamais absolument, car en chacune des circonstances qui éclairent sa chance, elle restera voilée de la crainte de se perdre et soumise aux caprices de la fortune ; une vie malheureuse, malgré tout l’accablement et la peine de ses trop longues années, ne le sera jamais absolument, car elle ne pourra craindre la ruine de sa situation, et palpitera éternellement dans l’espérance d’une infime lueur, qui pourrait en soulever la pénombre. De sorte que l’homme ne connaîtra jamais ni le bonheur ni le malheur, et voilà tout ce qui en fait la fragilité mystérieuse.
©hervehulin2022
Virgile est mort un soir de septembre 19 avant JC, probablement de la malaria. Il se dit depuis deux millénaires qu’il aurait voulu détruire avant de mourir le manuscrit de « l’Énéide ». Rien ne le prouve, mais cette intention prêtée donne à ce chef d’œuvre parmi les chefs d’œuvre, une aura de miraculée qui en éclipse le caractère inachevé. (suite…)

La houle blonde des lavandes
Évolue en sinuosité
Dans un soleil criard
Le silence est capté
La terre alors change de ton
Et son tour redevient rond
Des pierres antiques contemplent
Cette équidistance bleutée
L’abbaye reste assoupie dans sa masse
Le chat va dormir
Mais ne cesse de sourire en dormant (suite…)
 Fukunaga Takehiko (1918-1979), a étudié la littérature française et traduit des œuvres de Sartre et Baudelaire. Il est l’auteur d’une étude sur Gauguin. Imprégné de littérature occidentale, il appartient à ce cercle d’écrivains japonais d’après-guerre qui s’est nourri dans la tradition et la mémoire du japon, mais aussi dans les lettres françaises. Nakamura, Ooka, traducteurs de Stendhal, Proust, Nerval, Green… Attentif à la modernité et aux innovations formelles du roman occidental du XXe siècle, son œuvre est d’une écriture à dominante très émotionnelle, et a pour centre de gravité l’amour et la solitude. On appréciera dans sa narration une mélancolie créative, qui élève les interactions affectives entre ses personnages.
Fukunaga Takehiko (1918-1979), a étudié la littérature française et traduit des œuvres de Sartre et Baudelaire. Il est l’auteur d’une étude sur Gauguin. Imprégné de littérature occidentale, il appartient à ce cercle d’écrivains japonais d’après-guerre qui s’est nourri dans la tradition et la mémoire du japon, mais aussi dans les lettres françaises. Nakamura, Ooka, traducteurs de Stendhal, Proust, Nerval, Green… Attentif à la modernité et aux innovations formelles du roman occidental du XXe siècle, son œuvre est d’une écriture à dominante très émotionnelle, et a pour centre de gravité l’amour et la solitude. On appréciera dans sa narration une mélancolie créative, qui élève les interactions affectives entre ses personnages.

Aristippe est haut placé dans les affaires publiques, grâce à son énergie, son ambition, et son travail. Cette position méritée est à présent le juste reflet de son autorité. Celle-ci rayonne dans un vaste bâtiment, pourvus de bureaux, d’annexes et d’offices, reliés d’immenses couloirs nourris de cours et d’alcôves. Aristippe trône au sommet, dans un vaste bureau, au dernier étage avec terrasse. De là, des jours entiers, et parfois, une partie des nuits, il travaille, décide, délègue, planifie et arbitre. Pour accomplir sa mission, il a autorité sur quatre sous directeurs, quatre chargés de missions, trois secrétaires et un chef de cabinet (suite…)

Sous le silence de l’obscur
Lève le frisson des chandelles
Pas à pas
Tel un soupçon qui devient sûr
A force d’écho infidèle
Jette au jour un ultime appât
Regret des anciennes tutelles
La nuit qui va ne revient pas
Déjà faiblit la voix du pâtre
(Onde orangée de la distance) (suite…)

Zachary Mason est informaticien. C’est un as de la Silicon Valley. Il a plutôt nagé dans la science-fiction jusqu’à ce jour (The void star) mais a récemment ajouté à sa (encore maigre) bibliographie un ouvrage de SF qui variationne sur les Métamorphoses d’Ovide (Metamorphica). A vrai dire, son nom évoque peu; c’est un patronyme anglo-saxon d’ailleurs assez courant ; rien à voir avec l’acteur génial de Lolita (James) ou le batteur légendaire de Pink Floyd (Nick). (suite…)
Echelle conoscopique: 7/10.
La culture a pour vocation naturelle de rapprocher les composantes du genre humain. En cela, les arts plastique, la musique, la philosophie et bien d’autres belles choses encore, sont le langage commun de l’humanité. Toujours mus par la passion, les grandes choses de l’esprit se jouent des mots pour aller droit au cœur, et de là, gagner l’intelligence commune des peuples. Encore faut-il que les tenants sachent causer correctement, ou tout simplement, gardent en tête le souci de parler pour se faire comprendre. Hélas, trois fois hélas, on n’y est pas. (suite…)

Hégesippe depuis toujours est quelqu’un de plaisant. On ne l’a vu pas autrement que d’humeur égale entoute circonstance. C’est l’effet Hégesippe, comme disent ses amis, qu’il a nombreux. Il y a quelque chose de délicat, de fragile en lui, qui le fait si séduisant.Il est très cultivé, et peut converser sans apprêt de la meilleure interprétation de la Sixième de Mahler, de la poésie japonaise ou de celle de Properce, des portraits de Van Dyck ; et quand il vous parle de Proust, il en fait presqu’une gourmandise. Un vrai puit d’humanités, on pourrait passer des heures à échanger des points de vue de toutes sortes de couleurs, on en revient enrichi.
De fragile, vraiment ; car il est de cette partie du genre humain qui ne sait pas dire non. C’est un conflit qui le dévaste, chaque fois qu’il doit opposer sa volonté à celle d’autrui ; refuser n’est pas dans sa matière, il en est ainsi. Alors il simule de se laisser convaincre, et d’être toujours d’accord. Il avance sans volonté propre. Il vit sans choisir ni décider et voilà tout. Il se laisse porter, par la brise, toujours selon le même sens.
Enfant, il avait le sourire facile et montrait une grande douceur en toute situation. Ses parents, son entourage était toujours charmé de son imagination, de ses dessins, de son langage. Plus tard, à l’adolescence, on l’a vu devenir drôle, et cet humour circonstancié est alors devenu son point fort. Il faisait rire avec finesse, et beaucoup d’à-propos. Il écrivait des poèmes, en secret, qui n’ont jamais été lus. Dans ses années de jeunesse puis de première maturité, pendant ses études de droit, au début de sa carrière administrative, Hégesippe s’était ainsi laissé guider, et ce fut avec fruit. Il s’abandonna aux lumières flottantes que la vie allumait devant lui, loin devant, jusqu’où peut porter son regard, et il sut leur faire confiance. S’il a fait du droit, c’est parce que sa mère lui a conseillé cette voie : son fils avait bien du mal à s’en tracer une, de voie. Il aurait secrètement bien aimé faire autre chose, voyager, écrire et enseigner la littérature, par exemple. Mais il ne l’a jamais dit. Il n’a pas osé.
Il cachait avec habileté, dès cet âge, une réelle timidité. Il était toujours plus à l’aise avec les adultes qu’avec les jeunes gens de son âge ; qu’avec les jeunes filles surtout, dont il craignait le rire en staccato. L’une d’entre elles a imprimé un souvenir qui ne l’a jamais quitté ; il ne lui aura d’ailleurs jamais adressé la parole.
Cette timidité qu’il a gardée, le nourrit pourtant autant qu’elle l’accompagne ; elle lui confère au fond de son intimité, comme une couche transparente de tristesse, plutôt de mélancolie. C’est ce fonds un peu ombragé qui a généré cette sensibilité, et cette aptitude à saisir la beauté des choses et des instants. Cette aptitude si appréciée de ses proches et qui fait ce charme doux comme un miel.
Le voici quelques années après, plutôt bien diplômé. En réalité, Hégesippe avait du mal à affronter l’idée même de la vie au travail, dans l’univers que lui ouvraient ses diplômes. Mais il a bien fallu s’engager et passer des concours. C’était la pente naturelle après le droit. Il fut reçu très bien classé, une nouvelle étape de sa vie a commencé. Il y trouva rapidement une grande satisfaction de société. Lui, le solitaire, fit la connaissance de nombreux collègues, dont beaucoup devinrent des amis fidèles. Son empathie naturelle n’avait aucune difficulté à capter leurs sentiments.
Il est ainsi, Hégesippe. On le pousse et il avance. Il attend le vent. On l’appelle et il y va. Des portes s‘ouvrent, il entre. Sa carrière marcha de ce pas sans discontinuer. Il progressa en silence, comme une voile lointaine glisse vers l’horizon grâce à un courant invisible, mais avec cette mobilité droite que traduit une inertie électrique.
Cette carrière pourtant tout à fait honorable, ne l’intéressa pas beaucoup. Pas plus qu’au -dessus de la ligne de flottaison. Bien sûr il aimait les contacts et la vie de société, la reconnaissance aussi qui lui était montrée. Souvent, il pensait à cette œuvre de littérature qu’il caressait dans ses envies, et qui ne voit toujours pas le jour comme passent les années. Il fit un agréable mariage, quand une jeune femme à qui il plaisait bien, l’entrepris au plus près ; certes, ce n’était pas l’âme idéale dont il rêvait, il préférait intimement les brunes et elle ne l’était pas. Mais il y eut beaucoup de tendresse toute sa vie grâce à cette acceptation du cœur. Et ils eurent des enfants merveilleux. Trois, comme elle le souhaitait. Là, ce fut un bonheur.
Il ne combat jamais, mais toujours il accepte. C’est une manière de vivre sans affronter la dure réalité d’un choix. Plus le temps passe, plus il convient de se protéger, se dit-il. De toutes ces choses qui coûtent, ces secousses des autres, ces petites guerres du voisinage. Et ce tumulte du monde qui vous saoule et vous épuise. Dans le silence des nuits blanches, il songe à des vies parallèles, celles qu’il aurait pu avoir. On remarque bien, derrière son humour, et son immense culture si bien partagée, un niveau d’expression, une sorte de culte des mots, peu communs.
Les années ont passé. La vieillesse est arrivée. A présent seul dans sa vie longiligne, il a bien remarqué que les mots lui viennent moins bien, et que les souvenirs tremblent, puis s’effacent. Il s’habitue à cet état programmé des choses. Un jour, alors qu’il est procédé à la vente de sa maison, et au déménagement des foules d’objet qui occupent cet espace familier, alors qu’il est l’heure de la maison de retraite, il retrouve un poème qu’il avait composé à l’âge de vingt ans. Il le lit. Et là, il manque de chavirer. La feuille lui tombe des mains. C’est un vertige aveuglant qui l’assaille. Ce petit texte est d’une immense beauté, sculpté par un talent scintillant, d’autant plus que refoulé. Là était la vérité d’Hégesippe, et il s’est trompé; à toujours vouloir se protéger dans le sens du vent, il n’a pas saisi la beauté du contre-courant.
©hervehulin2021

I
L’éclaircie passe sur le lieu
Âme humide sans pavillon
Et ce faisant dévoile un feu
Blanc qui attire/ déterre
Sous la symphonie des racines
L’œil ancestral du ténébreux
(C’est un chant qui s’efface)
Question de convergence (suite…)

Mettez cinq français ensemble, hommes ou femmes, vieux et jeunes mêlés, pas plus qu’il ne suffit, rassemblez les dans un souper chez l’un deux, une soirée dans un restaurant, un barbecue à la campagne. Qu’ils soient des amis depuis longtemps, qui se connaissent bien les uns avec les autres. Jetez-leur un sujet de politique, faites-les parler du gouvernement du moment, de ses lois, ses actions. (suite…)

Qui connaît Nnedi Okorafor, à part sans doute certains passionnés de science-fiction ? J’avoue que ce n’était pas mon cas il y a encore quelques semaines. Okorafor est de nationalité américaine mais originaire du Nigéria, terre où les auteurs de talent poussent comme des champignons ; elle est donc africaine absolument. Et c’est un écrivain fantastique, aux deux sens du terme car dans un univers personnel sans égal, elle écrit fantastiquement bien, des œuvres de genre fantastique (fantasy, ou science-fiction, laissons la typologie au vrais amateurs) qui puisent dans l’imaginaire africain et en expriment le suc si rare avec ferveur. D’aucuns appellent cela l”Afrofuturisme”; ça convient bien… (suite…)

Regardez sur l’horizon, derrière l’étendue des champs et le liseré des bois, la silhouette compacte de ce village ; le calme robuste qu’exhalent ses toitures anciennes, la ligne des murs empierrés de grès ancien, et surtout ce clocher élancé sur le bleuté du ciel, incarnent l’image de la douceur de vivre. L’esprit navigue un peu et, sans effort, se représente les rues heureuses, l’école radieuse dans le bruit des enfants qui courent, l’odeur merveilleuse du pain vers la devanture de la boulangerie à l’ancienne. Sur la gauche, un petit bâtiment est délabré, le carreau semble brisé, peut-être est-il vide ou l’aura-t-on abandonné. Par devant, la verdure tavelée de boutons d’or, car c’est l’été. (suite…)

I
Je parvenais peu à peu, à peine essoufflé mais satisfait, au sommet de la falaise, comme la nuit finissante était très claire. Une ligne de bruyère devant moi me découvrit la mer : je voyais le grand large déployer au regard son tracé pensif sous le ciel pâle. Là-bas, les flots s’en détachaient par meutes successives, striées de lune pour se ruer débridés à travers l’espace sans autre loi que leur mouvement nodal vers la côte, avant d’éclater quelque part, avec un souffle bestial, sur des récifs encore invisibles pour moi.
J’écoutais battre ce cœur insatiable, percussion d’une bouillonnante écume toujours pressée par l’inépuisable suspension des houles. Sur cette étendue incertaine, tourmentée de sa splendeur féroce avec la hargne d’un monde rebelle, l’obscurité suggérait çà et là des essaims de lueur, comme la proximité d’un éveil. (suite…)

Philémon aime rire. Réellement, il est drôle, d’humeur constante et fait montre de beaucoup d’esprit. Il rit et fait rire tout le temps, tout le monde, de tout, de tous, et sur tout. Il rit parfois tout seul, et parfois même sans cause ni sujet. Il est connu par cela, et fier de sa notoriété. Son visage est jovial mais flatteur. Son apparence soignée, mais sans apprêt. Mais son mental est toujours rapide et cela plaît. On loue chez lui cette faculté et il le sait. (suite…)

Sawako Ariyoshi (1931-1984) est une personnalité à part dans la littérature japonaise du XX e siècle : c’est une femme. Une femme écrivain, qui écrit principalement sur les femmes dans ses romans. Ceci est assez rare pour son époque. Malgré quelques grands noms (Fumiko Ayashi, les inoubliables « Nuages flottants ») il faudra bien attendre un tournant plus récent – disons fin XXe et XXIe siècle – pour que les femmes prennent une place plus importante dans le roman japonais. Le bandeau qui traverse la couverture du livre proclame en blanc sur fond rouge « La Simone de Beauvoir du Japon » …

D’Athénaïs, nul ne peut contester la réussite professionnelle ; c’est une femme puissante. Sa position en hauteur est méritée. Elle exerce des fonctions d’autorité dans ce monde d’homme et elle a su faire sa place à force de talent, de volonté, et de résolution, dans le monde des influents. En quelques bons souples et puissants. Elle sait ce qu’elle veut, et cela suffit à faire la valeur de sa notoriété. Elle dirige son organisation avec un jugement ferme, et une réelle vision des choses. Son autorité s’étend sur des services et des unités innombrables ; partout, des hommes et des femmes travaillent avec ferveur sous sa seule référence. « Athénaïs souhaite » … « Athénaïs a décidé » … « Athénaïs envisage » et aussi, « une fois de plus, Athénaïs a eu raison de faire, de refuser, d’engager » … On loue sa pertinence, et sa décision. On entre dans son vaste bureau du dernier étage, avec de l’appréhension, mais aussi un frisson d’adoration. (suite…)

Le lierre sombre où mille fois
Perle un soleil chancelant
Murmure de blonds mots d’amour
Aux pierres vieilles et sans voix
Parmi les feuillages changeants
Qu’enrichissent les bras du jour
Et dans la douceur du granit
Oublié sous son joug de secret
Plus tendre et lointain qu’un zénith
Chantonne le souffle sacré
De l’eau esseulée qui palpite
Sa flûte roule et s’éparpille
Nue la fraicheur se découvre
Sous l’angle où les astres fourmillent
Un infime arc en ciel s’entrouvre
Dans le tempo d’un andante
Sous l’émeraude carminée
Se blottit la goutte tremblante
Rosies des chairs de la rosée
Et mille fois recommencée
Avec la discrétion frappante
D’une vie qui serait terminée.
©hervehulin
Echelle conoscopique: 9/10.
Attention, le contenu des propos tenus qui suivent est authentique. Ce n’est pas un caractère, ce n’est pas une fable outrancière, ni un paradigme, ni un apologue pour amuser la galerie des gens qui sont persuadés d’échapper au Conoscope.
Mais c’est bien un cas de conoscopie absolu. Savourons…
Le jeudi 25 février. La cafétéria des personnels de la Ville de Paris. Trois fonctionnaires – peut-être même des retraités – commentent l’actualité. La voix est forte, le propos porte sur toute l’assistance (c’est l’heure du déjeuner).
Premier fonctionnaire :
« Macron, en ce moment, il fait ce qu’il veut »
Second fonctionnaire :
« On nous balance ce qu’on veut sur tout ça…* De toute façon, il n’y a aucun moyen de savoir ce qui est vrai. Ils nous disent ce qu’ils veulent… »
Premier fonctionnaire :
« Macron, il fait ce qu’il veut, je te dis. Le Sénat et le Parlement (sic) ils servent à rien. Ils décident de rien. Que veux-tu qu’ils fassent ? Macron, c’est lui qui décide tout seul, il fait ce qu’il veut. Alors là… ».
Troisième fonctionnaire :
« Moi je dis que le gouvernement, il est en train de liquider tous les vieux avec ses vaccins. Et hop ! Comme il n’y a plus de sous pour les retraites, c’est en super déficit, et voilà, on a quatre-vingt mille morts dans les EPAHD. Il est en train de régler le problème comme ça, le gouvernement. C’est uniquement pour ça qu’il a fait vacciner tout de suite tous les vieux en priorité, qu’est-ce que tu crois ? »
Second fonctionnaire:
” C’est sûr que leurs vaccins, on sait pas ce qu’ils ont mis dedans”…
Voilà, merveilleux échange… Au cœur de l’exégèse du siècle. C’est vrai, c’est frais, c’est français. Ce n’est pas de la littérature. Ou plutôt, oui, c’est de la littérature. Ou pas, comme il plaira.
*la pandémie, le covid, les vaccins, bien sûr….
©hervehulin2021

Narcisse se lève tôt le matin avec comme grand dessein de se coucher tôt le soir. Il garde une heure précise pour sa toilette, toujours la même. Il mène l’affaire comme un rituel, selon un ordonnancement des parties du corps qui ne changera qu’à sa mort. (suite…)

Il est plutôt bon qu’un responsable des affaires publiques, en charge de l’exercice de l’État, écrive un livre. Un livre qui qui ne soit pas de politique. Qu’il se passionne pour les lettres, et ici, la poésie en particulier. Beaucoup auront tendance à aborder cette somme avec des pincettes. Son auteur est ce qu’on désigne en France sous le curieux vocable « homme politique » ce qui dans notre pays, signifie à peine moins que criminel. (suite…)

Memnon vient de débarquer du Sud. Il est brûlé par le soleil et la mer. Son corps est fatigué mais il saura aller au-devant de sa fortune. Son cœur fut endurci par les épreuves du voyage, et sa résolution. Sa victoire sur la mer et ses formidables distances, a décuplé son courage. Le voici face aux murs des puissants. Il est prêt à exiger sa place dans ce monde qui ne l’attend pas. Il se rend en premier à la capitainerie du port, qui ne l’entend pas. (suite…)

Voilà un homme célèbre, et vous vous dites que cet homme est décidément célèbre ; mais d’où vient qu’il vous semble aussi connu ? Où donc l’avez-vous vu, pour que ses traits vous soient si fameux ? Est-ce au travail, dans votre quartier, à la conférence des parents d’élèves ? L’assemblée de copropriétaires peut-être ? Le conseil du quartier, sans doute ? Sur quels réseaux, sur quelle chaîne, pour qu’il dépasse à ce point sur l’horizon ? (suite…)

Acis est, en toute circonstance, préoccupé de son apparence. Celle-ci sera toujours et sans concession. S’il neige ou s’il fait temps de canicule, mistral ou frimas, la priorité impose de se conformer à la mode, absolument. Il le sait, Acis, ce n’est pas matière à hérésie. Pas plus tard que le dernier hiver, ce fut un dîner un peu coté, et des chaussettes rouges -le temps était gris- furent un mauvais choix, trop hâtif sans doute ; six nuits d’insomnie en auront été le prix. Une autre fois, un moment d’inattention lui aura fait revêtir deux sorties de suite le même paletot à motif pied de poule ; la contrariété fut brutale, et deux jours de fièvre. Rien de ce qu’il montre ne doit avoir été vu ni porté avant lui. C’est bien cela, être fashion dans ce siècle encore jeune.
Il juge d’un seul coup d’œil l’œil des autres. Il a l’usage de scruter leur attention, leur réaction. Il est convaincu de lire comme livre ouvert leur appréciation. Ces gens-là, pense-t-il, ont besoin de connaître l’air du temps. Rien de mieux qu’un assortiment agréable, mais sans précédent connu, pour les contenter. Et, pense-t-il, je suis là pour eux. Ah les heureux !
A chaque moment de sa vie qui le rendra visible aux autres, Acis aura l’esprit très remué. Comment convient-il de faire ? Devancer les attitudes et les usages, mettre son col en rupture des conventions, au risque de s’isoler ? Ou suivre encore une fois le mouvement, au risque d’être figés dans les habitudes des autres ? Il ne s’agit pas de procéder à la légère. On aura examiné la situation avec l’attention d’un cartographe, et balancé les décisions possibles. On vérifie les forces contraires, et les pièges du terrain. Puis, on s’engage, on attend. On repère les risques et les pertes concevables. Enfin, quand il n’est plus temps de douter ni de consulter, on y va, sans retour possible. Le sort est jeté. Ce sera le choix d’une couleur, d’un tissu. Un renoncement ou une envie.
Aujourd’hui, Acis participera à un colloque très en vue, il prendra la parole pour une courte intervention. La pression est grande. Il sait que le fonds de décor derrière la tribune est à dominante outre-mer. Quelle est la cravate qui marquera l’évènement ? Et que faire si la moquette est grise ? Demain, c’est une soirée entre vieux amis ; on l’attend sur ce point, on le plaisante à l’envie, le moque un peu, et on parie avec discrétion sur les atours qu’il aura choisis. On l’aime bien, mais il amuse, c’est un fait. On l’a vu chercher sa voie et changer de religion pour un pli de chemise.
Mais sous le regard des autres, Acis reste une attraction sans égal. L’esprit tout entier tourné sur ses apprêts, surtout sur la difficile décision d’un béret de couleur, il n’a pas consulté le temps qu’il va faire pour sa sortie. Et voilà la pluie qui trempe sa capeline, et dévaste son cachemire, et noie son sac à main, et on rit partout de ses mocassins détrempés. A tant remettre sa destinée sous la loi d’une cravate ou d’un mouchoir, il a oublié de vérifier sous quel ciel mettre son pas.
©hervehulin2021

Si les hommes pouvaient voir le succès de leurs espérances garanties sans aléas ni à-coups du hasard, si le sort leur était toujours favorable par une trame assurée, si les conséquences de leurs projets étaient lisiblement écrites quelque part, ils n’auraient pas besoin de s’interroger sans cesse de l’avenir et ses équations à centaines d’inconnues ; de sorte qu’il n’y aurait dans toute la vie plus de place pour le doute et l’habitude de redouter les crochets de la fortune. Une lanterne éclairerait d’une lumière basse la trace à venir, en captant les feux passés du jour. Et la nature des jours à venir en serait bien assurée, et les hommes heureusement soulagés.
Mais rien de tout cela n’est réalisé comme ils le voudraient, et chaque seconde de leur existence ne sait préjuger des suites que va occasionner la suivante : ainsi, ils inventent toute sorte de travers à la destinée, et ne peuvent qu’imaginer des alternatives à cette désespérante condition qui les opprime, entrouvrant des fenêtres latérales par où brille l’éclat des superstitions et des croyances, pour les soulager de ce cruel balancement entre la peur de la vérité et la crainte de l’erreur. Ils attrapent en aveugles toutes sortes de lueurs et de reflets, qui les affolent et les séduisent tels des alucites à la tombée du jour. La lanterne est restée vide dans les feux du soir. C’est pourquoi les hommes se consument à ce point dans la passion de croire n’importe quoi.
©hervehulin2021

Un homme meurt. Il se retrouve dans l’au-delà, face à la porte des enfers. Celle-ci s’ouvre alors lentement, découvrant un long couloir sombre, chargé de soufre et de fumée. Au bout de celui-ci, une lumière, un petit bureau, très fonctionnel. Un diablotin l’accueille tout sourire.
– « Bienvenue aux enfers, cher monsieur «
– (…)
« Je suis le diable mineur préposé à l’accueil. Je m’occupe des formalités. Laissez-moi vous dire que vous n’avez pas à avoir peur. Ici, tout est dédié à la jouissance du vice et du plaisir, pour l’éternité. Ce n’est pas du tout ce qu’on vous a dit dans votre éducation religieuse, la souffrance, la damnation, tout ça. Bien au contraire. Vous verrez, vous vous plairez ».
« Ah…Vraiment ?… »
« Oui, oui, vous verrez. Et puis les prestations sont de très – mais alors, de très- haute qualité. Le Patron veille au grain sur ce point, rassurez-vous. »
Le nouvel arrivant reste un peu dubitatif.
« Euh…Si vous le dites… »
« Voilà le principe. Chaque jour de la semaine est entièrement consacré à la jouissance totale d’un vice. C’est sans limite, de minuit à minuit. Et puis comme vous êtes à présent libéré de toute forme d’enveloppe corporelle, pas de fatigue, de contre coup, etc. Vous verrez. »
« Je ne voyais pas ça comme ça, il faut bien dire. »
« C’est normal, dit le diable. Tenez, demain c’est mardi. Mardi, c’est gourmandise. Croyez-moi, faut voir ça pour y croire. Les mets les plus délicats raffinés, préparés par les meilleurs chefs étoilés parmi nos hôtes. Sucré, salé, comme vous voulez. On s’empiffre, on déguste. Des vins divins, des alcools de luxe. Si vous voulez bio, pas de problème. Et pas de gueule de bois, de crise de foie évidemment. Croyez-moi, cher monsieur, vous allez aimer les mardis. »
« C’est tentant, » balbutie l’intéressé…
Le diable mineur continue.
« Mercredi, le jeu. Vous êtes joueur ? Peu importe, vous apprécierez. Poker, baccara ou Monopoly, scrabble si vous préférez. Vous pouvez jouer, gagner, perdre des sommes colossales, no limit. Si vous gagnez, vous rejouerez le mercredi suivant. Si vous perdez, la dette s’efface à minuit, et on recommence la semaine suivante. Vous verrez, c’est grisant. Le plaisir de l’addiction, sans morale pour vous enquiquiner… Vous allez voir, vous adorerez les mercredis… »
Le gars commence à être vraiment motivé. Et on sait ce qu’il attend, évidemment.
« On continue le programme. Jeudi, paresse. Tout le temps. La joie de ne rien faire, mais vraiment rien du tout, à chaque seconde. La glandouille totale. Vous pouvez choisir un hamac, sur une plage avec cocotier et brise tiède ; on a aussi des couettes et matelas incroyables. Pour sentir l’oisiveté imprégner chaque pore, chaque seconde, et penser à tous ces imbéciles, à la surface de la terre, qui triment pendant ce temps-là. Ça vaut bien le coup. Croyez-moi, vous allez vraiment aimer les jeudis… »
« Oui, oui, répond l’autre, de plus en plus excité. Ça me plait bien. Et la suite ? »
« Vendredi : luxure. Oui, vous attendiez ça, je sais, comme tout le monde. Du sexe, du sexe, et encore du sexe. Alors-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça y va de partout, tout le monde s’y met, dans tous les sens, et ça n’arrête pas. Tous vos fantasmes accomplis sur simple souhait. Dès que vous avez joui, ça recommence. Des créatures de rêve, vos pornstars favorites, vous vous les faites sans pause. «
-« C’est vrai que c’est drôlement bien ici », répond l’autre, à présent tout enthousiaste.
– « Puisque je vous le dis. Par contre, reprend le diablotin d’accueil, j’aurais une question un peu personnelle à vous poser, pour le bon déroulement du vendredi… Disons, intime… »
– « Oui, je vous écoute, pas de problème. »
-« Alors voilà, cher monsieur. Êtes-vous homosexuel ? »
-« Ah ça non », répond le bonhomme. « Pas du tout ! Rien à voir avec tout ça. J’ai toujours été bon chrétien ».
– « Hmmm… Vous êtes sûr ? «demande le diable mineur « Pas une seule petite tentation de ce genre ? une petite transgression de votre vivant ? »
– « Non, non, et non, je vous dis », déclame l’autre. « Pas de ça chez moi »
– (…)
– « Croyez-moi, ça, c’est pas mon truc ! »
– « Eh bien, mon cher monsieur, lui répond le diablotin préposé, mon cher monsieur, vous n’allez pas aimer les vendredis. »
PS : On peut aussi raconter sur le mode inverse, homo vers l’hétéro ; ça marche aussi…

Comme un cygne à l’envol se détache de l’onde
La nuit d’un seul soupir trace des rives neuves
Les ormes embrumés que la pénombre émonde
Attendent Le voyage en s’effaçant se plisse
Ma barque en silence glisse le long du fleuve
La rive est sombre et mon cœur triste
Je ressasse le soir de crainte qu’il ne meure
J’entends le souffle des rameurs
Tout près des vagues dépliées
Tristesse que l’exil effleure
Je songe à vous qui m’oubliez
La lune en son rayon épouse le profil
Escarpé d’un écueil Que reste –t-il
De la lueur diurne où naviguait le regard
Dans la nuit bleue alentie de brouillard
Quelle est cette douceur profane
L’astre orangé d’un nénuphar
Comme la mémoire est diaphane
Pas de secret Le monde est fait d’étrange choses
L’argent de l’aiguière s’afflige avec les ans
Quand sa liqueur jamais n’en paraît éventée
Comme la biche blanche évanouie dans son sang
La vie la fait dormir Que la neige soit rose
Tout doux mon sang Tout doux Que ton ruisseau chemine
Et porte sa rougeur à celle qui me hante
Là où le vent est vif Là où tout est vivant
Il fait moins froid La nuit devient mauve il semble
C’est l’heure où mon âme fendue s’échappe et tremble
Elle fuit l’ombre qui la dévoile Comme elle
La luciole s’efface auprès de la chandelle
Je ressasse le soir de crainte qu’il ne meure
J’entends le souffle des rameurs
Tout près des vagues oubliées
Mon œil ne voit plus rien que le fanal qui meurt
Douceur que le matin affleure
Je ne vous oublierai jamais
©hervehulin

Alcinte aime être seul. Il n’est pas dénué d’humanité. Mais il n’aime pas la société et la compagnie de ses semblables. Par nature, il les trouve toujours insipides et trop préoccupés de faibles choses ; leur vanité, qu’il décèle à l’œil nu comme à l’infrarouge les insectes nocturnes, lui est difficile et a vite fait de lui passer une sorte de fièvre qui l’emmène ailleurs. S’il est entouré, il peut supporter un instant deux ou trois personnes, mais très vite, il cessera d’être aimable. Un simple attroupement lui communique une sensation de malaise curieux ; une foule, de panique furieuse. Bientôt, il tournera le dos, s’éloignera, claquera la porte s’il y en a une. Il y a quelque chose dans le genre humain qui l’insatisfait et le perturbe en permanence. Vous allez vers lui ce soir pour prendre ses nouvelles, mais il passe là et vous ignore.
Malgré ce mauvais penchant, Alcinte aime aussi qu’on l’estime et l’en gratifie. Il n’a rien de principe contre le genre humain. Il a souvent envie d’aimer les autres, et d’ailleurs, il ne peut s’empêcher de leur vouer de bons sentiments. Il est troublé quand autour de lui, alors que des gens se rassemblent par amitié, il pressent une forme d’harmonie heureuse dans l’air, qui vibre avec douceur ; il aime ça. Il veut alors être leur semblable, fonctionner comme eux. La sympathie lui est une sensation familière, même s’il n’en maîtrise pas l’usage. La civilisation a du bon, il ne faut pas désespérer.
Pourtant, il maintient toujours une farouche distance avec les autres. Alcinte regarde les gens avec une lorgnette inversée. Il les perçoit mieux lorsqu’ils semblent éloignés, tels de minuscules silhouettes ; là, ils les apprécient à leur juste proportion. Qu’ils sont petits, toujours affairés de leur personne, tourmentés de leurs apprêts. Ils ont si peu à se dire, et pourtant, toujours ils parlent ; si peu de temps devant eux, mais toujours à le dépenser en riens de toutes sortes ; si peu à aimer.
Mais Alcinte parfois se sent de la compassion pour ces humains qui sont toujours en peine et incapables de bonheur. Il les regarde, et pense qu’ils ne savent pas vraiment ce qu’ils font. Après-tout, ils sont bien vulnérables, un souffle les met a à terre. Il les trouve touchants. La vue d’un pauvre effaré qui dort dans la rue le rend triste. Son cœur s’étreint sitôt qu’il entend un enfant pleurer.
Ah ! Faire pleurer un enfant, n’est-ce pas la signature d’une âme cruelle ? Il n’accepte pas cette indifférence au sort des autres qui est la marque de tant de ses semblables. Qu’un déluge les emporte, qu’une révolution les accable de ses tourments. Voilà leur meilleur sort.
Il n’entend rien à cette amitié qui les rend si faibles et si forts. Ces gens qui se parlent et en ont l’air joyeux, que se disent-ils ? Ceux-là se retrouvent et s’embrassent, qu’est ce qui les poussent ainsi les uns vers les autres ? d’où viennent-ils ? Pour se reconnaître et se choisir ainsi, comment-font-ils donc ? Toutes ces connexions, mues par une si mystérieuse chimie, éclairent doucement la vie.
Conviez Alcinte à une réception, à un simple moment convivial, et il retardera sa réponse, ou esquivera sa venue. Il n’apprécie en rien de participer de ces séquences où des gens s’assemblent, parlent de tout et de rien, rient d’eux-mêmes et des autres, de situations dont il ne saisit pas le sens mais dont le récit les anime tant ; ils les regardent boire, et s’amuser entre eux, et parfois même, s’ennuyer : ça, il sait le reconnaitre d’un seul coup d’œil. Mais il n’aime vraiment pas ça. Très vite, la conversation va le chauffer, puis l’agacer, puis l’exaspérer. Quoi, faut-il-donc toujours subir ces billevesées ! Vous le verrez soudain s’enfuir sans façon ni saluer.
Le jour suivant, il sera chaviré d’avoir commis cet éclat. Il songera que cela ne valait point la peine de s’emporter ainsi. Peut-être même aura-t-il blessé ceux qui ne voulait que s’entretenir avec lui, et, qui sait, le connaître pour l’apprécier ? Il convient de faire oublier ce mauvais écart ; le voici qui fait porter des roses à ses hôtes d’hier, pas une gerbe mais une charretée. Vous allez vers lui ce matin pour le saluer, et il se précipite et vous embrasse.
Alcinte ne sait donc faire durer son opinion sur les hommes ; car voyez-vous, il n’arrivera jamais à s’habituer à leur inconstance.
©hervehulin2021

Yvonne Adhiambo Owuor est une auteure de romans et de nouvelles kényane, née en 1969 à Nairobi. On peut dire qu’elle est encore peu connue en France et en Europe, mais ça devrait changer. La maison au bout des voyages est son premier roman. Le second vient d’être publié, non encore traduit en français. (suite…)

Suite N° 1.
1.
Des sources de fleurs
Perles blanches sous la lune
Portent leur liqueur
Aux amants Le blond La brune
Pour une folie commune.
2.
L’obscure cigale
Dans le chant des oliviers
Regarde aux étoiles
Et se dit qu’il faut chanter
Plus fort pour les éclairer.
3. Rêve d’étang
Point bref dans la nuit
L’étang mille parfums hume
Déjà s’assoupit
L’étain médaillé d’écume
L’eau vers ses rêves transhume.
4.
Dans le jardin bleu
S’écoule un vol d’oiseaux blancs
Arraché aux cieux
Car loin du soleil sanglant
Le soir semble trop brûlant.
5.
Le front face au vent
J’ai volé quelques pétales
Volé au levant
Tout vitrifié d’opale
Puis j’ai volé trois étoiles.
6.
Au bord du ruisseau
S’inclinent trois roses rouges
Et captif de l’eau
Leur reflet s’éclaire et bouge
Pauvre triple rose rouge.
7.
Sur un jeune pin
Un vieux merle se pose
Puis vient le matin
Sur les arbres et la rose
De l’oiseau noir prend la pose.
8.
Quand l’automne vient
Refleurissent les tons mauves
Tout est plein de vin
Au soir venu d’ivres fauves
Comblent du ciel les alcôves.
9.
Le pauvre ciel nu
Ses envolées d’hirondelles
A déjà perdu
De l’automne les ombelles
Seules semblent immortelles
10.
Quel est ce parfum
Qui verse dans la campagne
Couleur d’or défunt
C’est celui de la montagne
Où lassé octobre stagne
11.
Éloges des nuits
Éloges des crépuscules
C’est le même bruit
Qui dans mon crâne bascule
Et dans mon cœur gesticule
12.
Au fond du jardin
Triste j’ai planté un saule
Ainsi mon chagrin
Pour durer tels ces rameaux
Loin comme eux figé s’envole.
13.
Je suis fatigué
Car si pâle est ma personne
Que j’ai beau chanter
Le cœur de son orgue atone
Couvrant ma voix trop fort sonne.
14.
La voix d’un quatuor
À cordes dans l’hiver vibre
Saisissant dehors
D’un minuscule calibre
Tout ce qui jadis fut libre
- Mort d’un ruisseau
Au fond de ses yeux
S’enchevêtrait une source
Puis sans bruit trop vieux
Il a perdu sa ressource
Et l’eau a cessé sa course.
16.
Tissant son roman
Passager dans le silence
Le chant tout d’argent
D’une flûte bleue s’élance
Vers les voûtes de sa danse.
17.
C’est un long miroir
Que l’eau tranquille en novembre
Et on peut y voir
Que les fleurs cent fois plus tendres
S’évanouissent sous l’ambre.
18.
Près de l’eau qui dort
Des rameaux d’orme se mirent
Dans le soir tendu d’or
La luciole et le lampyre
Déjà fragiles expirent
19.
On voit s’en aller
Les voiles des oies sauvages
Là-haut dans le lait
Si tranquille des nuages
Que divise leur plumage.
20.
Cet arbre est petit
Dessous l’ombre des grands charmes
Mais comme eux il suit
Le fleuve couleur de larme
Octobre au chant de sa palme.
21.
Marchant dans les champs
J’avais surpris une biche
Qui s’enfuit pleurant
Depuis combien je suis riche
Des larmes de cette biche.
22.
La longue blancheur
Du matin froid redessine
L’envie des couleurs
Au fonds d’un lit d’étamine
La nuit à nouveau s’incline.
23.
Les fleurs sont en deuil
Des feuilles jusqu’aux anthères
Car dit le bouvreuil
C’est l’amant de la panthère
Qu’au soir la forêt enterre.
24.
Noyé de sommeil
Cet étang pâli de gemmes
Oublie le soleil
Et le temps n’est plus problème
Pour qui dort et le vide aime.
25.
Le tardif azur
Vient obombrer les pierres
Sur les flancs du mur
Où s’empourpre le grand lierre
Profond plus que la rivière
©hervehulin2020

Que vous a donc fait Dracon, pour le laisser ainsi à ce triste destin ? De quel délit, quelle infamie son état dévasté est-il le châtiment, pour être ainsi réduit ? Pour le laisser à la rue comme ça, à même le sol, accablé de sa misère, chiffonné dans ses fripes sales ? Vous a-t-il volé une pomme, votre chien, les clés de votre voiture ? Aura-t-il fracturé votre huis, vos fenêtres ? En quoi vous a-t-il agressé, pour rester ainsi puni ? Le voici effondré sans réagir aux détours du vent, de la pluie et de la foule. Il est là, désespérément. Broyé par le mauvais destin. Masse inerte, on ne voit plus sa tête, recouverte sous ce mauvais capuchon de toile qui nous cache ses traits, ni ses bras, replié sous le tronc. Les remugles du trottoir ne font pas frissonner ses narines. Qu’est-il advenu de cet homme naguère bien installé en société, qui exerçait un emploi en vue, si bien entouré de nombreux amis ? Où s’en est-il allé, cet ami affectueux, ce travailleur apprécié ? Qu’en reste-t-il, de ce citoyen volontaire, si souvent animé vers les autres ? Où s’est-elle enfuie, cette vie aujourd’hui très ancienne, quand il était un homme comme ceux qui passent devant lui ce soir sans le voir, ou plutôt sans le regarder ? Que nous a donc fait Dracon, pour que l’idée de le regarder nous effraie au point que nul ne sait, sous cet effondrement de l’homme, s’il dort ou s’il meurt ?
©hervehulin2021

Que vous arrive-t-il donc, Elmire, que vous n’entendiez rien aujourd’hui à ce qui se dit, à ce qui se fait tout autour de vous ? Vos proches, vos collègues, vos parents même, semblent parler un langage dont le sens vous est étranger ; vos amis ont des comportements dont vous ne saisissez rien; vos parents même, tiennent des propos inaudibles, comme d’ un patois inconnu. Mais que font-ils donc tous, à s’agiter ainsi, dans ces curieuses élucubrations dont le verbe vous semble hors de portée?
Il y a quelques jours seulement, toute heureuse du travail accompli, vous avez soumis votre nouveau projet à cette étrange réunion du comité de pilotage où, comme à l’accoutumée, les uns parlaient en même temps que les autres. Tous se sont pourtant retrouvés vite sur une opinion commune, que votre idée prêtait plus à sourire, que personne n’y avait rien compris ; que les circonstances ne s’y prêtaient pas. Vous avez eu l’impression que vos mots n’étaient plus traduits, et sans effets sur l’attention qu’ils méritaient.
Et cette soirée, hier partagée avec des amis, de très anciens amis, qui n’ont rien écouté de ce que vous donniez dans la conversation, comme si celle-ci était à présent enserrée dans un code dont vous n’avez plus la clef. Vous avez saisi leur regard vide, et cette étrange déconnexion entre votre parole, si volubile, et leurs mots, si réservés. Mais vous avez bien vu qu’ils en souriaient entre eux. Pourquoi donc, qu’ont-ils compris, quand vous avez perçue être lointaine ? D’où viennent ces tournures dans le verbe, que vous ne reconnaissez pas ? Ces drôles de mots ? Quel est donc cette langue ?
Et ce triste dimanche, ce repas attendu avec vos propres parents, et des cousins très chers. Vous n’avez reconnu personne dans cette conversation, du moins sitôt que son sujet a décollé du temps qu’il fait et qu’il fera, et de la qualité du gigot servi ; des propos sévères, qui vous ont paru si étrangers, sur les étrangers ; une étrange obsession pour les politiciens quand la politique, disent-ils, est si peu honorable ; une détestation orchestrée de soi-même et des autres. Toutes ces vérités, qui ne méritent plus d’exister parce qu’on ne veut plus les reconnaître ; et ce ton, ce ton chargé d’acide, et de peur sans doute. Que disent-ils donc ? Les lèvres bougent, mais le sens des mots s’épuise avant d’arriver à vous, comme sombre une vague avant le sable.
Mais qu’est-il donc arrivé à tous ces gens, qui sortent de si étranges signaux de leur bouche ? Se comprennent-ils eux-mêmes ? Ils ne sont pas heureux, ils ne croient plus en eux. Voici donc ainsi toute méchanceté justifiée ?
Ne vous reprochez rien, Elmire. Sans doute des jours meilleurs reviendront, des jours de raison et de cœur. Ils parlent leur langage, mais le vôtre reste si juste que nul aujourd’hui ne peut plus l’entendre. Gardez-le précieusement. Sa grammaire est d’une économie lointaine pour leur entendement, son sens est trop tourné vers le goût des gens, et vous-même, trop, attachée au bonheur. Un jour à nouveau il sera reconnu. Votre caractère, Elmire, est tout en bonté et en humanité. Voici la seule cause à votre désagrément. Voici la seule raison que plus personne ne vous comprend et que vous ne comprenez plus personne.
©hervehulin2021

Il y a deux sortes de livres pour vous faire voyager, à l’intérieur et à l’extérieur. D’abord, les récits de voyage, produits par le talent spécifique des écrivains voyageurs (Tesson, Bouvier) ou romantiques (Lamartine, Nerval etc.). Et puis il y a des livres qui vous emportent. Par leur énergie, leur rareté, leur message. C’est le cas du Feu des origines. Voilà un roman qui part de l’Afrique, nous parle de l’Afrique – pour peu qu’un roman « parle » de quelque chose- pour arriver au destin de l’Afrique. (suite…)

Hermas a la passion de la nature, du vivant en général et des oiseaux en particulier. Voilà pourquoi il ne saurait se passer de chasser. Il ne vit que pour cela. Tous les autres égards que l’existence peut lui offrir ne le concernent que si cette ardeur reste intacte. De toute sa vie, il n’aura eu d’autres affaires que celle-ci.
Les oiseaux sont un peuple magique ; Hermas les connaît tous. Il sait reconnaître la voix du chardonneret, comme celle d’un vieil ami ; il sait lire le vol tournoyant des vanneaux au- dessus des champs ; il sait dévoiler l’art sans égal de la bécasse de se cacher sous les feuillages ; il sait entendre et comprendre l’appel du souchet derrière les roseaux. Enfin, il connaît tous les signes de ce monde, que la nature a codifiés depuis des millénaires. Le vol, la silhouette, le chant, la parure, Hermas connaît tout.
Marcher dans les bois, sous la senteur des fougères et des feuilles mortes, sous la rumeur des feuillages, dans la quête de sa proie, chercher des heures la cible qui fera son bonheur, voilà tout le sens d’une vie. Partir avant le lever du jour vers la bordure des marais, s’installer à l’affût, dans le silence de l’aube qui point ; et puis, voir dans la première lueur du jour, là-bas, encore lointaine, frémir la première ligne de vol des oies sauvages, tout juste à l’essor, qui partent vers le sud. Ah… s’il fallait vivre sans cela, il conviendrait plutôt de mourir ici et tout de suite, dans cet instant magique et en respirer l’infime ardeur une dernière fois. Tout l’or de l’univers ne pèse d’aucun poids face à ce bonheur-là. Et c’est bien cela, le véritable esprit de la chasse.
Voici qu’Hermas est à la traque, à présent. Les bords de l’étang sont silencieux, comme absents du monde. Que chasse-t-il aujourd’hui ? Malgré sa ruse et ses détours, la bécasse ne survivra pas ; le destin de la proie est ferré avant même que l’oiseau soit repéré. Il progresse dans les sous-bois, à pas lent et aux aguets. Sa main est ferme sur son fusil armé. Chargé de plomb numéro 6. Plus sûr à l’impact, tant pis pour le plumage. Le doigt ganté sur la détente qui palpite et tremble. Son esprit est durci comme un acier neuf. Cela fait six heures à présent que le chasseur est en quête. Il a beaucoup marché, le pas glissant sur l’humus et les feuilles mortes. Six heures harassantes. Pas question de rentrer la besace vide. Il y a un compte à régler et ce sera fait avant midi.
Soudain, sous les fougères, près de la lisière des eaux, quelque chose bouge. Il tire. Le plomb déchire les feuilles, et un nuage de plume frémit sur la verdure. Des gouttelettes de sang aussi. Hermas accourt et se penche. C’était un héron cendré. Le plomb lourd lui a cisaillé la tête, et emporté l’aile droite ; les viscères sont sortis sur la mousse. Dis-nous donc, Hermas, quel oiseau ressemble moins à une bécasse qu’un héron ? Peu importe, le feu de la passion a parlé, et l’ennemi est mort. Et de milliers de gibiers jadis vivants, les fantômes pâlis pourraient parler : les oiseaux, Hermas les désire plutôt morts que vivants. Car c’est bien cela, le véritable esprit de la chasse.
©hervehulin2021

Voici l’heure opaque : c’est l’heure la plus pure
Quand l’esprit s’évapore sans trouble ni retard
Voici qu’une ombre se pose au grand large du soir
Le songe s’est voilé dans un souffle qui dure
Voici que s‘achève la vaine ardeur du jour
Adieu les soleils blonds les bienheureux effluves
Le sillon des clartés s’épuise chaque jour
Et chaque soir revient la neige après l’étuve
Viennent l’ombre qui vibre et l’ombre qui voltige
Flatter le ciel tendu dessus les frondaisons
Déjà en toison bleues les nuages s’érigent
Et le ciel s’apaise veiné de doux poisons
La meute des senteurs les armées de lueurs
Raniment les miroirs de forêts diluviennes
Tandis qu’appareillent des navires danseurs
L’océan se gonfle comme un soleil qui saigne
L’ombrage se délie La fraîcheur s’accélère
Des fleurs s’émerveillent comme des tombeaux
Et leur parfum se fige en sifflantes lumières
Le soir encore secret déroule ses anneaux
Quel est donc cet envol qui passe avec ardeur
Quand le monde se ferme aux feux tièdes du soir ?
Quelle est cette brûlure au toucher sans douleur
Comme un instant de pâme, incertain ? « C’est l’espoir ».
©hervehulin2021
©hervehulin

Voici Alberic qui podecaste son opinion comme chaque semaine sur son site internet; il nous parle en vidéo de son large canapé. Son visage trône sur l’écran. Il est bien nourri, le teint rose et l’œil bleu. Derrière lui, le plan laisse voir une vaste pièce, une grande bibliothèque, deux larges fenêtres. Alberic est satisfait, il a réussi et c’est une bonne chose qu’il en profite. Il appartient à ce genre nouveau de magicien, qui modèle le monde aux seules convenances de sa vue et de son opinion. Il détient des vérités nouvelles, toute de son cru. Elles lui permettent de savoir et comprendre ce que nul autre ne sait ni ne comprend. Il s’exprime d’un ton doucereux, l’orateur ; il fait lentement tournoyer ses branches de lunettes pour souligner ses propos. Parfois, il fixe durement sa caméra pour appuyer une vérité sans apprêt. Il prononce des phrases telles que “ C’est une vraie question, mais personnellement, je ne la poserais pas de cette façon”... Ou “Je vais vous expliquer pourquoi les choses ne vont pas se passer comme ça...”. Ou encore, de la proposition d’un autre:” C’est une idée intéressante…”
De l’intérieur attiédi de sa bulle , il sait comment changer le monde. Sa chronique de ce jour nous parlera de la révolution, qu’il appelle de ses vœux. Force est de constater, dit-il, l’incapacité des classes qui nous gouvernent. C’est un fait, et il n’y a point de débat utile. Il va bien falloir en changer et comme l’élection ne le permet jamais, ne fait que reproduire les mêmes modèles qui nous dirigent, et a perdu son sens, le retournement doit être brutal. Nulle loi issue de cette engeance ne saura changer cette société autant qu’elle doit l’être.
Le grand soir est imminent, l’heure approche. Il faut chasser ces élites décadentes- voilà, le mot suprême est lâché, qui suffit à rameuter tous les rebelles – et les remplacer grâce à ce salutaire chambardement. Changeons les têtes et ne tremblons pas. Après tout, une révolution, bien maîtrisée, par des gens sages, n’est jamais si violente que ses adversaires veulent bien le soutenir. Des mouvements d’humeur et de foule feront bien le prix modéré d’une omelette. Quelques carreaux cassés, quelques coups de poings salutaires, à la rigueur quelques erreurs et notre affaire est réglée. Alors commencera une nouvelle ère qui sera forcément, inévitablement, et logiquement, préférable à ce fort vilain état social que ces élites fatiguées nous imposent.
Il parle si bien, Alberic, qu’on l’écoute avec humour et tendresse. Il ne sait pas qu’on sait : son parcours antérieur est connu, qui l’a amené jusqu’à cet écran. Alberic, il y a bien des années, a échoué à l’ENA ; il n’a jamais fait sa place dans la compagnie d’assurance, qu’il a quitté, comme il dit, en claquant la porte ; la société qu’il a créée par la suite, a rapidement fait faillite. Telle est la conviction d’Alberic. Il faut changer les élites.
©hervehulin2021

Straton est ainsi fait qu’en toute circonstance, il préfère la contemplation de petites choses aux exercices de la conversation, de la carrière, ou même de la reconnaissance de ses pairs. Somme toute, cette cohue des gens qui l’entourent lui importe peu. Les ambitions le fatiguent, les informations le saturent. Il n’y a selon lui rien de beau ni de bien dans tout cela. On l’invite à une belle réception ; il hésite à répondre. On lui demande de terminer ce compte-rendu, il soupire, contre mauvaise fortune. Vient-il déjeuner ? pas aujourd’hui, mais peut-être demain.
Au fonds de cette réunion qui dure, il semble comme égaré, et l’ennui se dessine vite sur ses traits ; mais soudain, un rayon se dévoile par la fenêtre, et notre Straton reprend couleurs.
Ce défaut qui fait tant sourire ses collègues et ses proches vient de ce regard constant qu’il est capable de soutenir sur un détail, une apparence, un reflet qui passe. Tant de choses sans importance, dont lui seul aime à deviner et cultiver l’importance. Ce regard éclairé de ce sourire discret qu’il laisse entrevoir dans sa contemplation, c’est sa marque de fabrique. A son âge déjà mûr, il n’en changera plus.
Le voici quai d’Anjou : voyez comme il se plaît, sous la senteur d’automne, immobile, en fixant le minuscule naufrage recommencé d’une poignée de vaguelettes contre les pierres ; ailleurs, vers Bastille, c’est la tête relevée derrière le sommet de la colonne, captivé par le cirque pâli des nuages, qu’il reste sans bouger ; et puis, là encore, aux Buttes Chaumont, sous un large marronnier, c’est la figure haut-perchée d’un rouge-gorge qui l’hypnotise, comme dans un halo de bonheur visible. Il y aura de nouveau un reflet de couchant sur une lanterne, une jeune silhouette qui passe, au sillage parfumé, la couleur tranchée sur jaune d’un feuillage. Et tout cela, dans l’âme de Straton, fait de ces instants son éternité.
Ne médisez pas de Straton, il est l’ami de tout ce qui fait que le temps peut freiner sa course. Peu importe qu’il soit sorti du cercle. Il est le sens et le regard, il nous traduit sans effort la beauté du monde.
©hervehulin2021

Arata Tendo semble encore peu connu en France ; il a reçu au Japon le prestigieux prix Naoki, l’un des principaux prix littéraires de l’archipel, pour son roman L’Homme qui pleurait les morts (publié en 2008 mais, à ma connaissance, le seul encore traduit en français à ce jour).
Shizuto est un jeune homme, apparemment sans attache ; il parcourt le pays à pied pour accomplir un rituel funèbre à l’intention de ces gens morts pour la plupart de morts violentes, et qui n’ont pas ou trop peu été pleurés. Ce sont des êtres disparus qu’il ne connaît pas, et qui n’ont jamais rencontré sa vie. Il se renseigne sur leur sort, les conditions dans lesquelles ils ont perdu la vie, note minutieusement leurs joies, leurs peines, ce qu’on sait de leur famille, leurs amitiés. Puis il se rend sur le lieu du drame, et entame une gestuelle funèbre pour leur rendre hommage. Cette vocation, il se l’est choisie seul. Mais qu’est-ce que pleurer un mort dans une société qui va à vau l’eau dans la spirale de la vitesse, de la performance et de l’individualisme ? pourquoi donc Shizuto, plutôt qu’un autre, consacre-t-il sa vie à cette pratique ? Pourquoi cet altruisme funèbre ?
Le destin de trois personnages croise Shizuto, dont la trajectoire va densifier l’histoire, en apportant un réseau de significations et d’émotions au cérémonial de Shizuto, qui va permettre d’en dévoiler peu à peu l’origine et la portée. Le lecteur fait d’abord la rencontre de Makino, un journaliste cynique, plus porté sur les ragots ras de moquette que la vérité des informations, lui-même marqué par l’abandon de son père. Puis Junko, la mère du « pleureur », dont les jours sont comptés sous la menace d’un cancer en phase terminale, qui organise sa fin tout en s’occupant de sa fille enceinte et en attendant infatigablement le retour de son fils, pourtant parti sans souhait de retour. Enfin Yukiyo, femme fragile et tourmentée, a naguère tué son mari, et depuis, erre en compagnie du fantôme de ce dernier. Leurs vies passées, les remous intimes ou familiaux, regrets et doutes, se ramifient et irriguent le roman sur un mode polyphonique qui s’organise autour de l’immuable sacerdoce de Shizuto. Chacun de ses personnages, on le comprend vite, a un compte à régler avec la mort, une histoire inachevée, et complète la partition avec Shizuto dans un quatuor qui s’accorde tant bien que mal au fil des morts honorés.
La quête du jeune homme s’éclaire comme le récit avance. Sur les pas du « pleureur », le lecteur s’attache attentivement à la lente progression d’une rédemption nécessaire. Mais la présence obsédante du regret de la vie passée, des chimères de la nostalgie et du bonheur, de l’angoisse de la mort, la mort qui broie tout et termine toujours tout, alimente le récit à chaque page, pour permettre au thème majeur de se dessiner : la perte de toute compassion dans cette société moderne et la pauvreté humaine de nos vies urbaines.
L’écriture minutieuse et délicate, l’authenticité des dialogues, le lyrisme contenu, colorent le roman d’un ton paisible, et, malgré la mélancolie, d’un amour pudique de la vie. Une lecture attentive – facilitée par le charme apaisant de cette écriture -permet d’apprécier les références très traditionnelles de la culture japonaise, qui donne au texte une patine lumineuse. Le cycle des saisons, le climat et le temps qu’il fait – soleil, pluie, vent – comme autant de messages codés de la nature en mouvement, la présence des hommes dans les paysages, qu’ils façonnent et animent- villages et champs, rues étroites et carrefours des routes de montagnes, banlieues tristes et trop urbanisées – tous ces paramètres dressent un décor captivant, où transparaissent les mauvais penchants de la société japonaise, écartelée entre ses obsessions pour la tradition, la pudeur, l’individualisme et enfin, la modernité.
L’homme qui pleurait les morts n’est pas un roman sur la mort, mais bien plutôt inspiré par le lien entre la vie qui reste, et ses devoirs envers ceux qui ne sont plus et qu’on oublie ; c’est en les honorant, sans enjeu, sans intérêt, mais seulement pour ce qu’ils continuent d’être en nous, dans nos paysages intimes et le sel de nos souvenirs, qu’on éclaire sa propre vie, comme l’effet d’une grâce durable.
Espérons, espérons que Le Seuil – ou tout autre éditeur, que fait donc Picquier ? – nous donnera prochainement la traduction d’autres ouvrages de ce bel écrivain.
Arata Tendo. L’homme qui pleurait les morts. Seuil. Traduit du japonais par Corinne Atlan. 606 pages.
©hervehulin2021

Le sage est toute en mesure, quand le sot prolifère. Le sot s’exprime sans limite car il a quantité de choses à dire sur tout ; sa soif d’à-propos ne tarit jamais, et chaque évènement du monde attise en lui cette fureur de donner son avis. Quand un sage aime patienter que le fruit soit mûr, le sot ne montre que la rage de l’avaler en maudissant cette si lente nature. Là où un homme sage saura trouver quatre mots pour adresser à tous une vérité nouvelle mais simple, l’esprit sot aura une envie irrépressible de se soulager de centaines de paroles et d’attirer l’attention par toute une multitude de couches successives, et ne cessera de ressasser des formules apprises et bien pauvres, et qui seront sa fierté, et qui tiennent lieu de couleurs. Du plus clair vers le plus sombre des idées pauvres, à partir de l’aplat de sa nullité, il en noiera l’espace et la durée, pour finalement tout gâter de notre tranquillité. C’est la raison pour laquelle le flux des réseaux d’opinion qui ont fort endommagé l’honnêteté des esprits et le goût de la vérité, ne finit jamais. L’imbécilité des idées est douée d’un mouvement perpétuel qui, tel un aimant, attire les uns vers les autres et rassemble tous ceux qui en sont animés ; de sorte que les rassemblements d’imbéciles émettant toujours de l’esprit, l’essaim, éternellement nourri, n’aura de cesse de voler qu’il ne couvre le ciel et gagne l’univers.
©hervehulin2021

Nous voulons vivre toujours mais nous voulons vivre plus encore. Demain comme aujourd’hui. En nous, deux faces se confrontent sans jamais faiblir. Celle qui entend profiter du monde à l’instant, et jouir des plaisirs qu’il nous permet de consommer. Et celle qui aimerait bien rester en situation de faire encore de même dans cent ans. Mais voilà, pour notre malheur, notre Terre si étroite s’épuise de nos actions. On le sait depuis longtemps, on ne le voit que depuis peu. Nous voulons boire tout de la source, mais nous désirons que perdure tout là-bas le flot de l’estuaire. Comment choisir entre la vie maintenant, celle qui bat tout de suite, là, contre la porte, et celle dont on entend à peine encore le pas, mais qui nous appelle des lointains estompés de brume ?
L’homme est ainsi fait qu’il ignore, sous cet esprit limité qu’il imagine sans limite, comment habiter sa maison sans la consumer de ses mille envies toujours recommencées. Il ne connaît le sens et la voie de tout ce qui a fait de lui cet être dominant. Voyageur maladif, explorateur impénitent, il est égaré dans une forêt vierge, dévasté par la soif. Les arbres de cent pieds de haut lui voilent la lumière. A bout de force, il entreprend alors de creuser à main nue ce sol tourbeux, dans l’espoir de faire jaillir une source. Vite, avant que le soleil invisible n’achève de le ruiner. Son énergie se tourne tout entière dans le désir de boire. Il s’affaire et s’essouffle à la tâche. Ses doigts attaquent la terre meuble mais toujours plus profonde. Bientôt, ses épaules et ses bras sont endoloris. Tout son corps, devient à chaque levée, plus desséché. Sous l’effort, la sueur le vide. La chaleur des tropiques est sans pitié. Ses forces – celles-là même qui lui ont permis l’entreprise de traverser cette immense contrée- se perdent sans retour. Voilà, il est épuisé absolument. Il tombe face contre terre. Son souffle cesse. Son cœur se tait.
Il n’a même pas vu comme il pleut au-dessus de lui, il pleut encore et toujours, de cette pluie d’Afrique dont le ciel depuis des millénaires, fait don à cette vieille terre. Il suffisait de lever le nez, de cueillir une feuille, de la rouler et d’attendre que le ciel la remplisse. Quelle volupté c’eût été. Mais il est trop tard. Et nous sommes ainsi, qui ne savons voir ce qui est donné. Il suffirait d’écouter.
©hervehulin2021

Aux confins du monde. Karl Ove Knausgaard.
« Aux confins du monde » est le quatrième livre du cycle romanesque et très autobiographique de Karl Ove Knausgaard. Ce cycle intitulé « mon combat » (“Min Kamp” en norvégien ; oui, on pouvait mieux connoter, ça commence mal…) est un fleuve de 3000 pages et six volumes. L’auteur y raconte sa vie, sans flambée aventureuse, ni rien inventer des faits, avec réalisme, et c’est du roman. C’est en toute circonstance, une expérience de lecture originale.
Dans ce quatrième tome, donc, Karl Ove est un grand adolescent de dix-huit ans, qui termine l’école secondaire, s’éloigne un an dans le nord de la Norvège (d’où le titre) où il a décroché un premier emploi : enseignant suppléant. On découvre qu’en Norvège, avec ce qui est là-bas le baccalauréat local, on peut choisir d’être enseignant à dix-huit ans, pendant un an. Il accède désormais au monde nouveau des adultes, en passant de l’autre côté du tableau noir. Mais Karl Ove veut surtout profiter de cette occasion pour devenir écrivain, travailler à des nouvelles, puis partir en errance etc. Bref, il va chercher ses repères, son identité, tenter dans cette expérience de tracer quel genre d’homme il veut devenir, se construire en adulte. On voit à chaque page un jeune homme qui s’amuse, qui s’ennuie aussi et bavarde beaucoup avec ses amis, ses voisins, qui boit (pas mal et même beaucoup), qui fume tout le temps, qui se sent maladroit dans ses relations avec les filles, qui ne s’entend pas avec son père, et qui a des souvenirs. La musique tient une place importante dans ses goûts, ses relations, sa personnalité. Karl Ove travaille sur le souvenir et l’identité, comme un artisan le bois. Il écrit beaucoup sur lui-même, avec un « Je » qui structure tout l’approche du style, et qui centre le récit de façon obsessionnelle. Il cherche honnêtement à nous faire ressentir ce qu’il a alors vécu intérieurement, et la première vertu de ce texte est sa sincérité. Mais on découvre très vite que son projet supérieur, celui qui tient la trame du roman et en fait le ressort, qui revient à chaque page, qui le taraude nuit et jour, c’est « coucher avec une fille » (le lecteur doit être prévenu que l’expression « coucher avec une fille » revient environ 350 fois dans l’ouvrage).
Voilà, tout est dit. Qu’on ne s’attende pas à des scènes mouvementées ou à un érotisme fiévreux, ou un suspens de plomb. Il ne se passera rien. Et l’authenticité des situations, des émotions de cet auteur ne compensera pas la faille absolue de cet ouvrage : pas grand chose à dire. Tenir trois mille pages avec si peu de matière et une inventivité du style proche de zéro, c’est une incroyable performance d’écriture, il faut bien le reconnaître.
Une myriade de détails absolument inutiles à chaque scène, à chaque page, encombre l’attention du lecteur, mais permet de peupler le texte et remplir les 600 pages pour faire pavé. Une scène de déjeuner ? On a droit au détail du menu, à la recette, au couvert, et s’il n’y a pas assez de pommes de terre, ça travaille pendant deux paragraphes. Une soirée entre jeunes ? on a le détail des vêtements, la marque de la bière, la couleur de la moquette…Tout est comme ça : Knausgaard décrit l’escalier qu’il grimpe, la porte qu’il franchit, le trottoir qu’il emprunte. A un moment, il faut bien le dire : Knausgaard nous emmerde.
Knausgaard est à la fois prétentieux (6 tomes pour une autobiographie, d’un auteur pas très vieux qui n’a pas écrit grand-chose que d’écrire sa vie, il faut un égo surdimensionné) et modeste (il reconnaît que ce qu’il raconte est assez banal). Certains critiques littéraires l’ont même rapproché de Marcel Proust. Pauvre Marcel, il doit se retourner dans sa tombe. Ces gens -là sont bien passés à côté de « La Recherche » pour dire ça.
La qualité de la narration n’est pas toujours égale et reste parfois superficielle voire artificielle. Peut-être qu’en Norvégien le style est plus attractif, mais en attendant de lire couramment le norvégien, on doit bien dire que c’est plat. Sans doute du fait que l’auteur n’a pas grand-chose à nous dire. C’est normal, il ne fait que raconter sa vie, qui est d’une médiocrité consternante. Knausgaard est donc seul responsable de ce ratage. Car on ne peut réduire sa création littéraire au seul ressort de sa propre vie, surtout si celle-ci est si peu vivante. Qu’a-t-il vécu cet homme -là, pour en faire un roman qui n’a rien d’un roman puisque rien n’y est inventé ? Quelle universalité dans ce récit ? Où est la création dans ces six cents pages qui ne racontent rien que le quotidien d’un adolescent qui se cherche ? Comme des millions d’adolescents ? Qu’est ce qui est exportable, profitable, admirable ? A-t-il inventé un style, une conception nouvelle du roman ? En quoi d’ailleurs est-ce un roman ? On frémit à l’idée qu’il y en a cinq autres comme cela. Et pourquoi donc cette série s’intitule-t-elle « Mon combat » ? Nul lecteur ne trouvera dans ce qui aurait pu se penser comme une simple chronique, la moindre trace de combat. Contre quoi Knausgaard se bat-il, au fait ? Le nombre de canettes devant lui, ses clopes, ses ennuis ? Combattre en littérature, ce n’est pas cela. Demandez à Camus, Sartre, ou Voltaire. Demandez à Zola.
On l’aura compris. « Aux confins du monde » n’est pas une lecture indispensable.
Karl Ove Knausgaard. « Aux confins du monde » (Mon combat – livre IV). Traduit du norvégien par Marie-Pierre Fiquet. Éditions Gallimard (Folio). 608 pages.

Sachant que la couleur ne subsiste
Dans l’iris des sites et des formes
Qu’au regard de l’incolore triste
Qui lui offre ses fonds et ses normes
L’automne est multiple et trismégiste
Comme il ombroie jusqu’à la croisée
Un jardin de feux et de rosée
Il ravive ainsi les améthystes
Dedans la fenêtre un salon d’ombres
Antiques dort paupières closes
Les meubles que la poussière obombre
Clamant l’immobilité des choses
Il est brun comme l’automne est d’ombre
Ce salon étrange comme une
Couleur d’automne à tout est commune
Quand un bleu ingambe s’érige hors des décombres
Elle est vêtue d’un bleu nu devant les lueurs
De ce jour d’automne qui s’élague tout seul
Auprès du bois des meubles à la modeste ampleur
Elle répond d’un ton fragile et presque veule
Où se change la lumière en brillante sueur
Elle ne lit pas son livre et incline son cou
Son cou est pur comme le tranchet d’un bijou
Elle murmure sans parler Elle est en pleurs
©hervehulin2021

Earl Thompson (1931-1978) pourrait tout à fait rentrer dans la catégorie de ce qu’on appelle un écrivain maudit. Maudit, c’est-à-dire sulfureux, rebelle, anti conformiste et très inspiré. En rupture avec les codes.
De ce point de vue, Un Jardin de sable – titre inspiré par l’uniformité désespérante des plaines à blé du Kansas, où l’histoire prend sa source – tape dans le mile. C’est le premier de ses trois romans autobiographiques (Tattoo, la suite, paraîtra en 1974, et Caldo Largo, en 1976). Roman sombre, à la trajectoire impitoyable, dont l’écriture, presque dense, suffocante même, prend le cours d’un long travelling dans la misère et le désespoir du prolétariat américain, pendant la grande dépression.
Le roman est d’abord celui de Jacky, gamin du Kansas, depuis sa petite enfance jusqu’aux portes de l’adolescence. Sa mère, Wilma, de tempérament fort volage, pour rester pudique, se retrouve veuve, alors que la crise de 29 et sa dévastation frappe sans pitié les américains les plus pauvres. Donc, elle s’en va, et laisse bien en plan son fils en bas âge.
Se déroule alors, après ce bref prologue, l’acte I du roman, le plus captivant sans doute. Le grand père est là – de loin le personnage le plus intéressant du roman- vieil homme rugueux et sans concession pour les autres. Il apporte à l’enfant, avec le concours de sa grand-mère, pétrie de principes religieux, un semblant de règles morales dans cet univers délabré. Les premières années de Jack se passent ainsi, sous la tutelle forte mais plutôt bienveillante de ce vieil homme caractériel. Une réelle tendresse le noue à ce petit garçon, fragile, au regard ingénu et vif sur ce qui l’entoure. Les épisodes très colorés et pleins d’humour se succèdent, avec un réel plaisir pour le lecteur qui va oublier le volumineux pavé qu’il a dans les mains. Le perroquet dressé à répéter des obscénités, la chasse au lance-pierre… Cela tient pendant un bon tiers du roman. Voilà pour la première partie. Jusque-là, ça va.
Puis la mère de Jacky, Wilma, qu’on avait oubliée, refait surface. Acte II donc. Elle reprend son fils avec elle, et son amant, un alcoolique pathétique du nom de Billy. Jacky croit qu’une nouvelle vie s’ouvre à lui, dont cette errance ne serait qu’une séquence brève. On lui promet de belles choses, ou c’est lui qui se les imagine, mais peu importe. Il rêve d’une maison, une vraie, et d’une famille qui le réchauffe et le rassure. Une vie de tous les petits garçons de son âge. Il va vite déchanter car, pour ces gens-là, la misère est la même partout. Bill, le compagnon de Wilma, est un fainéant, non seulement alcoolique, mais violent et méchant et menteur. Il n’y a rien pour vivre, pas de travail, pas de dollar, chaque journée est un calvaire d’expédient, et la Wilma se prostitue sans trop se faire prier, d’abord un coup comme-ci pour combler les trous du portefeuille, puis à plein temps, pendant que cet abruti de Billy disparait picoler ou passer en taule un moment. Jacky assiste à tout ça en première loge, y compris les coups et le sexe. Évidemment, ça va le perturber grave. Et comme filent les – nombreux – chapitres, on s’enfonce, dans la pauvreté, la crasse, la faim, le froid, les taudis, la promiscuité, l’absence d’intimité, le mépris.
Cet acte II est nettement moins réussi que le premier, et glisse au fur et à mesure des pages vers un terrain de plus en plus glauque. Plus la misère s’enfonce, plus le désir monte chez Jacky. Monte vers le corps trop souvent dénudé, trop souvent contemplé, si désirable, de sa mère et on voit bien comment ça va se finir : dans le lit de la maman. Voilà pour le spoiler.
« Un Jardin de sable », on l’a dit, est un gros-roman-puissant-très-long ; roman trop long, même si on sait bien que c’est la mode éditoriale des gros pavés. Trois cents pages auraient largement suffi, inceste compris. Mais « Un jardin de sable » est-il un grand roman ? Les qualificatifs ne manqueront pas pour louer ce côté abrupt et sans fard : on aura droit au grand coup dans la gueule, au souffle épique, la claque, au choc en pleines tripes, un torrent d’humanité, épopée cruelle mais tendre etc.
On peut être plus modéré, voire franchement réservé. Ce n’est pas parce qu’on se vautre avec style dans la fange qu’on fait du génial garanti. N’est pas Zola qui veut. Avec Thompson, les pauvres sont vraiment des perdants pas vraiment magnifiques – pour reprendre Leonard Cohen -mais trop moches. Ils sont vraiment sales, vraiment voleurs, vraiment lâches, pervers, alcooliques, médiocres, bornés, vilains, menteurs, n’en jetez plus. Qui aura envie de tendre la main à ces gens-là ? L’enchaînement de ces visions caricaturales, écrites avec un incontestable talent, finit par saturer, et on en a vite assez. La compassion laisse vite place à la consternation. L’image qui est donnée de ces pauvres gens est constante, monolithique même, assez lamentable, et sans nuance. Alors, on pourra toujours dire que reste au tamis l’amour profond entre Jacky et Wilma ; entre cette mère, si inconséquente, et cet enfant, si perverti par la misère. Il se dit ça et là que cette trame incestueuse, qui est le vrai diamant noir du roman et en fait finalement l’éclat, aurait une trace autobiographique. On comprend que l’écriture a pu servir de vulnéraire à son auteur face à ce tabou brisé dont personne – personne, pas même un grand écrivain – ne sort indemne.
Quel sentiment laisse un tel roman, certes talentueux, mais si lourd ? je me souviens d’une belle phrase déclamée de Leo Ferré, pour exprimer ce sentiment de post lecture :« Qui donc réparera l’âme des amants tristes ? qui donc ? ». On connaît hélas la réponse ; la littérature fait des miracles, mais ne peut pas sauver le monde.
On remerciera enfin l’éditeur pour ce bel objet qu’il nous donne, à la couverture soignée, qu’on garde avec plaisir dans la main, et qui est sa marque de fabrique.
Earl Thompson. Un jardin de sable. Edition Toussaint Louverture. 752 pages. (Traduit de l’anglais – États-Unis- par Jean-Charles Khalifa).
©hervehulin2021

Ménippe a la passion de la connaissance. Il est érudit. Il consacre bien de son temps, dont une part de ses nuits, à l’étude. Il sait et comprend de si nombreuses choses qu’on se demande comment son esprit s’y prend pour ménager tout cela. Tenez, il connaît par cœur le nom, prénom et affectation de tous les préfets en poste sur la métropole ; il peut vous les citer dans l’ordre des départements par numéro croissant, ou, si vous lui demandez, décroissant aussi. Et lorsqu’il vous aura récité la litanie, il fera devant l’assistance un tour sur lui-même, heureux de la performance. Parlez-lui du dernier téléphone portable de telle marque ; avant même que vous le demandiez, il pourra vous décliner non seulement toutes les caractéristiques de l’engin, mais ce qu’il a de plus qui fait la différence avec les dix ou douze modèles concurrents, ainsi que l’historique technique des appareils, et en quelle année ces innovations ont été produites. Il peut aussi avancer sans ciller la liste – Ménippe adore les listes, il en produit plus de vingt par mois -des cinquante romans les plus lus sur le plan mondial, dans l’ordre évidemment. Connaissez-vous la nomenclature européenne des référencements des codes de l’achat public ? Peu importe votre lacune : Ménippe vous l’exposera en détail ; il s’est d’ailleurs fendu d’un long mémoire de commentaire, où il analyse les effets importants mais aussi les faiblesses de cette directive. Il travaille de front, ces derniers temps, à assimiler les noms latins des arbres fruitiers du monde entier, les modèles des voitures allemandes depuis l’invention de l’automobile, et un grand inventaire, d’une exhaustivité sans précédent paraît-il, des micro-ordinateurs, et ce depuis l’invention du microprocesseur. Ménippe apprécie l’intégralité.
Il a encore un grand projet qui l’occupe, mais qui reste dans les limbes, qui n’a encore jamais pris forme. Il aimerait tant aussi écrire une anthologie très volumineuse et très commentée de la poésie romantique ; mais Ménippe jamais de sa vie n’a lu un poème : avec toutes ces tâches, comment en aurait-il eu le temps ?
©hervehulin2021

NOCTURNE
I
Dans le jardin tranquille
Dix mille yeux rosés
Dans les feuilles scintillent
(Le vent est supposé)
O… qu’ainsi vivre est silencieux
Sur la peau des cieux
II
A moi Le dieu-chien de trois pas
Quittant l’ombre s’avance
Sa démarche semble médiane
Devant la lune en filigrane
Quand sur la margelle il jappe
Débute l’arc long de sa danse
Puis
Sans se retourner
La lune s’en va
Du jardin qui fut
III
Maintenant la déesse panthère
Aux peupliers se donne
Alors que faire ?
A l’ombre des colonnes
Moi je n’y peux rien faire
Couleur de sienne envie en moi
D’outre passer les colonnades
Et mourir pour les peupliers
©hervehulin2021

De cet ami qui à l’instant est sorti de la pièce, n’allez pas dire du bien des figues qu’il a servies pour plaire à ses invités. De nos jours, il convient mieux en société de faire montre de méchanceté que de bonté. Là est le ton du diapason : ce qu’il faut pour être en harmonie avec autrui, c’est avant tout rabaisser et agresser, par une formule bien saillie qui fera date quelques instants, qui rameutera des rires convenus, avant d’envoyer la suivante quand sa vibration aura cessé. Dire du bien de celui qui est absent fera passer pour une personnalité insipide l’auteur de ce faux-pas, qui sera vite exposée aux traits fulgurants qu’il n’a pas voulu asséner par son précédent propos. Quel sens aurait donc de diffuser quelques flux de bienveillance sur ces réseaux qu’on appelle à tort sociaux , alors qu’ils ne servent qu’à abîmer tout ce qui fait la beauté de la vie commune – le respect de l’autre, l’amour des idées, le goût de la pensée, et aussi, simplement, la joie –? Répandre comme une nuée que lui, là-bas, est aimable, et que cet autre, est admirable ? Démultiplier que ces gens- là sont utiles, et qu’ils doivent être respectés, pour la pertinence de leurs idées, la qualité de leurs propos ? Non, la nuée qui s’envole très haut est celle des mauvais mots qui blessent ; mais les mauvais mots qu’on veut innocents comme une sorte de réflexe, deviennent si nombreux qu’ils se ramassent en essaim, et les essaims une fois lâchés se reconnaissent, puis se rejoignent ; et rejoints, ils enflent encore, couvrent l’éclat du jour d’un ombrage secret, et grâce à l’ombre ainsi secrétée, brûlent, dans le tourbillon de leur étrange impunité, tout le tissu d’humanité qui tremble. Alors, dans la tiédeur de la braise qui pâlit, voici de toute sa puissante envergure, la haine, encore la haine, et son torrent noir de désastres.
©hervehulin2021

LES PLEUREURS
Perdus dans le linceul des saules adventices
Les aventureux rayons du couchant se défont
Les ombres sont rouges Les songes sont novices
Dans ces larmes ramifiées le soir se fait plus long
La rivière invisible en s’éventant dérive
Son regard est si pâle Son miroir est nodal
Et sème une traîne d’étoiles éventives
Les alucites dénouent ce vide sidéral
Les pleureurs sont enneigés d’une peine contraire
Car ce soir qui les fait si tristes et si beaux
Saisis dans le contre-jour d’une même lumière
Vient les nimber du deuil du soleil ou des eaux
Les pleureurs sont embrumés d’une peine contraire
La peine est un hasard de brume et d’intérieur
Une planète tremblante au bout de la lentille
La douleur est un lys noir à l’éclair moqueur
Quelle est donc cette évidence en mourant qui scintille
Sombres couleurs de l’âme où le saule s’éteint
L’astre couchant se contemple où le désir s’achève
Le sang pâlit la voix se meurt le cœur s’étreint
D’un seul souffle la fleur se change en son propre rêve
Les pleureurs endurent la torture du soir
Ce dieu d’ivoire enchanteur qu’ils adorent et craignent
Et au soleil lointain qu’il est proscrit de voir
Meurtries de sa distance leurs implorations saignent
Les pleureurs savourent le supplice du soir
Apologie du silence ils ne peuvent rien dire
Pour seul verbe un murmure allusif des rameaux
Tient lieu de rumeur marine où le vent vient s’induire
Miroitement des pleurs écoulés mot à mot
La bulle bleue de la lune ensevelie dans l’âtre
Des hauteurs nocturnes où dorment les cieux blancs
Effleure pensivement d’une étoile bleuâtre
De l’argyronète le tissage tremblant
Les pleureurs voient l’étoile pâlir en son silence
Puis souffrir et mourir dans son charme recru
La bas comme un oiseau d’or prend l’essor en cadence
L’intouchable Celer voit son temps revenu
Les pleureurs voient l’étoile s’élever en silence
Mouvante promesse des saules qui s’étend
Double extension des couleurs que l’argent de l’eau fêle-
Il n’est rien à ravir au rouge de l’étang
Voici trompé le songe sanglant de l’anophèle
Reflet désintégré du roseau isolé
A cette heure les rêves grondent en leur tumulte
Ainsi dans le même or d’un halo ciselé
Vivante aurore les astres combattants s’occultent
Les pleureurs miroitent sous l’écho confident
Se peut il qu’à regretter des saules se consument
Tout est vain si le cœur n’est pas lamé d’argent
Au cœur de l’herbe aimantée vibre une étrange écume
Les pleureurs miroitent sous l’écho confident
L’onde au pied des troncs file une brume gracile
A peine enchanté son voile hors d’atteinte est perdu
Comme un lever de lune hors son écrin fragile
L’étrave des nénuphars guette un astre attendu
Au large des pensées où le verbe décline
L’onde poursuit son reflet au phosphore ébloui
Tout reste seul sans voir les aubes alcalines
Toujours le départ fait naître un sentiment d’oubli
Les pleureurs mourront là La nuit change son angle
Les phalènes s’essoufflent dans la fraîcheur de l’air
A force de pleurer les feuillages s’étranglent
Qui donc aura mémoire dans l’action d’un éclair
Des pleureurs morts sans vivre en un monde épris d’angles
Les saules sont trop tristes la vie coule si pâle
Les alucites dénouent ce songe sidéral
©hervehulin2022
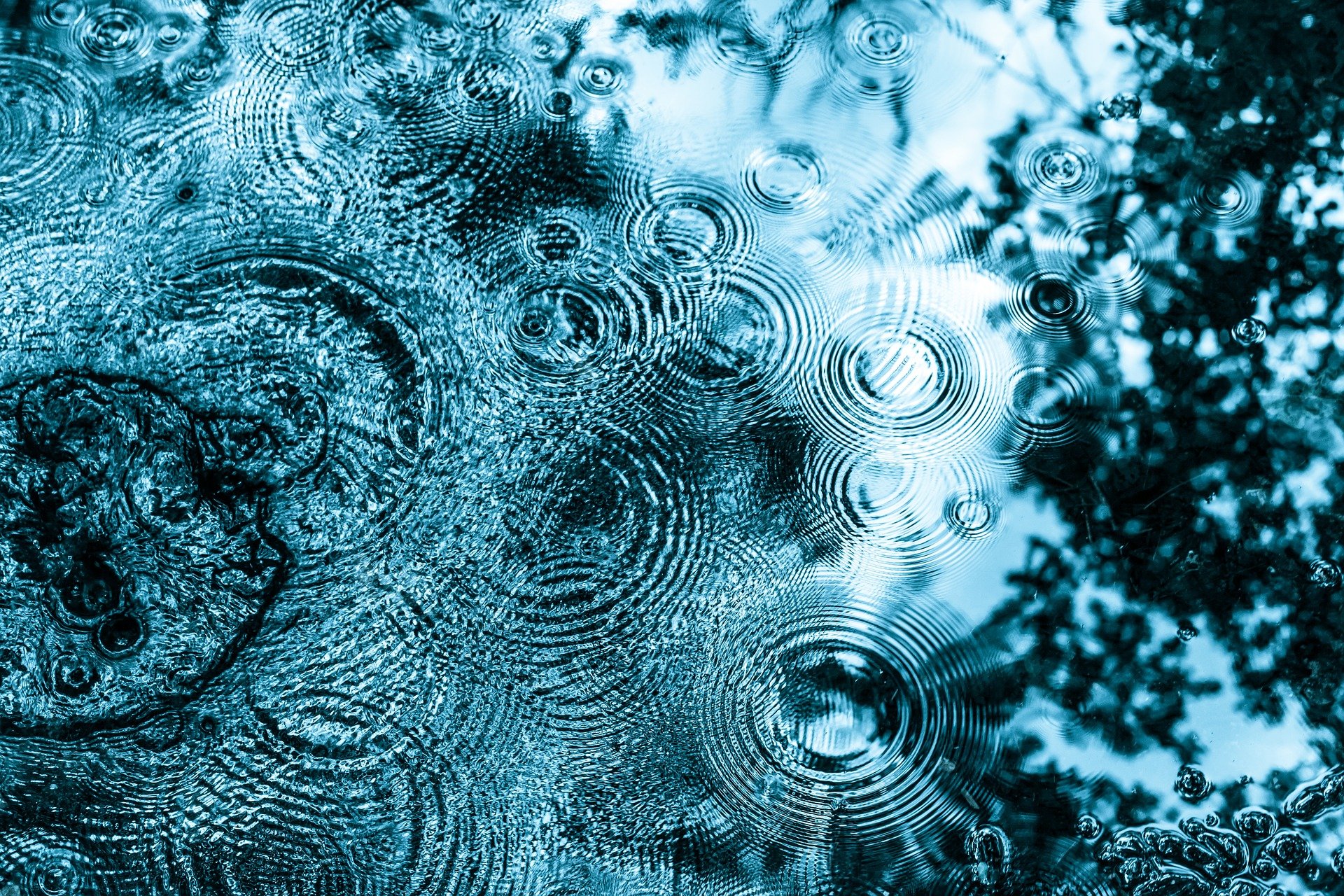
Des pluies sœurs de lune peuplent le ciel d’écume
Ce sont là de vastes fontaines en voyage
Des vastes navires en marche sur le monde
Des pluies couleurs de neige au bas du ciel d’écume
Voguent échevelées voguent et sonnent l’âge
Ainsi venu le temps, ainsi venu l’hiver,
Les neiges frileuses soulevèrent le nord
Un élancement de sable au salut blanc de l’aube
Elles quittaient la terre, en fumée, sans remords
Ces ondées nouvelles, ces tiédeurs soudaines
De mémoire d’homme, qui donc vit l’hiver en vol ?
Et ce furent des pluies, des pluies envers le songe
Sablier de brume pour accueillir la terre
Elle revenait, l’eau, sans mesure et première
C’est un noble retour dans le cœur vieux des hommes
Il tombe sur la ville un applaudissement
Des vents. N’était que ce bruit frêle comme est l’âme
Aux instants de pâleur, l’homme enfin confiant
Recueillerait demain aux formes découvertes
La tiédeur de l’effort comme l’or d’une flamme
Et chantent les pluies O sources génitives
Des pluies de mémoire, des pluies fauves et noires.
Au souffle des reflux celui de la défaite
La mer est en voyage et son courant se perd– Âme !
Tu n’es plus le miroir traversé de saisons
Où le rire des nuages fut l’orgueil du jour – Homme !
Où donc est ton silence ? Où donc est ta foi, où donc ta raison ?
Dans le train chagrin des âmes trahies
C’est un puissant désastre et que les pluies t’emportent !
Les augures du soir étaient beaux et menteurs
(Ils montrèrent l’astre promis
Le juste de l’honneur, l’orgueil des cités vertes
Un présage assuré dans l’éclat des fontaines)
Mais tout l’or du monde désespérait les songes
Comme femme en son voile l’aube restait promesse
Pluies fortes, pluies trompeuses ! Où est votre promesse ?
Sous la pourpre trempée des princes un mensonge
Toujours revint. Des pluies moqueuses, des pluies rouges
Marchaient comme un tambour au front d’armées sauvages
Rires dissolus des vainqueurs ! – Armes avivées d’éclairs !
Tout n’était que violence aux hommes sans mesures
Et le désert rendait cruels les chevaux mêmes
« Mais que reste-t-il donc du rire des fontaines ? »
Sauf l’antique blancheur des neiges si pures
Des cités éventrées, des peuples éclatées
Des arcs de pierre à genoux puis des vallées closes.
Là-bas comme un miroir d’hiver lègue à la terre
L’argent blanchi de ses névés
La lisière des eaux sur la pâleur des roses
Et mon rire n’est plus cette armure enneigée
Où je croyais enclos tous les vaisseaux du monde ;
La tristesse hume les embruns de sa présence
Je ne sais plus si l’âme est une aurore blonde
Où rien que ce guerrier qui compte les années
Qu’est devenue la grâce du silence souhaité ?
Et la pudeur de l’ombre au front des cités vertes ?
Mon cœur quelle est donc cette grâce qui trahit sa douceur ?
Au matin mûri d’attente
Voici que dessus la ville et le déclin des pierres
Dessus le jour, dessus l’orgueil des astres promis
Comme s’ouvre l’envol d’un millier de colombes
La nuée des anciennes promesses quitte le monde
Il pleut devant l’horizon des brumes
Des pluies sœurs de lune peuplent le ciel d’écume
Et c’est déjà l’heure qu’il faut choisir un monde
Y vivre et s’y soumettre et n’y rien regretter
Des neiges tant aimées du ciel O mon coeur
Sous la rumeur changeante que font les pluies du soir
D’où vient donc cette ondée qui éclaire un espoir?
©hervehulin2021

Echelle conoscopique: 6/10.
Ceux qui ont pu avoir la chance d’observer le léopard des neiges savent qu’en certaines circonstances, la beauté contemplée de la nature nous rend meilleurs. Ce félin si rare est peut-être le plus magnifique de son genre, et, en tout cas, le plus mythique. Peter Mathiessen, lors d’une longue expédition au Népal en 1973, l’a cherché pendant des semaines dans les altitudes de l’Himalaya. Il ne l’a pas trouvé. Et il s’en est trouvé heureux. Le secret du fauve était intact et vainqueur une fois de plus, de la curiosité humaine et ses vénérations faciles. Quasiment inobservable dans les hauteurs de son habitat ou la ténacité humaine se perd, l’animal garde une aura sans égal dans son univers. Seul son puissant cousin le tigre montre un charisme comparable.
Ce joyau disparaît comme le monde qu’il habite. Sa beauté devient un songe.
Lisez-ça :
« Ce fut une apparition religieuse. Aujourd’hui, le souvenir de cette vision revêt en moi un caractère sacré. Elle levait la tête, humait l’air. Elle portait l’héraldique d’un paysage tibétain. Son pelage, marqueterie d’or et de bronze, appartenait au jour, à la nuit, au ciel, à la terre. Elle avait pris les crêtes, les névés, les ombres de la gorge et le cristal du ciel, l’automne des versants et la neige éternelle, les épines des pentes et les buissons d’armoise, le secret des orages et des nuées d’argent, l’or des steppes et le linceul des glaces, l’agonie des mouflons et le sang des chamois. Elle vivait sous la toison du monde. Elle était habillée de représentations. La panthère, esprit des neiges, s’était vêtue avec la Terre. »
Sylvain Tesson. La panthère des neiges. Gallimard. p 106.
Alors, voilà, les rois des royaumes finissants se font les présents qu’ils peuvent. En 1975, Juan Carlos 1errétablissait la démocratie en Espagne. Cette action noble n’autorisait pas cependant à faire n’importe quoi et se parer avec la mort d’un univers. Le roi d’Espagne aurait pu refuser ce magnifique manteau fourré en léopard des neiges (espèce protégée par les accords internationaux Cites), cadeau fait par Noursoultan Nazarbaïev, président du Kazakhstan, en 1998. Il ne l’a pas fait.
©hervehulin2021

Gnathon aime sa personne, et elle le lui rend bien. Souvent, on l’invite, on l’appelle, lui-même, sa belle personne, et tout son attirail. Ses costumes taillés en tissu italien, ses cravates fleuries, tantôt sa mini-voiture sport, tantôt son scooter avec sono intégrée, son téléphone dernier modèle, ses gadgets. Vient-il dîner ce soir ? On l’attend, il tarde, mais juste ce qu’il faut pour qu’on s’impatiente un peu mais qu’on ne s’agace point. Il arrive juste quand tous les convives sont déjà là et ont pris le temps, pas une minute de plus, de se dire à voix haute : « Où est Gnathon ? Que fait-il donc ? Viendra-t-il ce soir ? ». Le voici, enfin, on l’entend dans l’escalier, puis sur le seuil. Il amuse en ne sonnant pas, mais frappe fort sur le bois de la porte « police des mœurs ! » hurle-t-il, et tous s’esclaffent, sauf un ou eux, qui le connaissent moins. Il fait alors son entrée, et ne se prend pas de fatigue à aller jusqu’au bout des salutations. Dès la troisième poignée de mains, il se tourne vers la salle à manger, et clame : « quand est-ce qu’on mange ? je tombe, je meurs ! » On rit. A table, il se place tout seul, au centre. Il se sert et parle en même temps. Il raconte sa journée, moque ses collègues, ses clients, il cite les noms comme si chacun les connaissait comme lui, et ne s’occupe pas d’écouter les autres. Quand seule sa personne est son sujet, son registre ne cesse d’être comique ; quand ce sujet est d’une autre, qui voudrait bien placer qu’elle existe, notre Gnathon devient grave et le ton est sévère. Quand la conversation lui échappe un peu, il ponctue de sonores : « Ah bon, Non ? N’importe quoi ? vous y croyez, ça ? » et en récupère le fil. Et il passe vite à autre chose. Il raconte encore, et coupe la parole pour substituer au plus vite, son histoire à celle d’une autre qui commençait, son opinion à celui-ci qui entendait exprimer la sienne. Parfois, il interroge un invité, n’écoute jamais la réponse. Quand il mange, il parle, sans cesser de mâcher ni prendre la peine d’avaler. Il parle tout le temps, de tout, sur tout, il parle tout seul. Il fait bien du bruit en mangeant, en buvant, pioche dans le plat de viande avec sa fourchette, coupe le fromage avec son couteau, lèche la cuillère des îles flottantes et la rejette dans le plat. Il vide son verre, englouti le vieux Corton à bonnes goulées, puis souffle fort, et le tend à nouveau pour qu’on le resserve très vite. Le moment prend fin, Gnathon est fatigué, les invités sont partis. Il se ressert du café, mais plus personne pour l’entendre… Salue ses hôtes, plaisante que l’adresse est bonne et qu’il reviendra. Il s’en va laissant dans son sillage la nuée discrète d’un soulagement. Mais peu importe. Il sait et ne doute pas, qu’on le réinvitera, dans peu de temps. Lui et tout son attirail, son verbe haut, sa gloire apparente, son triomphe concentrique et son appétit sans faille d’être ce qu’il est.
©hervehulin

C’est une bien étrange constante de notre temps et de notre peuple que cette passion de se clamer dans la conversation le meilleur ministre de toute chose. Qu’une guerre éclate aux antipodes, qu’un déluge ou une épidémie se déchaînent, qu’une nouvelle loi déchire la société, voici que sans appel et sans délai chacun se met en tête de régler l’affaire qui gronde. Et nos gouvernements, quelle qu’en soit la couleur, sont soudain réduits au profil d’une puissance hostile, poussée par des intérêts occultes, dont le grand dessein est de nuire à tous. La solution qui nous gouverne ne sera jamais la bonne. A la terrasse de son café familier, dans le fauteuil de son séjour, un verre de vin blanc à la main et ses amis ou sa famille disposés en arc autour de sa personne, notre citoyen égrène les réponses faciles qu’une juste et saine politique aurait dû produire.
Ariste est bien installé dans son propos, il règle en bonne compagnie la question du chômage de masse. Il suffirait de ceci, et de décider une fois pour toute que cela est ainsi, et montre qu’il faut voir les choses comme ça. Et voilà tout, ce n’est pas compliqué, mais que voulez-vous, ceux qui gouvernent la France sont des ânes, et ils n’ont pas saisi cette vérité première. Et voici Cléon, qui traite la gigantesque question de l’effondrement du climat. Qu’on l’écoute et le laisse agir, et le genre humain s’en portera mieux. Les choses sont pourtant simples, si les autorités pouvaient l’entendre, il n’y a qu’à faire une loi qui prescrirait ceci et non pas cela, au contraire de ce qu’a entrepris ce pauvre gouvernement qui fait bien fausse route depuis le début, ou du moins, depuis qu’on en parle ; et d’ailleurs, il y a bien des choses dont on ne parle pas, de façon fort volontaire, on le sait bien car tant de causes nous sont cachées, pour qu’on n’en saisisse pas la clé; somme toute, cette affaire de climat qui se réchauffe, c’est bien plutôt la question d’un mauvais gouvernement. Et Léandre, voyez comme il a tant d’idées justes pour rendre définitivement soluble cette terrible problématique des migrants ; il suffirait de faire ainsi, et il n’y a qu’à, une fois pour toute, faire en sorte que voilà, et le sort de ces pauvres gens sera établi, et celui des autres enfin soulagé. Il n’y a pas d’explications autre que l’idiotie de nos princes et de leurs armées de complices, tout verrouillés qu’ils sont dans le système qui les fait tourner sans fin, à cette situation qui nous fait déferler sur nos rivages des hordes de miséreux, pas toujours innocents, il faut bien le dire ; et notre Léandre, lui, n’a pas peur de le dire, d’autant plus qu’en toute circonstance, sa conviction citoyenne procède d’abord du fait qu’il a raison.
Après avoir retourné les problèmes de sa nation une fois pour toute, Ariste est en difficulté devant son écran, les rubriques de sa déclaration d’impôts en ligne ne lui parlent pas, il n’en saisit rien de l’ordonnancement, au point d’en perdre le sommeil; Cléon est vaincu, abattu même par cet étroit dégâts des eaux de la cuisine, après qu’il a constaté que sa police ne l’assurait pas contre ce drame, pour la seule raison qu’il s’est trompé de clause au moment de la signature; et notre Léandre, impuissant face aux coups de la fortune contre son foyer, succombe à l’adversité de ses propres dépenses qui ont mis sans prévenir son compte en banque en grand découvert.
Ainsi la vie simple de l’univers domestique surprend le sort de la nation, l’ébranle et le domine. Ces grands politiques qui entendaient soulager le peuple de ses soucis, mettent soudain genoux en terre. Pourtant, ces contrariétés sont toutes normales. Toujours face aux petites affaires sombrent les grands hommes d ‘État.

Qui es-tu, Dorinte ? Te connait-t-on véritablement, toi qui toujours bouge au premier plan ? Tu parles et agis sans cesse, et toujours au travail. Ton labeur te met toujours en mouvement. Tu es là et ailleurs, partout où se porte le regard de ceux qui t’approchent. Tu occupes le temps et l’espace. On te voit sans cesse avec un dossier, agitant des papiers, l’œil vissé à l’écran de ton ordinateur, et quand tu n’es pas soudée à ton bureau, tu l’es à ton portable. Quand tu ris, c’est d’une histoire survenue à un collègue, dans son bureau ; quand tu racontes, c’est une réunion, et quand tu te moques, c’est de la cravate d’Argan du service comptable, ou la récente coiffure de Doramène à la banque d’accueil. Tu passes dans la rue, c’est en scrutant des pages, en téléphonant à voix très haute, et on t’entend régler vite fait le problème de la salle du congrès, comme celui de la clôture budgétaire, le contrat du nouveau stagiaire et n’oublions pas le client mécontent que tu as rattrapé d’un seul appel, entre Bastille et République. Tu ne vis pas dans le travail, Dorinte. Tu es le travail ; tu incarne l’ambition et la carrière. L’énergie et la considération. Mais pourquoi donc es-tu si indispensable ? Mais quel est ton travail, Dorinte ? Nul ne saurait le dire, parmi tous ceux que ton spectacle afflige chaque jour. Toi-même, connais-tu la direction que cette vie, choisie, t’impose?

Mauve et tranquille
Figé dans son reflet
Le soir comme un songe essoufflé
De l’étang ravit le miroir
Et moi j’envie le soir
Je suis le porteur d’eau
L’ombre ployée qu’effleurent les roseaux
Mon échine lasse et docile
Epouse le tracé courbe des saules
La lourde jarre hissée à mon épaule
Chantonne combien nous sommes fragiles
Combien nous sommes fragiles
Nos jours sont d’un sable indocile
Comme le soleil tremble au fond de l’eau dormante
Le temps que nous volons est une arche d’argile
Une idole pensive au regard qui s’absente
Le soir dans l’eau sombre son halo s’annihile
Et moi cristal rêveur j’envie le soir qui passe
Je hume le rivage et sa fraîcheur facile
Je pense aux hommes las que la vieillesse enlace
Ou rend sage je rêve de soleils graciles
Et tremblant d’amour au tréfonds de l’eau froide
Je pense aux fleurs d’eau que la jarre tient captives
Quand pourrais-je vivre en chair mes désirades
Je suis le porteur d’eau et l’âme est fugitive
©hervehulin2021

Un homme de caractère est celui qui avance et parle en même temps, qui ne craint pas en toute circonstance, d’opposer son point de vue à celui des autres, quitte à s’envoler d’une voix forte et avec gestes des mains pour souligner l’ardeur du propos ; celui qui interrompt, dispute, mais décide ce qui convient ; qui écoute mais jamais trop longtemps, pour toujours conclure devant un auditoire hébété, qui exprime avec des mots qu’on croit plutôt rares, sans affèteries, qui sait punir et remontrer, mais on en dira que c’est juste. Celui qui attire, qui inspire, et qui reflète. Il est celui qui impose par son geste et son discours inlassables. Il rapporte bien des paroles qu’il a échangées avec des puissants, il en abreuve ses amis, ses collègues. En Ville, au travail, et parfois même en famille, il ne cesse d’affirmer. C’est un homme qui dit, et qui sait toujours.
Une femme insupportable est celle qui se comporte de même dans le monde et fait exactement tout cela. Mais c’est une femme.
©hervehulin2021

Regardez Cléante, comme il est rivé sur son ordinateur ; son jeune âge, sa myopie et son teint pâle ne peuvent vous abuser. C’est un mage, le cliquetis de son clavier est en train de transformer l’univers, ses pouvoirs sont redoutables.
Ce drôle de travers dans lequel a sombré notre temps veut que chacun ait désormais le pouvoir de produire sa vérité sur toutes les affaires actuelles ou anciennes du monde. De nouveaux moyens le permettent, à exploiter sans modération. Prodige de la distance et de l’internet. Il suffit d’ouvrir un compte via un écran lumineux, derrière lequel des mots et des images sont doués d’une animation autonome. De s’offrir un faux nom, de préférence ridicule mais qui sonne bien.
Et voilà tout ce qui autorise à nier que l’homme a bien marché sur la lune, qu’il a bel et bien existé des dinosaures à l’origine des espèces, que six millions de juifs ont été assassinés en masse pour la seule raison qu’ils étaient juifs, que notre terre est bien ronde, ou encore qu’un virus a bien abîmé notre civilisation tout entière en ce début de siècle. Le doute d’abord, puis de nouveau le doute, et enfin, le mensonge, ainsi envoyés par brèves secousses, rencontrent quelques milliers de lectures, qui vont chacune servir à transmettre la chose à quelques milliers d’autres, jusqu’à ce que le nombre contaminé atteigne un si volumineux écho que la vérité antérieure s’amenuise, perde son éclat, et se laisse ainsi recouvrir, privée de ses immunités. C’est une vaste énergie que la faiblesse de l’esprit a ainsi exhalée. L’ignorance, prenant une écrasante revanche sur le travail ardu de la connaissance, est désormais si puissante de son obésité sans limite, qu’elle peut substituer sa couleur criarde aux tons très agencés de l’histoire. La vérité n’est plus le projet du savoir, ou la destinée de la philosophie, ou le sel de la sagesse. C’est un droit individuel, plus encore, une jouissance, sans frais de surcroît, dont il serait idiot de se priver. Un mot, une image, répétés à satiété, et voilà une apparition qui change l’ordre du monde sans combat ni révolution. La vague roule et enfle à chaque battement, elle roule autour de la terre et prend bientôt de l’océan, le souffle et l’horizon. Dans l’instantané d’une rumeur solide le monde se transforme d’un battement de cil. Des êtres apparaissent, d’autres très anciens s’évanouissent. Des siècles se recomposent, d’autres se disloquent. Des continents sont redessinés. Les coupables d’hier deviennent les victimes d’aujourd’hui. Des noms sont damnés et d’autres bénis ; des statues sont abattues, des temples invisibles se dressent tout seuls, sans même la main de l’homme. Sous le seul reflet pâle des croyances, des fantômes apparaissent et de nouveaux dieux naissent sous nos yeux. Des sortilèges aveuglants, d’un souffle, effacent les cités millénaires. Les circuits numériques tissent un empire sans contour. Plus encore qu’un empire, c’est un nouvel âge qui commence, peu soucieux de raison – cette raison assommante depuis des siècles – et nourri de sa propre invention. Un âge d’argile, un âge vraiment moyen.
Regardez Cléante, comme il écrit avec vigueur sur son clavier. Certes, il a la vue basse, à force de fixer son écran. Il traque les intentions secrètes des puissants qui s’accrochent à l’ordre du monde visible. Il serre les dents, en secrétant, un peu endolori, encore une nouvelle vérité. Personne ne l’arrêtera dans son œuvre de déconstruction ardente. Le monde est à lui. Voilà, ça claque sur la touche Entrée, et s’envole une pensée qui va bouleverser les anciens systèmes. L’horizon bascule. Tremblons, amis des arts et des lettres. Prosternez-vous. Voici revenu sans partage, le temps de la magie, où les sorciers sont inquisiteurs en même temps.
©hervehulin2021

Arsinia a de l’esprit, mais il est assassin. Elle n’aime personne semble-t-il, et montre en toute circonstance l’usage de dire du mal de tous. Son jugement est sur le fonds toujours égal. Sitôt qu’on cite un nom dans la conversation, elle envoie tout sourire son avis avant même qu’on ait pensé à lui demander. Chez elle c’est une nature, et elle manifeste un réel talent ; son verbe est alors imagé, orné de formules pertinentes, et bien sûr de conclusions fatales. Écoutez-la.
Celle-ci ? Son bavardage brillant cache en réalité un complexe douloureux envers les hommes, qu’elle n’a sans doute, malgré son âge, jamais connus. Et celle-là ? Elle occupe certes une place importante dans cette hiérarchie, et fait preuve de belles qualités au travail ; mais regardez bien la justesse et le moulant de ses jupes, et vous saurez comment elle a obtenu ce poste, à la place de tel autre à qui il était promis, paraît-il : ceci de source sûre, d’ailleurs c’est au cinquième étage qu’on lui a dit, vous voyez bien d’où ça vient, c’est du solide.
Celui-ci ? C’est un fait qu’il est très apprécié mais Arsinia a eu des échos, de gens qui travaillent dans son équipe, et c’est un autre fait que ça ne se passe pas bien du tout, il n’est pas à la hauteur ; d’ailleurs, c’est celui-ci même dont elle vous parle qui ne lui a pas caché, pas plus tard que l’autre jour à la cantine, qu’il prenait des antidépresseurs pour essayer d’encaisser la charge de responsabilités de ses fonctions. Et celui-là ? De source sûre – son épouse pour tout dire, avec qui on est très amie – son amabilité notoire peut étonner car chez lui, il est souvent violent et très jaloux, et il y aurait même quelque soupçon d’addiction à la boisson, mais ça, ce ne sont que des rumeurs.
Arsinia empoisonne même ceux et celles qu’elle imagine bien aimer. De Philinte, elle soutient avec vigueur que c’est un garçon admirable, un esprit fin et toujours d’humeur égale, avec qui c’est un vrai plaisir de converser en toute affinité ; mais ce garçon formidable ne travaille pas, il faut bien le dire, il n’occupe pas un véritable poste, il ne fait rien, et on l’a mis là parce qu’on ne savait qu’en faire et qu’il n’était plus capable de progresser. Et de Phyllis, qui est vraiment d’une rare intelligence, et assurément une des toutes premières compétences financières de la maison – sans doute la première – on doit reconnaître, cent fois hélas pour elle, qu’elle n’y arrive pas, elle est complètement dépassée par le niveau relevé de ces tâches, la malheureuse; d’ailleurs, il y a de grosses tensions avec sa hiérarchie, et il est fort probable qu’elle ne conserve pas ses fonctions d’ici la fin de l’année, c’est ce qui se répète sous la main, au cinquième étage toujours . Et d’Alcmène, que peut-elle en dire ? Rien de mauvais, car Alcmène est une admirable personne, une incroyable travailleuse, si ce n’est que son seul drame est d’être terriblement seule dans sa vie, depuis toujours, sans amour et sans amitié, ne le saviez-vous pas ?
Les esprits médiocres ont pour nature de s’inventer une forme d’immunité dans la médisance. C’est un art de ne pas aimer les gens avec qui on parle, on travaille, on vit, ou, tout simplement, on partage la terre et son espace. Il mobilise du talent, de l’innovation et de la constance. Arsinia n’aime personne semble-t-il, et certainement pas elle-même. Chacun est habitué à son débit, si bien qu’on écoute, comme une antique rivière à présent polluée, Arsinia charrier sans ralentir ses limons infectés.
Mais comme tout un chacun dans n’importe quelle collectivité d’individus, elle aimerait tant être aimée. Et c’est aussi un art que d’être détestée de tous. Ceux qui brillent dans cet art-là seront toujours experts dans cet art-ci.
©hervehulin2021

Théramène encore enfant, avait rêvé sinon d’être riche, du moins d’avoir assez pour ne pas compter et s’offrir ce qu’il voudrait. Pour cela, il a étude bien, travaille bien, avance biné ; de la sorte que jeune déjà, il a accède à un bel emploi ; assez vite il y excelle, et sa rémunération lui permet de bien jouir de la vie à cet âge qui la croque avec envie. Il se vêt avec goût, profite de bien des spectacles, et, autant que possible à cette échelle, peut séduire des amis et des femmes. Mais très vite, il lui paraît que cet emploi reste étroit, et qu’il a envie d’accroître ses ressources, pour vivre encore plus et mieux. Sa ligne est alors simplement bornée : gagner deux fois plus que ce qu’il gagne alors, point. Il fait tout pour mener à bien cette ambition, à l’âge ou la jeunesse croise un peu de maturité. Il cherche, fait quelques candidatures et, toujours heureux dans son chemin, trouve ce qu’il veut. Un nouvel emploi lui double en quelques années son revenu ; il en profite tout autant qu’avant, mais se sent vite à l’étroit. Il prend goût, voyez-vous, aux voyages, aux beaux magasins, et n’est restaurant pour lui que celui qui lui mange un dixième de son salaire en un seul repas. Et c’est bien comme ça. A ce moment de son existence, ne récolter que deux fois plus lui paraît une perspective sage, et accessible. Pas question de ne pas vivre à force d’ambition et de travail. Mais en travaillant toujours mieux et un peu plus, et consacrant plus de temps à sa carrière, le voici qui monte encore dans la hiérarchie de son métier. Son revenu suit bien évidemment, et lui ouvre encore de nouveaux horizons. Ses voyages sont plus lointains, puis plus luxueux ; ses loisirs avancent dans les mêmes proportions. Au théâtre, à l’opéra, il ne choisit que les sièges en carré or. Mais soutenir ce train exige vite quelques sacrifices ; ses horaires de labeur s’étirent encore sur sa vie, il quitte très souvent quand il ne fait plus jour ; d’ailleurs, ceci lui plait assez, il en est d’autant respecté de ses confrères, et surtout de ses collaborateurs. Ses amis vantent sa réussite. Un jour, arrive bien ce qui doit arriver : sa direction lui offre un poste plus élevé encore, mieux payé encore- soit le double ou presque. Il sait qu’il faudra s’y livrer plus absolument que ses précédentes années ; mais le prestige et le salaire en valent plus que la peine. D’ailleurs, on s’arrêtera là. N’a t-il pas déjà deux fois doublé ses gains au travail ? Plus besoin d’avancer ni de gagner plus. Bien sûr, il a moins de temps possible pour dépenser ses puissants revenus, qui font souvent pâlir autour de lui ; mais ces rares moment n’en sont que plus appréciables. Les dîners qu’il offre sont entièrement produits des meilleurs traiteurs. Ses maîtresses, bien que parfois lassées de le rencontrer si peu, et de le connaitre moins encore, ne se lassent jamais avant qu’il leur ait offert de coûteux bijoux. Ses voyages baignent alors, à ce moment de sa vie, dans un luxe aveuglant. Son appartement dans le cœur de Paris est celui dont tout le monde rêve. Les meilleurs médecins protègent sa santé, les clubs de golf les plus chers lui donnent le sport dont il a besoin. C’est un couronnement. Voici que le temps s’acheminant, Théramène commence à s’occuper de sa retraite ; pour garantir un niveau suffisant au maintien de ses plaisirs qui l’ont toute sa vie accompagné, un nouvel – et ultime- échelon lui semble indispensable. Car à quoi bon la retraite, si nulle ressource pour en jouir comme il convient ? Il ne se contentera que de peu de chose mais ne veut pas perdre de moyens. Surtout pas percevoir plus, mais au moins maintenir un palier comparable. Alors voilà, il fait connaitre son vœu, rassemble ses relations influentes, il manigance un peu – à ce moment de sa vie, il est bien connaisseur des pratiques requises, et très habile à ce jeu depuis toutes ces années – et il atterrit directeur général ou quelque chose d’approchant. L’apogée. Son salaire encore gonfle, cette fois, non par ambition, mais simplement pour continuer à vivre semblablement ; de dîners, des séjours, des costumes encore plus fabuleux. Quel bonheur de si bien gagner sa vie, et de ne même plus savoir ce qu’on donne comme impôts !
Mais les dernières années de cette vie filent très vite, engloutis par les responsabilités et leurs insatiables commandements.
A présent, voici que vient le premier jour de cette retraite attendue au terme d’un si glorieux parcours. Le compte en banque garantit de beaux moments. Théramène est donc chez lui, seul, oisif enfin, le front contre la baie vitrée du grand salon ; la belle vue sur Paris est décolorée sous la pluie de novembre. Il se dit qu’il est bien tard. Il aura réussi de passer toute sa vie à doubler son salaire, à monter l’escalier, à consumer son esprit à cette ambition, sans avoir vraiment commencé d’avoir vécu.
©hervehulin2021
Pourquoi les hommes se font-ils la guerre ? Pourquoi donc cette éternelle passion de ravager son semblable, de briser ce miroir de lui-même ?
Beaucoup font la guerre pour leurs dieux, leur culte, leurs idoles ; pour protéger leur république, ou étendre leur empire ; pour exterminer tout un peuple, ou se préserver de l’extinction. (suite…)
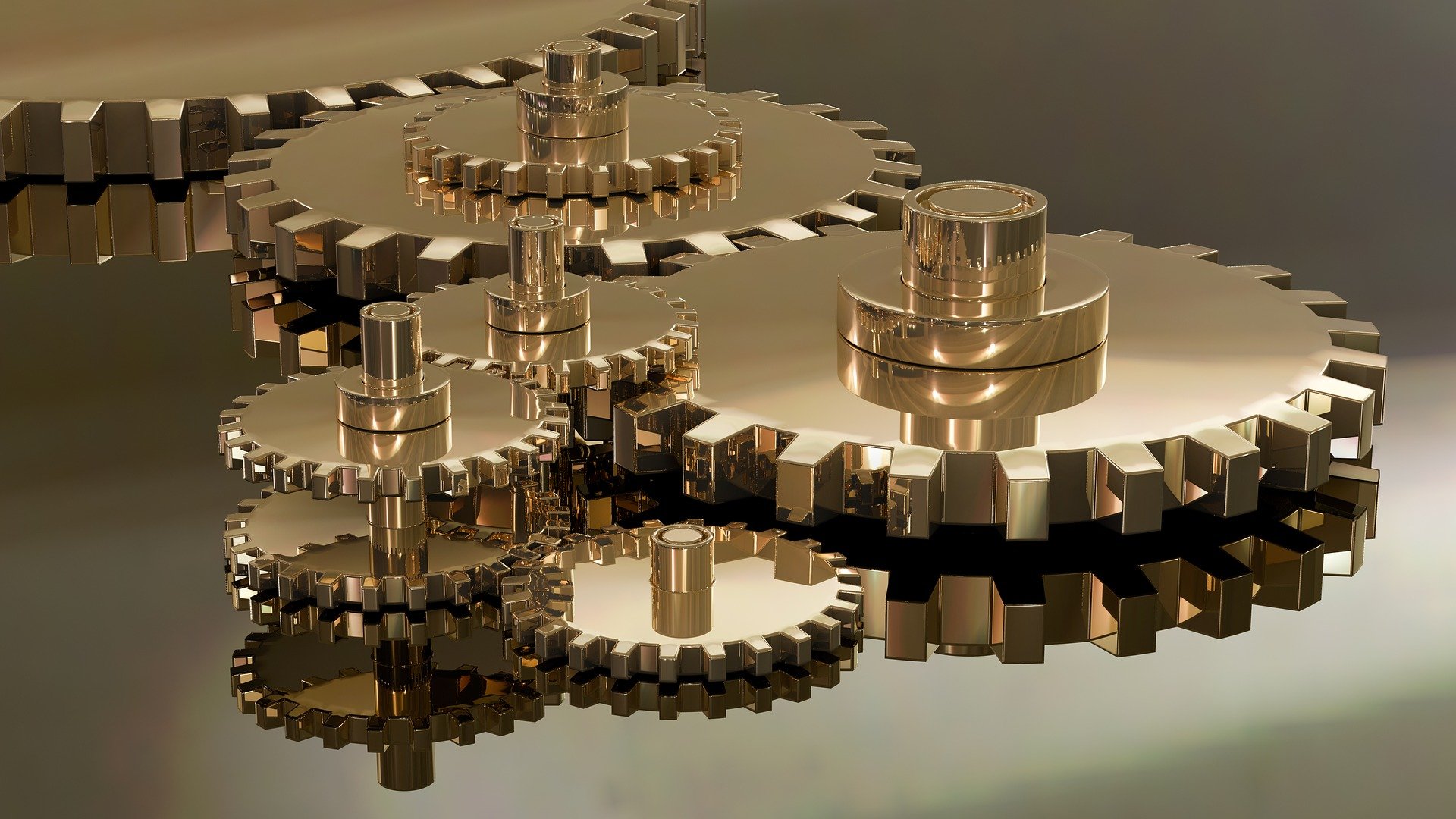
Alcibiade est un citoyen politique, élu du peuple. Il travaille, sans compter son ardeur, pour l’intérêt général. De celui-ci, il a l’instinct et l’ambition. Cette ambition qui le porte et le façonne. A l’Assemblée, il propose et interpelle sans lasser. Il est souvent vu dans les rues, sur les places, sur les marchés, partout dans les espaces où la vie publique se joue, partout où son mandat l’appelle. Bien des gens vont au-devant de lui sitôt qu’il se montre, lui serrent la main, et lui parlent d’eux et de leurs affaires. Tantôt il interroge, tantôt il répond. (suite…)

Clitandre est réputé d’un faible caractère. Il ne s’oppose point en toute circonstance à ceux qui parlent fort et condamnent les personnalités de la vie publique en trois ou quatre mots pas plus ; il n’aime pas les conflits et parle souvent d’un ton modéré ; il semble apprécier la mesure, et le compromis. La polémique le lasse, il préfère écouter les propos que les briser. (suite…)
A mesure que l’âge avance, que les bienfaits de la fortune et les faveurs de la vie se retirent d’un homme dont la grande élévation le disputait à la haute notoriété, apparaissent sur la surface de l’étiage qui peu à peu, dans le fil des années, se découvre, les traces des actes passés et toute sorte de matière anciennes, tristes et pâles, déformées par les scrupules et les regrets, consumées par les joies enfuies, et qui s’offrent au regard une dernière fois, juste le temps que le sable les absorbe, à tout jamais.
©hervehulin2021
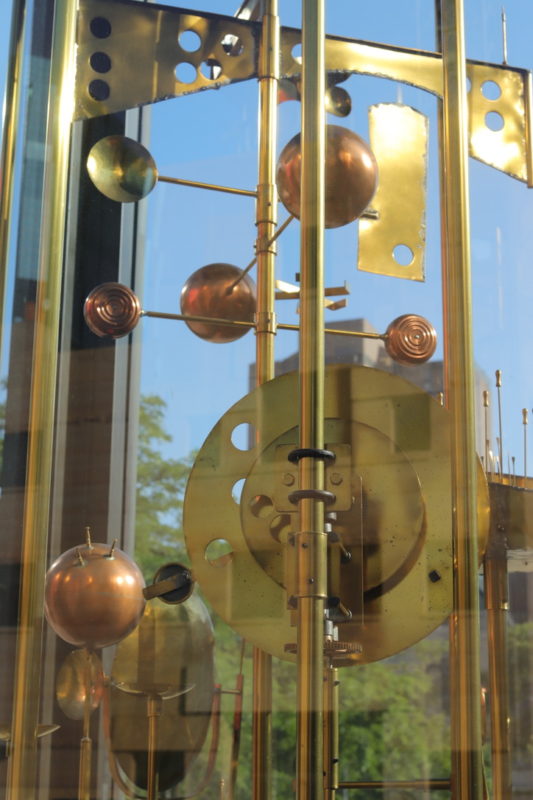
Zélie est jeune, est intelligente, et ses succès dans les études le prouvent. Elle a réussi bien des épreuves et le niveau de ses notes, depuis qu’elle est entrée à l’école, toujours proche des sommets, n’a jamais fléchi. En toute circonstances, elle a montré des facilités à comprendre et partager ses connaissances. Elle a souvent impressionné ses professeurs, et ses camarades toujours. Zélie manifeste des déductions étonnantes, et elle sait produire des idées puissantes. Tous lui prédisent un bel avenir, et une merveilleuse carrière. Elle dominera facilement les plus hauts concours, se jouera des sélections. Elle exercera des responsabilités dans le meilleur monde, elle contribuera aux décisions des élites, celles qui orientent le sort des sociétés. De grandes découvertes de la science sont peut-être à sa portée, ou encore des solutions économiques sans précédent.
Alors, à présent presque adulte et sûre de ses capacités, elle s’engage sur le seuil des grandes écoles. De la plus prestigieuse d’entre toutes, elle affronte aujourd’hui la première des épreuves écrites. La gorge un peu serrée, le cœur battant, dans la grande salle où des centaines de jeunes gens sont rivés aux petites tables d’examens, rigoureusement alignées, elle scrute, sitôt distribué, le feuillet du premier sujet de mathématique.
Immédiatement, tout autour d’elle, au tréfonds d’elle-même, l’univers s’effondre, et avec lui toute la courbe d’un si bel avenir. Des projets encore vivants il y a une poignée d’instants, ne palpite plus guère qu’un champ de ruine. Zélie sort de la salle, elle sait que jamais elle ne reviendra en arrière. D’un coup d’œil elle a compris. Avec cette belle et vive intelligence qui l’a portée depuis son enfance, elle a jugé en une seule seconde cette équation hors de sa portée. La loi des mathématiques, à qui nous remettons le soin de choisir les meilleurs, a commis ce jour un mauvais choix fatal. Une découverte indispensable à la solution du cancer ne sera jamais inventée. Ainsi un x trop secret a bousculé la trajectoire d’un bel avenir, et avec, tout le progrès d’une société.
©hervehulin2021

Démophile est partisan absolument de la République ; mais la nôtre, soutient-il, n’est pas celle qui convient, elle est farcie de défauts, de pesanteurs, d’inégalités accablantes, et son régime est incapable de satisfaire le peuple, qui reste trop loin d’elle. Elle ne vaut rien. Ce qui lui faut, à cette république, c’est un homme fort, une véritable poigne, et surtout, de l’ordre. Il est un démocrate convaincu ; mais il faut bien le dire, pour peu qu’on dispose encore d’un peu de bon sens, que cette démocratie est finie, et tous ses dignitaires sont des bons à rien, ses élites sont moisies jusqu’au noyau ; les élections en sont inutiles, et lui-même ne se dérange plus pour voter depuis un bon moment. Il est tout autant pour l’Europe, sans concession, mais pas cette Europe-ci, qui est loin de tout et n’entend rien à la cause vraie des nations. Il faut une autre Europe, une vraie, sa conviction sur ce point ne bougera plus. Il est engagé sans réserve sur l’écologie ; mais pas cette écologie qui ne veut que nous punir encore, et n’a d’autre but que nous gêner dans la vie, nous empêcher d’utiliser la bagnole et le lave-vaisselle autant qu’on le souhaite. Il est même fondamentalement pour l’impôt, et nul n’en sera surpris, car la contribution fiscale est un acte citoyen plein et entier, le fondement du contrat social ; mais il n’est pas pour ses impôts à lui, plutôt ceux de ses voisins, car lui paye bien assez comme cela et il en est lassé. Il est pour toute sorte de réformes, mais pas ces réformes qui s’imposent sans qu’on les demande, et qui changent tout le temps plein de choses à vous mettre en permanence les dessus à la place des dessous. Démophile est hostile à ce qui est, mais favorable à ce qui n’est pas. Démophile est français, vous l’aviez compris.
©hervehulin2021

Il y a des livres comme des personnalités. Ce sont des rencontres dans la vie d’un lecteur, dont certaines s’effacent, mais d’autres jamais. On les découvre, on les apprécie. Et vient un moment qu’on ne les oublie plus, et qu’on a hâte de les retrouver, qu’on a le besoin d’en nourrir sa mémoire.
Lamartine est resté un auteur sous-estimé probablement dans les lettres françaises, et dans le goût dominant des lettrés. Il reste l’auteur du Lac, et un poète romantique contemplatif, plutôt bourgeois. Son échec cinglant lors de l’élection présidentielle en 1848 a réduit la notoriété de sa carrière politique au dérisoire. C’est un juste rêveur, un mièvre, une sorte de notable poète.
Pourtant, Rimbaud le désigna comme le premier « voyant » de la poésie contemporaine (certes, « trop enfermé dans la forme vieille »). Sans trop d’écho, des hommes d’État progressistes se revendiqueront de lui, comme Pierre Mendès-France ou François Mitterrand.
Il aura été un humaniste inaltérable, et on le verra bien, dans ce long Voyage, toujours attentif au sort de l’autre, toujours voyant (au sens Rimbaud du terme) un homme ou une femme là ou d’autres de son temps n’auraient vu qu’une couleur de peau ou une religion lointaine.
En 1831, Lamartine entreprend donc ce qui, plus qu’un voyage comme l’annonce modestement le titre, est une véritable expédition, où il laissera d’ailleurs l’essentiel de sa fortune. Il loue pour deux ans un brick complet avec équipage, – puis un second, pour des motifs tragiques -emmène des amis, plus de cinq-cents livres, son épouse, et, pour son malheur, sa fille, Julia. Car Lamartine est un notable, une célébrité : un nombreux comité se réunit sur le quai de Marseille, auquel se joint vite une foule joyeuse, pour saluer son départ en grand pompe. Là-bas, dans son périple, à Jérusalem, Damas, Constantinople, son nom seul lui vaut d’être accueilli et protégé par des puissants, qui lui ouvrent les portes fermées à d’autres que lui, produisent des recommandations, voire des escortes armées. Nerval, lui, plus romantique et mystique encore partira et accomplira le voyage seul.
Lamartine est en phase absolue avec ce monde de l’orient, ce foisonnement d’hommes et de couleurs, de pensées étranges, ce monde de souks, de couleurs, d’épices, et parfois d’esclaves, mais de mosquées et d’églises, d’hospitalités sans faille et de sectes anciennes. « Je suis né oriental et je mourrai tel. Une vie tour à tour poétique, religieuse, héroïque, ou rien ». Il en porte la passion en lui et la transcrit à chaque page, dans une langue claire et jamais apprêtée. De l’aquarelle…Cette passion brûlante pour ces terres, ces peuples, ne s’attiédit jamais au cours du miller de pages de l’ouvrage, dont le flux reste doux et soutenu.
Tout au long de ces deux années, Lamartine écrit sur un mode varié, qui tout en suivant le fil d’un journal, regroupe des thèmes (« peuplades du Liban », « Ruines de Balbek ») des épisodes (« visite au Pacha » « Récit du séjour de Fatallah Sayeghir ») et des lieux (« Jérusalem », « Damas » « Constantinople »). On s’y arrête de temps en temps pour des contemplations de paysages lumineuses, qui déploient les formidables qualités de styliste de notre Lamartine (n’oublions pas que c’est son premier ouvrage en prose). Des paysages si colorés qu’on les lit et les relit. Il arrête souvent son infatigable regard sur les hommes et les femmes, portraits du Pacha d’Égypte, comme des humbles peuplant les ruelles ; la longue description du marché aux esclaves de Constantinople est à cet égard un beau moment de littérature, ou s’entremêlent la compassion du voyageur et le regard acéré de l’écrivain ; mais les deux conjuguent leur esprit sur un même faisceau, qui pénètre loin dans les détours de l’âme et des hommes. C’est cette variation de mode narratif et de style qui en fait la lecture si fluide et si heureuse, et qu’on se sent bien avec ce gros volume ouvert devant les yeux.
Il y a pourtant, en rupture avec cet esprit éclairé de découverte, et ce réel bonheur de la découverte de l’autre, un drame accablant que le lecteur devra bien traverser, tout autant que l’écrivain. La mort de Julia, emportée par une fièvre impitoyable en quelques jours, marque le centre de gravité de ce fabuleux livre, dont l’écriture sera suspendue à près de dix mois de deuil et de souffrance. Lamartine nous laissera, par ailleurs, sur ce moment de douleur sans retour le très beau et si triste « Gethsémani ou la mort de Julia », probablement un de ses plus émouvants poèmes. Puis, après une longue tristesse, l’écrivain renaît, reprend courageusement le pas sur le père, et le récit du voyage reprend.
Ce texte fera trace dans la tradition des voyages orientaux qui entraîneront les romantiques, entre le merveilleux Voyage en Orient (1851) de Nerval » et le légendaire l’Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811) de Chateaubriand. Il y a bien des livres comme des personnalités, qui, une fois rencontrée et reconnue dans leurs qualités, deviendront vos amis, des amis que vous aurez toujours plaisir à retrouver quand la vie l’exigera.
Alphonse de Lamartine. « Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un Voyage en Orient (1832-1833). » Gallimard, Folio classique. 1146 pages.
©hervehulin2021

Les 7 roses de Tokyo est une évocation fascinante et colorée du Japon dans la défaite et sous l‘occupation américaine. Un fabricant d’éventail, Yamanaka Shinsuke, homme assez âgé, désœuvré par la guerre, tente avec sa famille et ses proches, des amis, des voisins, de surmonter l’effondrement de son pays, dans un quartier populaire de Tokyo. (suite…)

Ce premier roman d’Akwaeke EMEZI est celui d’une possession. Ada, jeune nigériane que nous suivons de sa naissance à son âge de femme, pourrait en être le principal personnage. Mais la trame du roman en décide autrement. A la suite d’un incident rituel, Ada est possédée. Des êtres issus de l’imaginaire africain ancestral – les redoutables Objange – vivent en elle, comme dans une coque, et l’habitent sans concession. Ada est leur chose, mais une chose nourrie tantôt de comportements bienveillants, tantôt de terribles punitions, parfois sans cause autre que le destin des Objange. (suite…)

Notre monde se guérit de sa douleur grâce aux images qu’elle produit. Comme jadis Mithridate neutralisait ses venins par une accoutumance mesurée, les consciences ont secrété une puissante immunité. Saturés du poids des représentations, les sentiments peu à peu s’affadissent. La nuée des informations, qu’anime un mouvement en essor perpétuel, assaille nos esprits inquiets. Et nous contemplons. Le monde, et ses déviances criminelles, l’humanité dans ses détours assassins. Nous contemplons, nous nous habituons, nous nous éloignons des drames si proches qui sont le commun de la vie ordinaire des hommes. Et plus nous contemplons, moins nous compatissons. A force de fixer nos écrans et nos vingt-heures sans les regarder, que souffrons-nous encore des signaux du malheur ?
Que dans le juste cadrage de notre écran plat, ou celui qu’on peut tenir dans le creux de la main, une guerre ravage une contrée à moins de deux heures de vol, qu’elle déploie devant nous, sur de robustes créneaux horaires, sa fureur, ses massacres et ses pillages, ses génocides et ses viols de masse, et encore ses villes en ruine, ses enfants en pleurs pour la vie et ses mémoires à jamais meurtries, ce n’est là qu’une séquence de la journée qui s’achève. Qu’une épidémie d’un mal inconnu traverse la planète, ébranle les cités et les systèmes, dévaste les classes d’âge et les familles, désespère le meilleur de la médecine et nos savants les plus affûtés, ruine les progrès que la science proclame, tout cela laisse en écho une narration distancée, puis une sorte de surprise verticale quand la nouvelle survient que le voisin du cinquième est mort.
Des maux de ce monde en sang, les âmes modernes ont trouvé la guérison. Nous avons appris à vivre ainsi, avec le constant accablement du siècle en parallèle, tel un vieux couple trop habitué qui ne se regarde plus ; et des tourments de notre race, qui s’agitent sous les tropiques, ou du côté des pôles ou devant la porte, nous percevons les formes lointaines comme celle d’une guerre lunaire au travers du télescope entre nations sélénites.
©hervehulin2021

Orante est un brillant causeur. Il n’est pas dénué de fonds dans ce qu’il dit. Il a toute sorte de matière en tête pour nourrir la conversation des amis. Dans les dîners c’est un agréable convive, il anime la société et son débit est régulier, sans jamais être incessant. Il sait s’écarter de la conversation pour quelques tâches domestique qu’un maître de maison sait doser à propos. (suite…)

Alcina aimerait tant qu’on l’aime. Au travail, dans une grande administration, elle a trouvé une place très en en vue. Elle est toujours à s’adresser aux autres avec naturel. Elle sourit, elle embrasse. Elle veut être chaleureuse, et rêve qu’on la voit comme telle. Elle compose et elle imite. Elle se déplace et se propose, elle avance et entreprend, elle contacte et recontacte. Elle fréquente beaucoup, agit toujours pour qu’on la reconnaisse en influente compagnie. Laisse toujours sa carte, qu’elle a fait faire à sa mesure et à ses frais, et rêve qu’on la rappelle. (suite…)

La considération des autres est souvent le seul étaiement de l’estime que l’on se donne. Là où l’esprit s’interroge et doute, des mots dans l’air et des avis volatils s’empressent de le conforter. Quelle que soit la façon dont on vit avec les autres, c’est une loi qu’on ne peut ignorer.
Cimon est brillant et amical. Mais le voici préoccupé sitôt qu’il est entouré ; le regard des autres souvent lui fait problème. Il craint qu’on le juge mal. Aronce est lui aussi, en toute circonstance, inquiet de ce qu’on verra de lui ; il n’aime pas trop être vu. Cimon et Aronce tous deux sont soucieux de ne pas être négligés. (suite…)