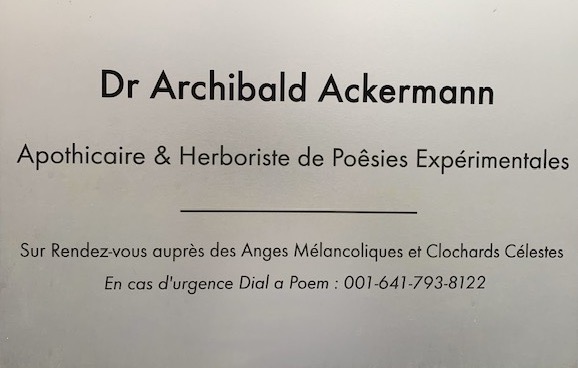INTRODUCTION

Le livre est la meilleure invention de l’humanité, et la littérature une des rares choses qui peut la sauver. Lire donne une couleur aux jours qu’ils n’ont pas de nature. Enfant, je fus assez tôt captivé par ces forêts de signes, et cette odeur inimitable d’un livre qui s’ouvre. Aujourd’hui, alors que les ombres s’allongent, je regarde derrière. La multitude de ces amis de papier me convainc d’en aligner l’inventaire.
Cette liste, dont chacun fera ce qu’il entend, est une sorte de Panthéon personnel de mes plus beaux moments de lecture à ce stade de ma vie. Je n’ai pas fini de lire, rassurez-vous. Mais vient un temps qu’il est temps de faire le point pour partager ce qu’on aime.
Dans la présentation que je vous dois, je n’envisage pas de justifier. Mais de motiver, ou, plus simplement, de partager. J’avouerai que de paresse, il m’est arrivé de reprendre le texte de la décriée liste science Po, que j’évoquais récemment dans mes Cahiers (cf lettre N°10), quand les livres le méritaient – donc, assez peu souvent-mais toujours en m’amendant selon ma conception des choses. Tout ceci est affaire de parti pris.
C’est un panorama personnel, pas une anthologie. C’est donc un paysage arbitraire, mais qui essaie d’être représentatif de cinquante années de lecture. Il y a – je l’avoue- une sélection et un souci d’échantillonnage; j’ai aussi parfois cédé à une préoccupation panoramique, de sorte que j’ai exclu certains livres à la notoriété évidente, pour me conformer à mes propres contraintes et élargir le champ. Bref, il y a du dosage.
J’ai le parti pris de ne retranscrire qu’un livre par auteur. Pour faciliter la traversée de ce monde personnel et sa représentation. Sauf Homère, car l’Iliade et L’Odyssée constituent une seule œuvre et qu’on ne lit bien ces œuvres qu’en les lisant toutes deux. Mais je me suis permis parfois – résistant peu à ma propre contrainte- de mentionner quelques autres ouvrages du même auteur, sans les commenter.
J’ai adopté aussi un parti pris chronologique, en échelonnant autant que possible cette sélection personnelle à travers les siècles : j’ai pu ainsi minorer le paysage de telle époque, pour que telle autre ne soit pas négligée.
Cette liste est modérément ethno centrée. C’est un parti pris. Dit plus simplement, si vous étiez nés au Japon, ou au Nigéria, vous ne trouveriez pas la même liste. Et d’autres ouvrages vous seraient suggérés, des ouvrages plus conformes à votre expérience et votre culture. La liste que je vous présente est principalement nourrie de notre littérature occidentale, mais pas que. J’ai proposé une série d’ouverture sur la Chine, le Japon, l’Afrique. Pourquoi pas le monde arabe, me direz-vous, où l’Europe slave ? tout simplement parce que je les connais peu, et on ne parle bien que de ce qu’on reconnait.
J’y ai mis peu de poésie, en tout cas de recueils. Mais certains grands ouvrages notamment épiques. Peut-être, une autre fois, une autre liste, consacrée aux poètes verra le jour. Mais on ne lit pas la poésie comme on lit autre chose. Montaigne ne disait-il-pas, avec son éblouissante sagesse « la poésie, il est plus aisé de la faire que de la connaître » ?
Cette liste ne contient donc pas tous les livres que vous aimeriez et ou que vous pensiez voir figurer. Je sais, chacun va dire, selon ses préférences ou ses anciennes émotions de lectures, : “et pourquoi pas celui-ci ? ah c’est nul, il n’y a même pas machin chose etc ». C’est-à-dire que je n’ai pas pu inclure tous les livres que j’ai aimé lire, et tant de livres merveilleux sont restés sur le côté. Cette sélectivité est tout à fait cruelle, mais elle est nécessaire ; la mise en valeur perdrait tout son sens.
Ne lisez surtout pas trop vite les ouvrages que vous aurez choisis dans ce florilège, et laissez votre cerveau imiter la diction à voix haute. Autant que possible, mettez-y l’accentuation tonique, le ton, le rythme, la fluctuation nécessaire à animer le texte et le rendre vivant. Sortez de l’abstraction et penchez vers l’animation. Prenez la lecture comme une promenade, avec ses aléas, et surtout pas comme la préparation à une épreuve de culture gé.
Et donc, engageons la gageure : c’est parti, sur 30 siècles au moins…
CHAPITRE PREMIER. LES ANCIENS.

Ils sont venus les premiers avec le génie d’écrire des histoires et des pensées. Il fallait bien avoir l’idée de commencer, non ? Cette première étape est une fondation : on y invente le lyrique et l’épopée, le théâtre et la poésie (le roman aussi un peu, mais ça viendra vraiment plus tard). Très vite, comme les siècles passent et le langage se forge, l’Histoire domine. Les dieux surveillent. Mais la préoccupation de fixer la trajectoire des hommes, des cités et des peuples, évoluera naturellement vers l’envie irrépressible de raconter des histoires qui n’existent pas. La fiction est là, construite sur le langage: alors peut commencer la littérature.
Mais cette période est d’abord, pour nous, un cataclysme de la mémoire. Si on considère la littérature latine par exemple, il faut garder à l’esprit, à chacune des pages lues de ces chefs-d ’œuvres, que, des centaines et centaines de titres qui nous sont connus dans ces siècles brillants, moins de vingt seulement nous sont parvenus véritablement complets.
- Le livre des morts- vers -1550 avant JC (jusqu’à -100 env avant JC). Les anciens égyptiens avaient un culte obsessionnel de la mort. En réalité, le titre qu’on retrouve sur plusieurs textes de cette vaste et fragmentaire compilation est « Livre pour sortir au grand jour ». Le « jour » en question est celui des vivants, mais aussi de la lumière qui domine les ténèbres, et s’opposera toujours à l’oubli, à l’anéantissement. Ainsi, ce livre maintient la vie, par les innombrables formules rituelles dont il assure la compilation. Dans cette perspective, le défunt égyptien cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à traverser le royaume d’Osiris, le ressuscité. Ce « livre » (peut-être le premier ?) est en réalité un assemblage de textes, formules, fragments rassemblés et ordonnés par nos égyptologues du 19è siècle, à partir de papyrus épars, et de rites écrits sur les murs, ou les sarcophages. Toutes les étapes de la vie éternelle y sont décrites et réécrites – ces bouts de textes s’échelonnent sur près de quinze siècles. Mais un aspect frappe encore notre conscience curieuse de lecteur moderne : à aucun- mais vraiment aucun- moment, la mort ne fait peur. A lire avec modération par courtes séquences. C’est un livre magique, à tous les sens du terme.
- Anonyme – Yi king ou le livre des transformations – 1000 à 200 avant J-C: on trouve les premiers diagrammes près de 3000 ans avant J-C, mais la codification des hexagrammes, les textes et commentaires philosophiques remontent à mille ans avant Jésus-Christ. Cet ouvrage est à la fois un traité de géomancie, un guide pratique d’aide à la décision, et un ensemble de réflexions philosophiques et spirituelles. Également appelé canon des mutations ou classique des changements. Personnellement, je n’y ai jamais rien compris. Donc, deux façons de se la jouer : soit laisser en évidence ce livre sur votre étagère ou autre, pour impressionner voire amuser vos amis ; soit le lire, en acceptant l’idée de ne pas tout saisir, quitte à y revenir plus tard.
- Homère. Iliade et Odyssée. Entre 850 et 750 avant JC. l”Iliade”, c’est une histoire de guerre, où il y a de l’action, de l’amour, et des héros, le tout couronné par une guerre encore plus exceptionnelle : une guerre des Dieux. Autant vous dire qu’il y a des exploits, de la stratégie, de la destinée. C’est long et dense, c’est passionnant. Mais tout comme l’Odyssée ce n’est pas toujours très facile à lire. C’est aussi le modèle de l’épopée : un récit d’exploits historiques/mythiques, où les dieux se font la part belle dans les passions des hommes, qu’ils surveillent et découpent selon leurs humeurs. Attention cependant : « Iliade » ne « raconte » pas la guerre de Troie, qui n’en est pas le sujet, mais seulement le contexte. Le thème du poème, c’est un épisode qui se situe vers la fin du conflit, et qui ne dure que six jours : la colère d’Achille. Comment un être humain – le héros – peut-il perdre son humanité dans la guerre, puis comment la retrouve-t-il ? Réponse dans le texte. L’”Odyssée”, pour sa part, fait corps avec ce grand texte, et les deux composent un tout organique. On ne retient de l’Odyssée que les voyages d’Ulysse, fabuleux et merveilleux. Là encore, on sera peut-être un peu déçu si on n’attend que cela. C’est d’abord le récit d’une relégitimation : le retour d’Ulysse, dans son royaume à l’abandon depuis son départ, quand sa place de roi d’Ithaque est dissoute dans son absence et près d’être usurpée. Ulysse à Ithaque occupe plus de la moitié du texte, et la refondation de sa place en est le sujet. Ce développement d’abord sinueux bascule dans le sang. Les deux textes – parmi les plus grands de toute la littérature -ont ceci de commun: les passions donnent vite dans la boucherie: mais à la fin, c’est l’humain – et son don du pardon- qui gagne.
- Héraclite. Fragments. (vers 500 avant JC). On sait très peu de chose de la vie d’Héraclite, et on ne sait même pas si ces fragments sont les morceaux épars d’une seule œuvre – un hypothétique « Traité de la nature » ou bel et bien une collection d’aphorismes. Toujours est-il qu’il y a beaucoup de bons sens et de vérités accessibles dans ces phrases d’une remarquable intelligence, qui interrogent et répondent en parfois une seule formulation. C’est un livre qu’on emmène avec soi, dans la rue, à la campagne, au bistrot, dans le métro. On ouvre et on prend selon l’inspiration. A vrai dire, on fréquente Héraclite, plus qu’on ne le lit.
- Eschyle. Les Perses. 451 avant JC. Le Vè siècle grec avant JC est un tournant littéraire de notre civilisation. C’est celui du théâtre tragique, du drame qui agrippe l’homme dans ses serres et ne lâche rien jusqu’à l’implosion. Les Perses est la plus ancienne pièce de théâtre dont on ait conservé le texte. La victoire de Salamine – à laquelle participa Eschyle – sur l’immense empire Perse fut vécue dans le monde méditerranéen comme celle d’un peuple libre sur une monarchie oppressante. Peu de tragédie mette autant en évidence l’alliage des deux éléments constitutifs de la tragédie grecque : la déploration lyrique et la narration épique : et il y a de l’épique et du poétique, des songes et des prophéties, de l’humain et du divin, et c’est immense.Le récit de la bataille de Salamine est fabuleux. (A lire du même auteur, beaucoup de choses dont : Orestie, Prométhée enchaîné).
- Hérodote – les histoires (ou l’Enquête) -445 avant J-C: Hérodote s’interroge sur le lien entre l’évolution de deux mondes (en ce temps, le monde, c’est la Méditerranée, plus l’Orient, point) et l’affrontement constant entre Orient et Occident. le « père de l’Histoire » selon Cicéron, mais plus proche du roman des peuples que de l’histoire (cf., article suivant…). Son enquête, est le plus ancien texte complet en prose conservé de notre littérature occidentale. Il nous dit tout de ces temps: les mœurs, les coutumes, les cultes, les voyages, les royaumes et les cités. Et ça se lit vraiment très plaisamment.
- Sophocle- Antigone.441 avant JC. Antigone, c’est l’essence du tragique tel que l’a inventé l’esprit grec. C’est l’histoire d’un conflit spécifique à la conscience humaine. La morale, ou le devoir ? L’éthique, ou la loi ? La cité, ou la famille ? Polynice, le frère aimé, est mort au combat contre son père, tyran de Thèbes. Ce dernier, vainqueur mais offensé, ordonne au mépris des traditions de priver le corps de toute funérailles, pour qu’il se décompose sur le champ de bataille. Personnage féminin indomptable –encore une dans le théâtre grec – Antigone est d’une loyauté sans faille aux membres de sa famille, et, à ce titre, une rebelle ; le préfixe de son nom (« Anti », contre) la destine à ce rôle. Elle choisit irréversiblement la justice immanente, fondée sur l’amour, contre la loi de la cité, mue par la vengeance. Peu importe que les dieux lui donnent raison à la fin de la pièce : contre l’injustice de la tyrannie, la mort reste l’essence de la liberté. Deux millénaires et plus après cette œuvre, nous n’avons pas fini d’en tirer les leçons, et le dilemme d’Antigone reste d’une modernité absolue.
- Euripide. Médée. 431 avant JC. C’est le drame d’une femme qui a cru maîtriser son destin, et s’imposer dans celui des autres. Le tragique lui fera payer. Est-elle folle ? Magicienne ? Criminelle ? C’est probablement Euripide qui a imaginé de faire du meurtre de ses propres enfants un acte délibéré de Médée. La folie meurtrière a toujours l’excuse de l’égarement envoyé par les dieux. De tous les poètes grecs, Euripide est le seul qui ait dépassé la misogynie populaire et osé montrer comme atroce la condition des femmes. Sa Médée est meurtrie et laisse le sillage dans l’histoire à venir d’une créature dangereuse, et furieuse. Mais son texte est formel : elle est d’abord femme trahie, blessée, abandonnée. (A lire aussi, du même auteur, beaucoup de choses dont : Alceste, Les troyennes).
- Thucydide. La Guerre du Péloponnèse (vers 420 av. JC). Le premier grand reportage de guerre de l’histoire, nous montre dans une chronologie parfaite comment les civilisations se déchirent et se ruinent pour nourrir leurs intérêts. Moins de quatre décennies après l’union sacrée du monde grec contre les Perses, Athènes et Sparte s’affrontent sans pitié. Ce qui est nouveau absolument chez Thucydide, qui a vécu la guerre et participé comme général aux opérations dans le camp athénien- les perdants, au final- c’est qu’il analyse les causes des évènements. C’est un regard moderne, où se mêlent l’actualité et l’histoire. Le premier historien de la pensée européenne.
- Confucius – Les entretiens. 479 avant JC à 221 après JC. Personne n’ignore le nom de Confucius. D’après Simon Leys en 1987, « nul écrit n’a exercé une influence plus durable sur une plus grande partie de l’humanité ». En effet, en termes d’influence, Confucius en Orient est souvent comparé à Platon ou Jésus en Occident. L’enseignement du Confucianisme était obligatoire en Chine, et encore aujourd’hui le mode de pensée confucianiste imprègne les sociétés asiatiques, notamment en Chine, au Japon, en Corée. Haï par les marxistes, c’est pourtant un auteur qui dure…Inutile de vous dire que les paroles rapportées peuvent être un peu déstabilisantes. Il y est notamment écrit « Si deux personnes marchent ensemble avec moi, il y en a au moins une qui peut me servir de maître ». C’est un peu l’idée que vous devez retenir lorsque vous lirez ces entretiens. A noter que les Chinois le considèrent comme le symétrique de Lao Tseu : celui-ci construit sa pensée à partir du vide, et celui-là à partir du plein.
- Platon. Le Gorgias. Vers 387 avant JC environ. Les écrits de Platon sont d’une sagesse et d’une clarté universelle. Ce sont presque toujours des dialogues, ou des conversations, qui mettent en scène son maître Socrate. Du point de vue de la forme, c’est assez amusant et très lisible, abstraction faite de la complexité des niveaux de lecture. Enfin, on touche là non seulement à un trésor historique inimaginable, mais aussi à la naissance de la philosophie. Platon pose un fondamental de la pensée européenne : le dialogue (di logos, pensée à deux). Toutes les pensées, tous les auteurs, tous les philosophes en Occident se sont penchés un jour ou l’autre sur Platon. Le Gorgias interroge – et répond- à ce fondamental : qu’est-ce que le bien ? Il met ainsi l’esprit positif au centre de la pensée. Moins connu que l’apologie de Socrate ou le Banquet, Gorgias est la pierre angulaire de la philosophie grecque, c’est-à-dire, de la nôtre. (A lire aussi du même auteur : La République ; le Banquet ; Phédon).
- Aristote. L’Éthique à Nicomaque. 350 avant JC environ. Le bien suprême, la vertu, la justice…Aristote, c’est tout comme Platon : la naissance de la philosophie… Aristote, c’est l’équilibre de la pensée et du mot (bon un peu moins quand il affirme que l’esclave n’a pas de volonté, et la femme en a une de sous-ordre) et dans tous les domaines : physique, métaphysique, politique, éthique, langage, poésie et… biologie. Oui car Aristote avait une passion : observer les animaux, et il leur a consacré tout un traité. Au sein de cette considérable œuvre, l’Éthique à Nicomaque: ce livre est un peu son traité sur le bonheur, qui est la finalité de la vie. Pour arriver à ce bonheur, il parle de politique, de vertu, de justice… Sans la recherche du bien dans les contours les plus simples de l’existence, point de bonheur sur terre. Autant de thèmes sur lesquels Aristote fait encore figure d’autorité de nos jours. (A lire du même auteur : La poétique).
- Épicure. Lettres- Vers 300 avant JC environ. Épicure est un phénomène. Il est probablement l’auteur antique dont la bibliographie est la plus vaste (plus de 300 ouvrages) et il n’en reste que si peu : une réputation erronée d’adepte du plaisir pour le plaisir, mais surtout ces trois lettres : à Hérodote (pas l’historien cité plus haut, mais un disciple) à Pythoclès, et Ménécée. Tout est dit pour faire d’Épicure un esprit total. La civilisation, la connaissance, la psychologie, le langage, la nature : rien n’échappe au faisceau de cette pensée limpide et étonnamment accessible. Sa philosophie est un remède à l’angoisse de notre condition. L’achat de ses écrits devrait depuis longtemps être remboursé par la sécurité sociale.
- Tchouang Tseu. Le vrai classique du vide parfait. (vers 300 ? av. JC). De lecture plus accessible que Lao Tseu, dont les formules énigmatiques laissent encore perplexe. La fable du Papillon, la relation entre le rêve et la réalité, ou le mythe de l’oiseau Peng nous parlent plus facilement, et nous ouvre ainsi la voie à la pensée chinoise originelle. Ne vous trompez pas sur le modèle de la fable et de l’apologue, et cette forme d’ironie en sourire qui irrigue le texte : c’est très – vraiment très- profond. A noter qu’on n’est même pas sûr de l’existence de Tchouang Tseu, dont le nom se confond avec celui de son ouvrage.
- Polybe-Histoires- 168 avant JC. Peut-être le meilleur historien de Rome, à l’opposé des élucubrations sur commande de Tite-Live. Grec mais prisonnier de guerre des romains, il se passionnera pour cette civilisation dont il partagera l’histoire et la vie politique. Polybe est l’auteur des Histoires, le pluriel de ce titre signifiant qu’il s’agit d’une histoire générale ; seuls cinq volumes sur les quarante d’origine nous sont parvenus dans leur totalité. Les livres I à XXIX qui retracent l’expansion romaine entre 264 et 168 av. J.-C. ont été écrits à Rome pendant l’exil de l’auteur. Ce qui est marquant dans la réflexion de Polybe, c’est qu’il interroge les institutions romaines pour comprendre cette expansion sans égale dans l’Histoire (et Polybe, évidemment, n’a encore rien vu). Son approche est d’une modernité étonnante, il qualifie lui-même le processus d’expansion d’organique. Sont fascinantes sa théorie de l’anacyclose, son analyse de la constitution romaine, ou la description quasi-cinématographique des batailles de Canne ou de la Trébie. Un pionnier de la méthode, en sciences sociales, et un écrivain de souffle en même temps.
- Cicéron -Les Catilinaires . 63 avant JC. Cette série de quatre discours est un réquisitoire sans faille contre un bandit prêt à brader Rome et sa république pour son intérêt personnel. Modèle oratoire – envions ceux qui savent le lire dans le texte -et plaidoirie implacable, si bien qu’on n’aimerait pas être à la place du sinistre Catilina. C’est un texte qui cingle, comme doit le faire la défense d’une juste cause et du droit contre l’arbitraire. (A lire du même auteur : De la vieillesse)
- Lucrèce – De la nature des choses (de natura rerum) – 55 av J-C: ce grand poème latin veut révéler aux lecteurs la nature du monde et l’explication des phénomènes naturels. C’est un beau poème scientifique. En effet, il décompose le monde et ses lois de façon analytique, et pose avec une intuition étonnante le principe des atomes ou de la pesanteur. Le texte procède d’une permanente investigation sur la rationalité du monde. L’univers, comment ça marche ? C’est une leçon de raisonnement.
- Jules César – Commentaires sur la guerre des Gaules – 52 av J-C. Ouvrage écrit en grande partie à la troisième personne par son acteur principal du côté romain – Jules César, chef génial mais sanguinaire, voire semi-génocidaire. Plus qu’un récit objectif, il s’agit de récits de campagne et de faits rapportés en décalé chronologique, pour assoir la gloire et la puissance de son auteur. Probablement le premier ouvrage de propagande militaire de l’histoire : on minimise les coups durs, on sublime les succès. On en justifie les crimes (de masse), au détour de quelques grands élans de bataille, ou d’effet de discours. César n’entend pas faire l’histoire, mais son histoire, pour qu’elle se confonde avec celle de Rome. Force est de constater qu’il a réussi. De combien de péplum aura-t-il hanté le casting ? Mais c’est en direct, la mécanique du génie militaire qui se dévoile. Par ailleurs, chef d’œuvre de la langue latine.
- Virgile – l’Énéide – 29 à 19 avant J-C: épopée inspirée de l’Iliade et l’Odyssée, l’Énéide fait le récit des épreuves du troyen Énée, ancêtre mythique du peuple romain, entre Troie et son installation dans le Latium. 10 000 vers répartis en 12 chants. Virgile écrit sous les regard acéré de son ami, l’empereur Auguste, qui attend un monument à la gloire de la civilisation romaine et de ses valeurs. Mais surtout, un poème qui incarne la perfection formelle de la poésie latine, mais aussi un chant d’amour pour la civilisation romaine et méditerranéenne. Probablement, avec Dante et Rimbaud, le plus grand poète de l’Occident. (A lire aussi du même auteur : les Bucoliques ; Les Géorgiques).
- Ovide- Les métamorphoses. Vers l’an 1 après JC. Ovide, frappé par l’exil est le premier poète maudit de l’histoire. Et Les métamorphoses sont d’abord celles des malédictions de l’histoire. Tous ces héros, ou ces humbles, confrontés au divin comme à leurs propres amours, mais toujours frappés par le sort, se changent en quelque chose d’autres qui forme une sorte de progrès. Quel est l’aboutissement de cette vaste roue ? L’Empire, et c’est tout. Cet Empire qui lève et embrasse tout, et forge une paix séculaire sur le pas des légions. (A lire aussi du même auteur : les Tristes ; les Pontiques ; Les Fastes).
- Sénèque. De la vie heureuse. 58 après JC. Sénèque participa de très près au pouvoir : sous les règnes de Caligula, Claude et Néron, dont il fut le précepteur. Son style est limpide, et sa pensée claire. Il est la référence du stoïcisme finissant. En gros, son message est de ne pas se compliquer l’existence avec des passions stupides, et ces emportements malsains qu’elles occasionnent. C’est la seule démarche concevable pour ne plus avoir peur de la mort. (A lire aussi du même auteur : Les consolations)
- Pétrone. Satiricon. Vers 60 après JC. Un des premiers romans, peut-être le premier (?) de la littérature européenne, et assez foutraque dans sa conception, du moins telle qu’elle nous est parvenue. Mêlant du vers et de la prose, jouant avec des figures rhétoriques complexes, il narre les aventures de trois personnages dérisoires- on les qualifierait de ratés dans notre perception moderne des choses. L’impuissance dont le Dieu Priape a frappé l’un deux -Eumolpe- est la trame des épisodes et de leurs rebondissements. On y voit une Rome foisonnante, traversée d’ambitieux et d’affranchis, avec des festins incroyables, de la luxure obsessionnelle, et des déconvenues en proportion. A noter qu’on n’est plus sûr du tout de la paternité de Pétrone – ami de Néron, et contemporain de Sénèque – sur ce livre : peut-être même s’agit-il d’un autre Pétrone, postérieur, ou d’un anonyme. Peu importe : l’immoralité délicieuse du texte reste la même.
- Flavius Josèphe-La guerre des juifs-73 après J-C. Flavius est un hybride judéo-romain, et un traître supérieur : notable juif, qui passe en pleine guerre de résistance des juifs, dont il fut d’abord l’un des stratèges, dans le camp romain, dont il sera ensuite le conseiller tactique exhaustif. L’œuvre est en partie propagande, éditée avec la bienveillance de Titus, vainqueur impitoyable de la rébellion juive contre l’Empire. Il faut bien se justifier, donc. Mais Flavius ne fait pas que cela et laisse un ouvrage d’histoire qui sait comprendre et faire comprendre la mécanique des peuples en guerre. Sans illusion sur la brutalité dont est capable Rome, qu’il admire tant, envers qui ose défier sa loi, mais aussi sur le fanatisme sanguinaire de certaines sectes juives, il retrace avec talent les ressorts de ces deux grandes civilisations qui s’entretuent au lieu de s’entendre. Document fondamental, qui fourmille d’information directes sur cette époque si violente ; on y voit les manœuvres des légions, leur équipements et leur discipline, mais aussi les rituels hébraïques ou les ruelles de Jérusalem.
- Pline l’ancien – Histoire naturelle – 77 après J-C: monumentale encyclopédie en 37 volumes qui a longtemps été la référence en sciences et techniques : astronomie, anthropologie, psychologie, métallurgie… Parfois, on a l’impression de lire des fables, car le merveilleux y côtoie, sans le vouloir, le rationnel. Il lui arrive d’écrire et raconter n’importe quoi comme autant de phénomènes scientifiques. Mais c’est ainsi que l’on pense le savoir au premier siècle de notre ère, dans cette vaste fédération des connaissances que permet alors la puissante pax Romana. Pline a aussi été témoin direct de la terrible éruption du Vésuve qui a rasé Pompéi et Herculanum.
- Tacite. Annales 110 après JC. Julien Gracq admirait chez Tacite ce sens journalistique de l’observation du pouvoir et des mœurs qu’il imprime. Il y a en effet chez lui une précision et un souci d’éviter les passions et les jugements de morale à l’emporte-pièce – Tacite n’est pas un Suétone aigri et vindicatif, mais tout aussi brillant ; on voit se dérouler l’horlogerie du pouvoir des césars, et ses coulisses. Il n’est jamais dans l’anecdote ou le ragot, mais toujours aux aguets du fait. La distanciation de ce styliste hors pair n’en rend que plus redoutable les effets de bord d’un pouvoir, pour la première fois dans l’histoire, sans borne. (à lire du même auteur: De la Germanie)
- Plutarque –Vies parallèles ou vie des hommes illustres – 100 à 120 après JC : biographies organisées par paires, dans une approche systématiquement comparative. La démarche entend faire connaître, de façon souvent anecdotique et pas toujours authentifiée, comment des personnalités deviennent acteurs des grands moments de l’histoire. Écrit –en grec- sous l’apogée de la paix romaine, les vies parallèles tentent une première approche de biographies en systémique, selon les codes et les références d’écriture de l’antiquité déjà finissante.
- Apulée. L’âne d’or (Métamorphoses). Vers 150 après JC. C’est un roman, de ceux qu’on lisait à voix hautes sur les places à défaut d’avoir encore inventé le cinéma. Il y a de la magie et des sorcières, des transformations, des bandits et des dieux, des procès et des évasions, du sexe et des mystères. C’est drôle, et plein d’aventures. Mais le récit est complexe, à plusieurs niveaux, intégrant des histoires dans l’histoire, enchevêtrant des récits, et jouant sur les niveaux de langage -Apulée était rhéteur et philologue. C’est un roman donc- un vrai et un des premiers – à la fois divertissant et didactique, dont le thème est la confrontation permanente de la curiosité et du secret. Tous les secrets n’en sont toujours pas interprétés : rien que le titre interroge : s’il est bien question d’un âne, d’or, il n’est point dans le roman. Quid?
- Marc-Aurèle – Pensées pour moi-même – v 170-180 après J-C: cet empereur fut également un philosophe stoïcien dont les aphorismes et maximes enrichissent encore les fondamentaux du stoïcisme. Elles sont aussi une réflexion somme toute moderne sur la solitude du pouvoir, et la difficulté à rester humain face à ces enjeux destructeurs d’humanité. Avec Marc-Aurèle, prend fin l’apogée : rédigées le plus souvent dans les bivouacs des légions en campagne et leurs feux de camps, alors que l’Empire glisse lentement vers la défensive, les pensées peuvent être considérées comme un chant d’adieu à la pensée antique. Pour reprendre la formule d’Ernest Renan, elles nous parlent d’un temps « où l’homme seul a été », avant le Christ, et après –déjà- les dieux.
- Philostrate – La galerie de tableaux- v 220-230 après JC . Il y a plusieurs Philostrate et celui-ci est le dernier. Célèbre rhéteur de son vivant – il fut présenté à Septime Sévère, qui l’appréciait, et il fréquenta longtemps la famille impériale. Soixante-cinq tableaux – réels ou fictifs ? – sont ici décrits par Philostrate… Dans ce texte fondateur, Philostrate institue un dialogue entre le critique et le spectateur, forçant ce dernier à participer à la scène, le plus souvent d’inspiration mythologique, que montre l’œuvre peinte : ce procédé qu’utilise Diderot dans ses fameux Salons, vise, avec succès, à susciter l’émotion du visiteur. La Galerie de tableaux de Philostrate est plus qu’un document unique sur la peinture antique : elle a inspiré les plus grands artistes de la Renaissance, nourri la réflexion sur l’art d’auteurs tels que Goethe, et a, surtout, véritablement créé le langage de l’esthétique. En plus, c’est très plaisant, et bien que procédant d’une belle ambition, le texte se lit avec douceur : la promenade dans cette jolie galerie est vraiment très agréable.
- Gan Bao-A la recherche des esprits- v.330-340 après JC. Gan Bao est un lettré qui parmi les premiers va se passionner pour les histoires de fantômes et de démons. Ces récits sont une compilation de témoignages et d’anecdotes, présentés comme des faits authentiques, issus de témoignages directs, évidemment… Des dragons, des femmes démons, des revenants, des spectres voyageurs, n’en jetez plus, tout est là. La plupart sont très courts, d’autres s’étirent comme des contes avec une narration plus structurée. Mais c’est un peu un portrait des naïvetés humaines, dans une société dont l’imaginaire est en composition. A noter que les quelques 450 épisodes relatés ne sont pas tous de cet auteur, car selon la tradition littéraire chinoise classique, d’autres auteurs ont continué l’ouvrage en y ajoutant des récits ultérieurs, jusqu’au début du VIè siècle au moins. Mais Gan Bao donne ainsi à la littérature le goût du fantastique, qui ne s’en passera plus jamais.
- Ammien Marcellin. Histoires (Res Gestae) v. 382 après JC. Moins connu que Tacite ou Tite-Live, Ammien reste un historien majeur de la civilisation latine. Officier d’élite, puis haut-fonctionnaire (pour peu que ce terme signifie quelque chose au IVe siècle) de culture païenne, il a connu et fréquenté de très près ces grands fauves que furent les Empereurs du Bas-Empire, les Constance, Julien, Valentinien, puissants et impitoyables, dont il nous trace des portraits en couleur, et en gros plans. Sans indulgence pour la violence des mœurs politiques de ce temps, il raconte et nous conte quel est le prix du sang pour conserver un Empire dont les fissures gagnent à grands pas. Sa description sans fard de la désastreuse bataille d’Andrinople (378) éclaire encore les historiens d’aujourd’hui.
- Nicomaque Flavien Histoire Auguste. vers 390 environ. Ce long texte est une compilation des vies des empereurs romains d’Hadrien à Numérien. Il déroule toutes ses biographies, y compris celles des usurpateurs mineurs, qui n’auront régné parfois que quelques semaines. Tous les travers des césars y sont rapportés, mais aussi, parfois, leur grandeur. C’est du péplum et parfois, du technicolor. Mais la dimension historique s’arrête là, et c’est ce qui est plaisant. Il y a bien plus d’inventions que d’histoire. Nicomaque se soucie peu d’authenticité. Parfois même c’est du roman et du n’importe quoi. Ce qui est amusant, c’est la façon dont l’auteur, non seulement recompose l’histoire, mais aussi se déguise lui-même : longtemps, on a cru que cette Histoire auguste était un ouvrage collectif, car plusieurs auteurs y sont référencés. Aucun n’a jamais existé. Ce n’est que très récemment qu’on a découvert qu’ils étaient tous invention de l’unique auteur, sénateur païen de la fin du IVe siècle.
- Saint-Augustin –Les Confessions– 401. Dans un monde devenu totalitaire, menacé de son déclin et de l’histoire qui s’emballe, seule la conscience sauve l’humain. Toujours, chez saint Augustin, et malgré son christianisme intransigeant en expiation de sa vie dissolue antérieure à la conversion, l’homme, en phase avec le divin, fait des choix, et se construit ainsi. C’est l’invention du « Je » en littérature.
- Boétius. Consolation de la Philosophie – 524. Il a été surnommé l’instituteur de l’Occident, et Dante le situait comme un de ses maîtres à penser. Grec d’esprit et romain de cœur, dans ce VIè siècle si dubitatif, Boétius écrit ce texte en prison, sans doute peu de temps avant son exécution. L’Empire et Rome s’en sont allés sous les coups de l’Histoire, et Boétius contribue au gouvernement de Théodoric. Sa disgrâce soudaine met à l’épreuve son âme de stoïcien : dans la chute, la sagesse forgée au stoïcisme résiste dans les hauteurs. Boétius attend la mort sans peur, dans son cachot, et, pour la faire patienter, dialogue avec la philosophie, dans une ultime prosopopée. Il est le dernier romain, et sa consolation est un adieu poignant au monde antique. Après, c’est une forme de brouillard silencieux, avant que ne renaisse – très lentement et laborieusement- la littérature au Moyen-Âge.
CHAPITRE SECOND : LES MEDIEVAUX.

Le moyen-âge, malgré son étendue historique, n’aura pas été l’âge où la littérature foisonne- du moins chez nous, en « occident ». Normal, quant à son début, plus personne ne sait, lire sauf les prêtres, c’est qu’on est tombé bien pas. Mais le concept de moyen-âge est d’abord une idée occidentale qui signifie très peu pour les esprits orientaux ; aussi, n’allons pas chercher pourquoi tant de monuments ailleurs que chez nous.Le langage est encore informe en Europe- mais déjà si évolué ailleurs, au Japon ou en Chine par exemple. C’est cela qui est intéressant. L’Occident est en retrait dans sa performance créative. Il faut attendre la fin du XIIe siècle pour que ça commence à bouger (Huit cents ans après Saint Augustin ou Ammien !).Et pourtant, bien de belles choses qui font sillon dans cette passion des hommes à écrire. Car en ce temps si long et compliqué, on se soucie d’écrire moins pour être lu -pas encore d’imprimerie, plus de lectures publiques, et on ne sait pas lire ou si peu- que pour inventer. Et si ce n’est pas la période la plus brillante de la littérature, c’est en tout cas dans ce vaste espace de temporalité que vont se construire et s’agencer irréversiblement, bien des traits qui vont marquer définitivement la suite. C’est au terme de cette longue transition, qui commence par une quasi-disparition de la littérature et déroule un sens du merveilleux qu’on ne retrouvera plus jamais, que l’homme se placera au centre, tandis que le divin s’efface pour une place secondaire. Cette médiévalité si longue d’un millénaire fut bien un moment médian où les lettres sont devenues une passion partagée de l’humanité.Allons-y, donc.
35. Sei Shonagon. Notes de chevet. 1002. Un des plus beaux et captivant livre de mon Panthéon. Ne cherchez pas d’histoire ou de trame : ces notes ne sont que des récits des jours (et des nuits) d’une grande dame à la cour de Heian. Elle observe les saisons, la nature, et les mœurs. Tout y est noté en subtilité et raffinement, jusque dans la moindre émotion. On y trouve des anecdotes, des souvenirs, mais aussi – curieuse marque de fabrique de ce livre, et de son époque – des listes : de choses agréables, de souvenirs, de sensations, d’oiseaux, de visages etc. L’ennui y alterne avec les joies, les rêveries avec les instants de convivialité, et au détour d’un soir ou d’une nuit, voici des instants d’amour ou de nostalgie. Le style y est toujours d’un équilibre parfait. Parfois, au cours de la lecture, on se surprend à envier d’avoir vécu dans cet univers-là, subtil et lointain. A noter: les femmes écrivent au Japon, en ces temps distants, bien plus qu’en Europe ou ailleurs.
36. Murasaki Shikibu – le dit du Genji (Genji Monogatari) – 1010: récit prétendu véridique d’un prince impérial qui ne peut cependant pas prétendre au trône. Contemporain du précédent livre, cette œuvre japonaise serait le premier roman psychologique du monde. Critique incisive des mœurs raffinées de la cour de Heian et de ses intrigues constantes pour se faire une place au soleil, c’est à dire en vue de l’empereur. Mais il y a beaucoup de nostalgie, d’amours et de contemplation. C’est vraiment japonais. Le Genji est un ouvrage dont la lecture est exigeante : les personnages (plus de quatre cents) y sont désignés par leurs titres, lesquels titres changent au gré des aléa des carrières, dans le flot de ce roman de deux milles pages. Bon courage, mais ça vaut la peine de s’y acharner, quitte à ne pas tout lire, en se disant qu’on y reviendra un jour. A noter que la seule édition/traduction française à ce jour (sauf erreur) dépourvue de notes et de références pour le lecteur, n’est pas à la hauteur de la subtilité réputée du texte.
37. Somadeva- Océan des rivières des rivières de contes (Kathâsaritsâgara) XIe siècle. Comme le dit le titre, c’est un océan dont les vagues, qui viennent sans cesser se chevaucher et se renouveler, sont des histoires. Le recueil est composé de 18 livres de 124 chapitres, en tout plus de 22 000 vers en alternance avec des sections en prose (traduction en prose évidemment, dans la seule édition de la Pléiade). Il y a des mortels, des princes et des servantes, des divinités, moqueuses ou merveilleuses, des animaux enchantés et toute sorte de créature. La trame principale relate les aventures de Naravahanadatta (imprononçable, peu importe). On se perdra dans les digressions et les tiroirs incessants. Des nuées de contes sont insérés dans le récit principal, et chaque histoire se ressource dans le conte originel du volume (attention, il faut suivre) : pour respecter une promesse faite à un mendiant, un roi doit aller chercher dans un cimetière, de nuit, un cadavre pendu à un arbre. Pendant qu’il le ramène sur son épaule, le cadavre, qui est possédé par un « vampire », (non pas un affreux suceur de sang, mais plutôt une sorte de zombie apathique) lui raconte une histoire, conclue par une énigme de portée morale. Chaque fois (sauf la dernière), le roi résout l’énigme, et le cadavre disparaît : il est à nouveau pendu dans l’arbre et le roi est obligé de revenir le chercher. Et c’est un nouveau conte…Mais on n’est pas obligé d’avaler cette masse si savante et organisée. On peut se promener dans ce volume, se perdre et y revenir, trébucher et se relever. La dernière énigme, à laquelle le roi ne peut apporter de réponse, est celle-ci : un père et son fils épousent respectivement, le premier une fille, le second la mère de celle-ci. Des enfants naissent de part et d’autre : qui sont-ils les uns pour les autres ?
38. Béroul.Tristan. 1170. J’avais jadis, à la Sorbonne, un professeur qui nous enseignant le Tristan, de Béroul, troubadour normand du XIII è siècle, avait une théorie originale de la littérature. Pour lui, celle du moyen-âge (européen) n’était pas le balbutiement mais l’apogée. Pour cela, il argumentait qu’elle ne procédait pas d’un langage fini, mais en construction permanente : l’auteur devait sculpter la langue autant au fur et à mesure de son propos. Raisonnement à contre-courant mais ça se tient. Et cette version de Tristan et Iseut en était pour lui, une illustration. Il existe des dizaines de version de ce mythe d’une puissance symbolique et émotionnelle hors du commun. On peut en choisir une autre. D’ailleurs, celle-ci est plus centrée sur le personnage de Tristan, héroïque mais mélancolique, que sur le couple maudit. Mais elle garde une fraîcheur païenne délicate, nourrie de symboles et références celtiques, et pleine d’émotion nouvelle.
39. Sagas Islandaises. XIè au XIIIè siècle : Les Sagas islandaises en prose, se situent aux frontières de l’histoire et de la légende. Une saga, au sens originel, n’est pas une épopée, mais l’histoire d’une famille. Les Vikings, sous l’image qu’on en garde, étaient moins des guerriers que des juristes. Au coeur des ces histoires, il y a toujours un contentieux. Elles rapportent dans un style très narratif parfois avec un esprit de thriller, les aventures des colonisateurs de l’Islande et de leurs descendants. Sans lyrisme aucun, oscillant entre la banalité du quotidien et la démesure de l’exceptionnel, les auteurs, presque tous anonymes, ont su traduire une grandiose conception de la condition humaine : véritables artisans de leur destin, les personnages préservent, par la vengeance ou la justice, la réputation qui les sauvera de l’oubli et les fera triompher de la mort. La plus aventureuse :la saga d’Erik le rouge, qui découvre l’Amérique ; la plus terrible, à lire absolument : la saga de Njall le brûlé, un thriller avant l’heure, du meurtre, de la vengeance, de la famille et de la rédemption.
40. Chrétien de Troyes – Perceval le Gallois ou le roman du Graal.1180. C’est un des plus fascinants roman courtois, genre populaire du Moyen-Âge, bien qu’écrit en vers (octosyllabiques, la norme d’écriture littéraire de cette époque). De belles transcriptions existent et en rendent la lecture accessible, et même plaisante. C’est une histoire de pudeur et d’amour, mais aussi un des premiers récits initiatiques français. Perceval est « chaste » et « fol », c’est-à-dire d’une ingénuité qui le rend supérieurement pur et toujours sensible à la beauté ; meilleur chevalier du monde, il domine toutes les situations périlleuses qu’il traverse, sans en percevoir le plus souvent le péril. Et c’est aussi pourquoi c’est lui qui le trouvera. Quoi ? Le Graal, bien sûr.
41. Multiples auteurs – le Roman de Renard – 1200 : c’est un récit disparate, touffu et rebondissant, qui met en scène des animaux, bien avant La Fontaine, pour évoquer les défauts des hommes en société. Il y a des gentils et des méchants, selon la représentation qu’on a des animaux au cœur du moyen-âge, dans une dimension pittoresque, voire satirique. Et c’est traité avec du réalisme, de la morale et de l’humour. Bref, une somme de fables et contes, de tradition orale, qui se ramifient et se démultiplient, rassemblés peu à peu dans une vulgate. Chez renard, si souvent malmené mais qui s’en sort tout le temps, on relit un peu en filigrane, Ulysse. Il prend tout en pleine face, mais survit, à chaque fois plus intelligent.
42. Kamo no Chomei. Notes de ma cabane de moine. 1212. C’est un manuel de solitude. Les auteurs japonais ont sans égal l’art de fixer les sensations en quelques mots. Déçu de ne pas avoir obtenu une position de poète officiel près de l’Empereur, Chomei se retire définitivement dans la montagne, dans une minuscule cabane dont il fera un havre de belle conscience. De l’art de la contemplation – intérieure et extérieure – et de la vie simple, celle que nous avons perdue de vue, qui regarde en reflet la vanité des entreprises humaines. En fait, c’est comme une sorte de manuel de cette liberté qu’offre la vie érémitique. Texte très court (trente pages dans son unique édition) qui vous permettra donc d’y revenir souvent.
43. Anonymes – Carmina Burana. 1225 à 1250. Ce n’est pas un seul texte mais une foule de poèmes qui construit bel et bien un corpus cohérent. Ce recueil – dont on doit le titre tardif à un linguiste allemand du XIXe siècle- est une compilation de chansons, notées en neumes médiévaux, d’auteurs divers mais anonymes pour la plupart. Composer des chants à boire et inviter à l’amour physique – pas celui du Christ, nous sommes d’accord- menait alors droit à l’excommunication. C’est de la littérature lettrée, pour oser un pléonasme, mais d’essence goliardique (terme oublié : des moines errants qui concilient leur renoncement chrétien avec la joie de vivre païenne) ; on y clame les désirs contraints de la jeunesse, la pesanteur de la religion, et des traits acerbes de critiques sociale : même si l’ordre établi de l’église n’est pas souvent attaqué, la chevalerie, étonnamment, y est plutôt malmenée et montrée comme une affaire de brutes. Cela dit, le thème principal, et récurrent de ces chants, est bien l’alchimie heureuse que donnent le printemps, le vin, les fleurs, la jeunesse, bref : une célébration de la vie brève qui ne se prend pas au sérieux. Donc, c’est moderne…
44. Jean de Meung -Guillaume de Lorris -Le roman de la rose. 1235 à 1270. Imaginez un roman commençant sur un mode courtois, qui vous conte l’aventure d’un homme cherchant à se faire aimer de sa belle ; c’est alors très allégorique et empreint de merveilleux. Puis ce registre s’interrompt. Le texte est repris quarante après par un second auteur, lui aussi génial. Mais ce premier aspect l’intéresse moins, et ça évolue alors vers une réflexion philosophique sur l’amour et ses interactions sociales ; parfois, pointent aussi une forme d’autodérision de l’auteur sur ses propres sentiments, ainsi que des digressions satiriques (sur les ordres monastiques ou la noblesse… 22000 vers octosyllabes, et c’est bien un roman. Dans l’ensemble, un monument, qui fut un des livres les plus lus et les plus fameux du moyen-âge. L’introduction, peut-être, de la psychologie dans la littérature de langue française.
45. Anonyme – Lancelot Graal- entre 1200 et 1250. Dans ce tout premier roman en prose, pas d’unité entre les cinq livres qui le composent, sauf celle du héros. Lancelot, c’est vraiment le modèle médiéval du type bien. Il a tout pour lui : élevé loin du monde par les fées (ah… La dame du Lac…), il est vaillant, prude (c’est-à-dire sage, à cette époque-là) il est noble, droit, généreux, clément etc. Mais voilà : il reste homme, avec de la chair et des émotions – contrairement à son fils, l’archangélique Galaad -et le voilà empêtré dans son destin. Voulant rendre service, il se ridiculise sur une charrette, car un chevalier ne monte pas avec un paysan dans une charrette de foin. Ce faux pas le suivra partout. Et le voilà qui commet l’irréparable : lui, si fidèle et dévoué à son roi (Arthur, évidemment) il s’éprend de sa reine, et sa reine s’éprend de lui. Alors tout s’effondre. Le roman est plein de personnages de la table ronde, de fées et de paladins, d’énigmes et d’épreuves. Moins intérieur que Perceval le Gallois, plus narratif, il trace bien le cheminement d’un destin et en cela, se fait résolument moderne. Plus pessimiste aussi sur la nature humaine : le meilleur des hommes est vulnérable, parce que tout sublime paladin qu’il est, il reste un homme.
46. Dante- La Comédie (Divina Comoedia) – 1320. Un des sommets- non, disons-le- LE sommet de la vision poétique médiévale, et une œuvre universelle absolument, qui domine toutes les autres de son temps. Ce poème immense est si marquant qu’il a généré un adjectif absolu : dantesque. C’est au souffle et à l’incandescence jamais égalés de ce chef-d’œuvre que le terme fait référence. De la « Comédie » on ne retient souvent que « l’Enfer », première partie hallucinée, tellement adulée et réinventée par les romantiques, et particulièrement les musiciens (Listz ou Tchaikovski.) Le « Purgatoire » et le « Paradis » s’en trouvent un peu négligés, sans doute car leur long cheminement vers l’épure céleste est de plus en plus spirituel et de moins en moins tourmenté. La lecture de ces deux autres volets donnera aussi de grands moments de richesse, passé un peu d’ascèse, car Dante ne se lit pas comme Tintin. Mais c’est aussi un langage poétique très sophistiqué, où certaines constructions peuvent échelonner jusqu’à cinq interprétations différentes. Et n’oublions pas que derrière cette immensité de la tragédie humaine face à la religion, il y a un amour éternel du poète pour sa chère Béatrice : toute l’œuvre, d’ailleurs, n’est qu’un prétexte pour la retrouver, parmi les âmes sublimes et rares qui contemplent dieu en face- pour l’éternité.
47. Boccace – le Décameron – 1350 : ce recueil de cent nouvelles (« livre des dix journées») est un des plus anciens ouvrages en prose. Alors que la peste noire ravage Florence, dix jeunes gens se retirent à la campagne en espérant échapper au fléau, et chacun raconte chaque jour une histoire sur un thème imposé par le roi ou la reine de la journée (chacun des dix à son tour). Le tout nous donne un paysage constamment réinventé, et très vivant, de la fin du moyen âge. Il y a beaucoup d’histoires d’amours dans ces récits – normal, ce sont des gens qui s’ennuient-, de tromperie, de rêves contrariés. Mais on peut penser qu’après notre expérience du confinement, le Décameron sonne dans notre conscience, de façon très moderne, comme une réinvention du monde par la littérature, cette sublime et constante échappée…
48. Pétrarque- Mon secret- 1351. Dans ce très beau texte, peu connu et très éloigné dans son esprit du fabuleux Canzionere, Pétrarque discute. Il discute et dispute avec un Saint-Augustin ressuscité pour l’occasion, sur le mode très platonicien du dialogue. Malgré son religieux interlocuteur, il n’est que très peu question de Dieu ; mais de l’âme, de l’amour, de la vie, de la sagesse, de la beauté. Le poète majeur transparaît à chaque échange sous les thèmes de cette philosophie. Augustin fait ici le pédagogue, qui interroge, sermonne, contredit, toujours sur un ton soutenu ; et pourtant, jamais sévère. Pétrarque écoute, défend, répond, et doute, beaucoup. Une leçon de savoir, dans une langue claire qui porte doucement l’esprit du lecteur. Mais quelle que soit l’altitude intellectuelle du dialogue, et du raisonnement qu’il soutient, il y a une part intime de l’âme qui échappe aux arguments, et que Pétrarque ne lâche pas. C’est cela, son « secret ». Décidément, avec cet incroyable trio de géants (cf. les deux précédents), la littérature, à cet instant de son histoire, est bien en Italie.
49. Shin Nai An/Luo Guan Zong. Au bord de l’eau. Milieu du XIVe siècle. On ne sait trop qui a écrit ce monument, du moins si c’est vraiment Shi Nai An (pour peu que celui-ci ait existé…) ou son éditeur Luo Guan Zong, ou si les deux se sont complétés. Et ça n’a aucune incidence sur la qualité époustouflante de ce gigantesque roman (2000 pages dans son édition Pléiade). L’intrigue est assez simple : comment 108 brigands, en révolte contre la société et contre un mauvais empereur (au début il a été maudit par les dieux), se rejoignent les uns après les autres dans un vaste marais, puis défient les autorités malfaisantes, avant de rentrer dans les rangs pour servir l’ordre et la justice… C’est donc une vaste confrérie de cent-huit brigands-justiciers : la première partie déroule le rassemblement progressif de cette cohorte, en décrivant chaque fois la destinée particulière des personnages, histoire de faire connaissance : tous sont accusés d’un crime, qu’ils ont commis ou pas, justifié le plus souvent par l’iniquité de l’ordre corrompu des mandarins, jusqu’à ce qu’ils intègrent la bande les uns après les autres. La seconde traite des aventures de cette formidable table ronde, sans la table, au service de la justice et de l’empereur. On a souvent comparé Au Bord de l’eau avec les trois mousquetaires, mais avec cent-huit au lieu de trois…. C’est éblouissant d’actions et de narrations mêlées, assez addictif malgré le volume. Surtout, on découvre la Chine des Song, foisonnante et secrète, mais toujours subtile. Le style est fluide jusque dans la traduction. Il faut savoir aussi que ce long texte, comme souvent les romans classiques chinois, sera continué et enrichi par des conteurs anonymes jusqu’au XVIIe siècle. C’est une des œuvres les plus fameuses du patrimoine littéraire chinois.
50. Thomas Mallory- Le Morte d’Arthur. (« La mort d’Arthur »). 1469. Écrit en prison, ce cycle rassemble une nouvelle fois, dans une version qui essaie d’être exhaustive, l’épopée d’Arthur et de la table ronde. Le récit déroule de la jeunesse première d’Arthur – l’épisode de l’extraction d’Excalibur- et le parrainage de Merlin, jusqu’à l’effondrement et la fin de la chevalerie qui suit la quête du Graal. A noter que si la quête est montrée comme le sommet de la chevalerie, le récit est clairement – et mystérieusement – daté en 474, soit un âge auquel la chevalerie est bien loin d’exister encore, tout en étant composé à la toute fin du Moyen-âge, quand la même chevalerie disparaît. C’est un texte tragique, comme l’indique le titre qui scelle toute la trajectoire d’Arthur, alors que le roman commence par son enfance. Cette lecture laisse une certitude. La quête du Graal, parfois galvaudée mais si souvent réinventée, reste le plus grand mythe de l’Occident.
51. Sebastian Brant. La Nef des fous. 1494. Bien avant La Bruyère, Brant a eu l’idée de décrire de façon chirurgicale le détail des travers des hommes en société. Il imagine celle-ci comme une nef chargée de fous, abandonnée à elle-même et sans cap tracé, qui vogue vers sa perte. Le thème du bateau ivre s’efface d’ailleurs assez vite, pour laisser la place à une énumération des défauts humains, et de ce qu’on appellerait de nos jours, des névroses. Cent-treize chapitre défilent ainsi, jusqu’aux deux derniers (« apologie du poète» et « le sage ») un peu plus optimistes sur la nature humaine. C’est amusant, mais à ne pas lire sans doute dans l’ordre et d’une traite, sous peine de se lasser. Tout le monde en prend pour son grade, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres, les clercs, les nobles, les marchands etc et tous leurs défauts sont méticuleusement scannés, dans les contorsions qu’impose la société : l’ambition, l’hypocrisie, la dévotion, la flatterie, la cupidité et patati patata. Mais dans cette attention assez nouvelle à la psychologie sociale, il y a quelque chose d’inédit qui monte et se dévoile : l’humanisme. Désormais, l’homme est au centre de la littérature, et sa relation avec Dieu passe-enfin – au second plan. Le moyen-âge est terminé.
CHAPITRE III. LES CLASSIQUES.

Le terme de classique est sans doute un peu artificiel. Il regroupe sur les ouvrages qui suivent, une idée de perfectionnement de la littérature, qui, de l’Europe à l’Asie, devient un phénomène majeur des sociétés qu’elle éclaire. Ce regard approfondi, et comme devenu soudain nécessaire, sur la personnalité de l’homme et les interactions sociales identifiées, s’accompagne d’un souci considérable de forme et de progrès de l’écriture.Tout progresse, dans ces lettres au style plus abouti, comme sous l’effet d’une recherche universelle. La prose, le vers, le discours, la grammaire et le discours ; on représente sur scène, mais aussi on imagine et on conte à tout va. On s’interroge, on questionne, les personnes, l’univers et la religion, omniprésente, et archi-vigilante. On dresse des épopées, mais aussi on se moque et s’amuse de tout. On lit aussi, et on en parle. On vénère les anciens – être cultivé au Grand siècle, c’est lire Horace dans le texte.L’enjeu majeur est alors l’élégance. Pour ce qui est de la langue française, elle n’aura jamais été si bien écrite.Si on exclut d’une part la poésie si brillante et nouvelle et d’autre part la philosophie religieuse, le 16e siècle paraît plutôt pauvre en regard du siècle qui va suivre.
La renaissance constitue néanmoins un moment rare ou l’humanisme devient en quelque sorte la raison d’être de la littérature. Par la suite, au siècle suivant, celle-ci prendra son essor grâce à une perfection du style sans égal, et la conquête de tous les sujets possibles. Ainsi, loin d’être une forme de carcan alignant de façon compassée des thèmes exclusivement sublimes, le classicisme littéraire peut se comprendre plutôt comme une sorte d’Eldorado où tous les sujets sont à découvert. Que ce soit dans le théâtre ou le roman, en passant par le mémoire et la lettre, le conte ou la méditation, toute la littérature du XVIIe siècle explore un nouveau territoire du moi dans la foulée d’une prise de conscience de l’individualité face à la société. De la comédie au tragique, l’esprit littéraire s’envole.
52. Érasme- Eloge de la Folie- 1511. De l’œuvre immense et profuse d’Érasme, on ne retient que ce livre. Ce n’est pas un Essai à la Montaigne, mais il le qualifie lui-même de declamatio. C’est-à-dire une thèse au sens où on l’entendait à l’époque, qui soutient et développe un point de vue. C’est écrit en latin, langue des érudits avant tout. La déesse de la Folie nous parle, pour aligner dans son viseur, une à une, toutes les professions et les classes sociales de ce temps : ceux qui tiennent la société et la font telle qu’elle est sont tous fous ; ne l’aviez-vous pas remarqué ? A la lecture, c’est assez amusant. Si le clergé en prend son grade, c’est parce qu’Érasme, tout humaniste qu’il est, garde la nostalgie d’un christianisme humble et au seul service des hommes. Sans le vouloir, Il aura écrit une œuvre d’une espèce nouvelle absolument dans les codes de son temps. En situant la folie au cœur des passions humaines, il ouvre par ce décalage la voie aux grandes satires du genre humain, Rabelais, Molière, Shakespeare et toute cette grande famille.
53. Nicolas Machiavel- Le Prince-1532. Le mode de pensée de cet auteur, et son objectivisation absolue du politique, lui valut d’entrer dans le dictionnaire par un qualificatif qui lui est dédié : machiavélique. Machiavel est le premier à couper irréversiblement le lien, entretenu depuis Platon, entre la politique et la morale. Désormais, l’objectif de la politique n’est plus le bien commun, mais le pouvoir du Prince, c’est-à-dire du chef d’État. C’est là toute sa modernité. Son œuvre est encore riche d’enseignement, à la fois pour les gouvernants mais aussi pour les gouvernés. Affublée d’une réputation de cynisme, la pensée de Machiavel n’est pourtant pas exclusivement tordue, ni soumise. Si vous voulez voir de la vraie politique pure et cruelle pour certains, réaliste pour d’autres, vous y trouverez bien sûr cette facette. Mais ce n’est pas que cela : c’est aussi l’art du compromis, de la négociation, et une façon de toujours faire entrer le point de vue de l’autre dans la décision politique à prendre. Quant au peuple… Il attendra l’invention de la démocratie pour devenir sujet de préoccupation.
54. Rabelais- le cycle de « Gargantua »- 1534. Lui aussi, a marqué les lettres par un autre qualificatif : « rabelaisien » ; une fois qu’on a dit ça, on a tout dit: un langage cru, de la bouffe et du sexe, de l’humour, et en tout cela, la critique acerbe du progressisme… grossier, mais jamais vulgaire. Ces géants, dont la lignée bouleverse les certitudes des hommes, qui se goinfrent, braillent, pètent et tonnent à chaque page, incarnent l’appétit de savoir, souvent chaotique, de la renaissance ; mais aussi, la défiance vis-à-vis des institutions religieuses et politiques de cette époque de grand tournant, qui, soucieuse avant tout de maintenir leur état (cf. paragraphe précédent) ont oublié le peuple. C’est aussi très drôle, il faut bien le dire. A méditer et savourer, à condition de ne pas être trop bégueule. Le texte originel, dans une langue chaotique, sera difficile à la lecture.
55. Michel de Montaigne – Les Essais- 1580. Sans conteste un des esprits les plus beaux, par sa tempérance et sa distance, Montaigne a inlassablement creusé son propre moi. « Je suis moi-même la matière de mon livre ». C’est œuvre de toute une vie (Montaigne l’a travaillée jusqu’à sa mort et il y écrit notamment la célèbre formule « Que philosopher, c’est apprendre à mourir ») et pourra toujours vous aider dans votre vie à vous. Là, tout n’est que bonté -Montaigne avait de son père, reçu l’éducation nécessaire à ce conditionnement. Car oui, il y a trois tomes, ce qui peut paraître beaucoup à certains, mais il faut savoir qu’ils sont tous organisés en petits chapitres indépendants les uns des autres, et vous pouvez vous amusez à picorer çà et là dans les thèmes qui vous intéressent le plus. La vie, la maladie, la connaissance, le « goûst des livres » la jeunesse, la vieillesse, et bien sûr, l’amitié. Là aussi, le texte en français modernisé sera plus facile à lire que le texte originel.
56. Brantôme – Vie des dames galantes. v 1580. A la fois prêtre, soldat, séducteur, courtisan et guerrier, puis infirme et écrivain, Pierre de Bourdeilles, est inlassable dans sa ferveur. De ses volumineux souvenirs d’une vie de combat et de conquête, l’histoire détache cette « Vie » des dames, qui sont autant d’amours et de séductions qu’il aura traversées dans sa vie. Il sait tout des femmes de son temps, et donc, du genre humain. Il sait beaucoup de choses, également, sur leurs désirs, et leurs plaisirs, et sait si bien l’écrire. Souvent indulgent pour leurs défauts, admiratifs de leurs vertus, il détonne sur son époque car il retrace des portraits et des types complexes, tout en profondeur, loin des stéréotypes usuels des lettres de la renaissance.
57. Wou Cheng Gen. La pérégrination vers l’Ouest (Si Yeou Ki). Vers 1580-1590. Ce classique de la littérature chinoise retrace de façon imagée et aventureuse, l’expédition du moine Xuán Zàng qui se rendit de Chine en Inde pour en rapporter les textes authentiques du bouddhisme, afin de les traduire en chinois. Accompagné dans sa longue pérégrination, de quatre protecteurs fabuleux- un singe magique, un dragon, un cochon, et un simple bonze – il affronte toute sorte de monstres hostiles à son dessein, et surmonte, comme on s’en doute, des péripéties incessantes : plein de sortilèges et des bagarres. Parfois, on peut penser que le personnage du roi singe, Sun Wu Kong, est le principal, tant il prend de place dans la narration. Le bonze Zang est d’une incroyable naïveté, qui fait l’intérêt du caractère : du coup, les superpouvoirs de ses acolytes dénouent les situations avec facilité ; c’est un conte. Malgré la dimension -mille cinq cents pages- le récit reste fluide et se lit avec plaisir de bout en bout. En outre, on y explore dans un registre déjanté, les origines du bouddhisme et les aspects légendaires de sa doctrine. On peut s’y plonger sans risque, on sort très enrichi de toute cette fantaisie. Probablement le plus chinois des livres chinois de ce florilège.
58. William Shakespeare. Le songe d’une nuit d’été. 1595-1596. Ce n’est sans doute pas la pièce de Shakespeare la plus profonde, ou la plus métaphysique. La plus poétique peut-être, et en tout cas notre préférée. Onirique, sa trame puise dans le marivaudage, et, par l’esprit qui l’éclaire de l’intérieur, Molière n’est pas si loin. Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre le roi des elfes et la reine des fées, un lutin et sa potion qui s’en mêle, des sortilèges et métamorphoses, et une troupe de comédiens amateurs qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince, tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange, un peu magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante qui ressemble à un rêve. Deux thèmes majeurs et à venir, du théâtre moderne s’échangent et s’enrichissent : le théâtre dans le théâtre, et la confrontation de l’amour vrai avec l’amour idéal. Rien que du plaisir de lecture. (A lire du même auteur , évidemment, plein d’autres choses : Hamlet, Roméo et Juliette, le Roi Lear, Richard III etc etc)
59. Cervantès- Don Quichotte- 1605 et 1615. C’est peut-être ça, le chef d’œuvre des chefs d’œuvres. Faut-il choisir le réel ou l’imaginaire ? Ce texte immense est à la croisée de tout ce qu’a produit la littérature – en Europe -jusqu’à présent, et de tout ce qu’elle va produire encore. Don Quichotte est un mythe moderne, qui interroge, grâce à l’humour et la parodie, sur ce qu’est la connaissance du réel. On peut le lire comme un simple conte, et on peut le lire comme un essai de métaphysique. Les niveaux de lecture pertinents sont très ouverts, toujours la marque des grandes œuvres…Mais ne vous identifiez pas trop dans votre lecture, à Sancho Pança (c’est lui le personnage principal, et non Quichotte, attention, c’est un piège) : vous serez déçu du monde.
60. Xu Xiake. Randonnées aux sites sublimes. 1636. Xu n’est pas à vraiment dire un écrivain, mais un voyageur de génie. Il sillonne la Chine des Ming – à pied le plus souvent- et nous en décrit inlassablement les paysages, en ne sélectionnant que les plus grandioses, qui ne manquent pas dans ces contrées extraordinaires. Ce ne sont donc que descriptions de paysages, attentives et quasi-photographiques. Des cimes ennuagées, des cascades argentées, des horizons qui s’échelonnent et se perdent dans la lumière, des pluies qui animent les lignes et les contours… On ne sera pas tenu de tout lire, dans l’ordre des pages : on peut s’y promener comme Xu dans ses paysages…Ce qui est captivant, c’est cette énergie de contemplation totale, des formes sublimes de la nature, pour en rapporter, par les mots et l’écriture, leurs enseignements aux hommes qui ne les connaîtront sans doute jamais.
61. Pierre Corneille- Le Cid- 1637 : Corneille c’est un peu pesant quelquefois ; mais toujours sublime, et ça c’est incontestable. il est le maître absolu de l’alexandrin de théâtre. Le Cid est probablement un condensé non seulement de son art, mais du théâtre du 17e siècle, car tout y est dit : la guerre intérieure de l’âme entre l’amour et le devoir, la volonté et le destin, l’individu et la famille, l’honneur et l’intérêt. La composition est parfaite, de l’exposition jusqu’à la catharsis. Les postures improbables de cette histoire deviennent d’une crédibilité complète, et c’est palpitant. Bref, Corneille, c’est le cinéma avant son temps. Et c’est aussi le propre de ce théâtre, par sa puissance de représentation, de mettre sur la place publique des lieux des hommes, des temps, qui étaient ignorés jusque-là mais par la suite, nous deviennent irréversiblement familiers. Qui connaissait le Cid et la Reconquista avant Corneille ? Pas nous en tout cas. (A lire aussi du même auteur : Horace, Cinna, la place royale).
62. Thomas Hobbes – Le Léviathan – 1651. Disons-le tout de suite, c’est un monument de la pensée politique, un énorme pavé. Les deux premières parties sont les plus intéressantes et vous suffiront : « De l’homme » et « De l’État ». Hobbes parmi les premiers, essaie de comprendre par quel procédé les hommes vivent en société, pourquoi il y a un État, et qu’est-ce qu’un État. Sa thèse est extraordinairement percutante, si l’on résume vite : à l’état de nature, tous les hommes sont livrés à leur pulsion et c’est le chaos. Pour sortir de cette « guerre de tous contre tous », tous les hommes se réunissent et décident de canaliser toute leur violence, en faisant un pacte. Ce pacte social, par lequel chacun promet la paix, c’est ce qui fonde l’État. D’où l’inévitable transcendance de ce même État. Mais avant tout le monde, Hobbes voit déjà dans le risque tentaculaire d’un État si puissant, tant voué à l’entropie, que l’individu est menacé. Sa leçon est simple : prenez garde, nous dit-il.
63. Scarron- Le Virgile travesti.1653. Alors ça, ça vaut le détour…Scarron était infirme (il avait perdu ses deux jambes) mais toujours d’une humeur riante. Archi-érudit, il écrit d’un verbe joueur qui reprend toute l’Énéide sur un mode parodique, souvent burlesque et disons-le, plutôt libertin. Et tout ça en sept livres denses, tout en octosyllabes… Le sublime originel du texte de Virgile, parfois empesé, est distordu vers le comique. Et ça marche, c’est drôle et d’une lecture rayonnante… Cet Ovni littéraire nous séduit par la facilité de l’écriture parodique. Scarron n’eût pas le temps de parachever son ouvrage, d’autres le firent avec moins de brio.
64. Cyrano de Bergerac. (Hector Savinien) – Histoire comique des États et Empires de la Lune. 1657. Hector Savinien est une personnalité littéraire assez unique, il faut le reconnaître. Il nous emmène dans la Lune (le transport s’y fait avec une facilité déconcertante, Jules Vernes est largué…) non pas pour nous stimuler l’imaginaire avec toutes sortes d’inventions et de chimériques créatures, mais pour faire un peu de morale. Force est de constater que les nations de la lune sont mieux gouvernées que celles de la terre, par la description qu’il nous en fait. Foisonnant panthéisme, coloré d’enchantements et de fantaisies, à la fois roman d’aventure et conte philosophique, Hector Savinien/Cyrano nous dépouille de nos habitudes chrétiennes en ce milieu de XVIIe siècle et nous offre tout l’éventail de sa philosophie d’homme libre : c’est un monde immanent mais rationnel, aux peuples humains préservé des folies des hommes. Toutes sortes de considérations sur le bien, la sagesse, l’art de gouverner ou la place de dieu parmi les hommes, nous éclairent ; c’est un peu bavard, agité d’anecdotes en tous sens, et assez diffus. Parfois, on oublie un peu qu’on est sur la Lune, et c’est exprès. Mais on ne s’ennuie pas. Et à la clé, un enseignement de la sagesse, sans se prendre jamais au sérieux. Imaginer un monde meilleur permettra toujours d’améliorer un monde mauvais. Finalement, il ferait presque bon vivre là-bas. Sacré Cyrano…
65. François de la Rochefoucauld- Réflexions ou sentences, et maximes morales- 1665. Ces étonnantes – et éternelles dans leur vérité – Maximes ont été conçues à l’origine pour alimenter la conversation dans les salons de (la Marquise) Madeleine de Sablé. D’où l’importance du dialogue, du langage, de l’échange et de l’écoute dans ces écrits. Il n’y a pas que des citations dans l’ouvrage, mais aussi des réflexions et des méditations dont certaines peuvent couvrir plusieurs pages. C’est parfois très raisonnant, et même abstrait. Bien sûr, on s’y intéresse principalement aux versants négatifs de la personne humaine. Mais c’est toujours d’une saisissante vérité, et systématiquement rationnel. On peut ainsi s’y promener, comme dans une conversation heureuse. Voltaire le dira plus tard, c‘est un livre qui a « formé le goût de la nation », et caractérise parmi les premiers, l’esprit français dans ce penchant qu’il aura toujours pour les idées et les argumentations. Finalement, c’est très moderne, La Rochefoucauld, et on s’y retrouve toujours. Utilisez donc ces maximes-là dans vos conversations de politique ou appliquez-les aux chicaneries de nos quotidiens, vous verrez que leur effet est bien là…
66. Jean de la Fontaine- les Fables – 1668 et après : principale œuvre poétique de la période classique et à ce titre monument de la langue française. Chaque écolier français en connait au moins une mais ce ne sont pas moins de 249 fables qui constituent un patrimoine plein de verve, de malice et de bon sens. Il n’y a pas que des animaux qui s’échinent à nous faire la morale (au sens haut du XVIIe siècle) ; les fables nous disent surtout la vérité des âmes humaines. Autre qualité : la langue y est parfaite. C’est pour cela sans doute que ces textes ont aussi bien voyagé à travers les siècles, et nous parlent aussi efficacement des choses à faire surtout et surtout ne pas faire.
67. Blaise Pascal- Pensées-1669. Démonstration, à la fois modeste et scintillante, de ce que peut établir l’intelligence. Chaque pensée de cet « effrayant génie » (dixit Paul Valéry) est un régal pour l’esprit, et peut se méditer des heures. Car Pascal est trois auteurs à lui seul : un grand philosophe, un grand scientifique et un grand religieux. Sa clairvoyance est éblouissante, et enrichira chacun de nos neurones à chaque lecture. Il traversa notamment un moment mystique qui le révéla à sa conscience chrétienne (un peu comme douze siècles avant lui, Saint-Augustin), dont on a encore les traces puisqu’il l’a mis en écrit. Puis il se tourna vers la doctrine du jansénisme (un christianisme épuré et pas vraiment comique). Les pensées font partie de ces livres qui peuvent accompagner nos esprits déprimés vers de beaux et relevés horizons, sous les affres de nos quotidiens incolores. On devient plus intelligent, à lire les Pensées.
68. Molière- Le malade imaginaire- 1673. Retenir ici une pièce de Molière, et pas deux ou plus, est un défi. Chez ce géant absolu – le premier du théâtre, devant Shakespeare (si si) – il n’y a rien à jeter. Si vous ne riez pas en découvrant cette pièce de théâtre, c’est que vous n’avez pas mis le ton en la lisant. Sous le comique dérisoire des premiers rôles de Molière, il y a la tragédie que nos vices et nos folies impriment à notre condition. Argan est désespérant parce que désespéré, et sa souffrance fantasmagorique n’est pas feinte. Les bouffons et les tartuffes inventés par cet ami du Roi Soleil sont d’une modernité éclatante. Ils sont notre éternel miroir. (À lire aussi de Molière : tout le reste…)
69. Jean Racine – Phèdre – 1677. Un des textes les plus évolués, les plus raffinés, les mieux composés que nous a laissé la langue française, et tout simplement, un des plus beaux – de ceux qui se comptent sur les doigts d’une seule main. Avec Racine, tout est élégance et raffinement. Rarement l’émotion, la pudeur, l’amour et ses tourments, ont trouvé expression plus réussie. Réputé impossible à mettre en scène, Phèdre est un poème dramatique. Le drame – qui monte à chaque rime, comme un flot – d’un amour impossible, pour nous en saisir tout entier. C’est beau, et tout est dit. (À lire aussi : Andromaque, Iphigénie…)
70. Jean de La Bruyère – les caractères ou les mœurs de ce siècle – 1688: styliste de la langue avant tout, La Bruyère est moraliste plus que portraitiste. On retient de lui les descriptions anecdotiques de personnages étalons des travers de la vie en société, mais plus des deux tiers des 765 caractères sont dépourvus de personnages : le sujet de La Bruyère, c’est la moralité. Il a cependant croqué une galerie incroyable de portraits saisissants des personnages de son époque. Derrière une langue très classique mais toujours aérienne, on est encore stupéfait de la modernité de ces observations (et ce n’est pas moi qui dirais le contraire, pauvre et laborieux plagiaire !) ; remplacez les « grands » par les énarques ou les chefs d’entreprises, « la cour » par les médias ou les institutions publiques, prenez la Ville en tant que tel sans rien changer, et méfiez-vous de ne pas vous reconnaître dans tous ces traits qui fusent.
71. Marquise de Sévigné (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de…). Lettres. 1696. Elles ne sont pas nombreuses, les femmes de lettre du siècle classique. Mais celle-ci est exceptionnelle, et aura laissé bien des influences (Proust l’adorait). Car elle sait admirablement peindre. Elle fait de l’écriture sa passion quotidienne (plus de mille lettres dont les deux tiers à sa fille, dont certaines ne lui sont qu’attribuées), et adopte un style en transparence qui donne un ton de conversation, voire de monologue, adapté à toute forme de sujet qu’elle aborde. C’est surtout un regard, si rare, de femme, dans un siècle peu favorable, qui éclaire les comportements et les relations comme une lumière rasante de clair-obscur. Il y a beaucoup de clairvoyance dans ces phrases très lisses qui nous documentent à chaque page sur les mœurs contrastées d’un siècle brillant mais oppressant. Une belle âme, intacte après tant de temps.
72. Charles Perrault- Les contes de ma mère l’Oye (1697). Les contes sont beaucoup plus tranchants et osés que vous ne le pensez. Ils ont accompagné votre enfance, dans des versions remaniées en rose vers la fin du XIXe siècle, et c’est une raison suffisante pour les lire à nouveau. D’autant qu’à l’origine les contes étaient plus appréciés par les adultes que par les enfants. Vous y trouverez des grands classiques, comme Cendrillon, La Belle au bois dormant, Le Petit Poucet. Mais attention : vous ne retrouverez pas le joli côté charmant des narrations de votre enfance. Les contes de Perrault, dans leur version originale, sont cruels et tragiques. Le petit chaperon rouge est définitivement dévoré (ça lui apprendra à désobéir), le réveil extatique de la belle au bois dormant est le début d’un long cauchemar, l’Ogre est monstrueux absolument etc. A noter que ne reste de cet auteur et de son œuvre immense rien d’autre que ce volet mineur. A disparu de toute forme de publication de nombreux chef d’œuvre, tels son Apologie des femmes (1694), sans doute le premier écrit féministe de langue française, ou surtout, le fameux essai (pamphlet) des Parallèles des Anciens et des Modernes en ce qui Regarde les Arts et les Sciences (1696), la « querelle » des anciens et des modernes qui lui valut une grande notoriété et dont le regard critique changea le jugement commun sur la littérature.
73. Fénelon. Les aventures de Télémaque. 1699.Fénélon préfigure les Lumières par son souci de justice dans les gouvernements. Ce qui lui importe dans ses développements ce n’est pas la légitimité d’Ulysse mais l’éducation de Télémaque, qui sera la condition de sa survie politique. Telle est la leçon de Fénelon ; le juste gouvernement des sociétés n’est pas nature de naissance d’excellence il doit être l’effet d’un esprit instruit à l’infini. Parfois le récit -c’est un roman -emprunte aux péripéties du compte parfois à des développements didactiques qui s’adresse aux princes de son temps, et plus particulièrement au premier d’entre eux vieillissant et redoutable. Fénelon écrit probablement un des plus beaux français de toute notre littérature, c’est donc un plaisir d’y revenir ; mais avec son souci de philosophie, au sens le plus commun du terme, les préoccupations du grand siècle s’estompent déjà. Apparaît avec lui l’âge des lumières. (Du même auteur, à lire et méditer : Démonstration de l’existence de Dieu)
CHAPITRE IV. VERS LES LUMIERES.

Les voici, ces fameuses lumières qui éclairent… Les génies des lettres continuent de s’agiter pour la juste conscience des choses ; mais la particularité de ce siècle est une verve critique, assez pétillante, dans le regard porté sur la société et le tempérament des hommes qui la façonnent. Autre évolution notable : le roman, genre mineur au grand siècle, s’épanouit, et le recours à ce mode narratif pour transcrire les phénomènes et les travers du genre humain s’accélère. Et ce sont bien des portes qui s’ouvrent encore, toujours plus loin dans l’exploration du moi. Car le XVIIIe siècle a soif de raisonnement et d’argument en toute circonstance. On s’intéresse ainsi beaucoup plus à ce lien qui unit l’homme à l’organisation de ses congénères, au fil du destin et à la volonté qui s’en échappe. Un air de liberté emporte l’inspiration. Alors, dans toutes ces facettes explorées, se montre sous les mots toujours un fil discret mais très conducteur, qu’on n’imaginait pas avant. Cette société ne convient vraiment pas ; et si on la changeait ?
74. Jonathan Swift- Les voyages de Gulliver- 1726. Bien qu’irlandais, Swift est un parangon de l’esprit britannique. On peut lire dans Les Voyages de Gulliver une histoire amusante, une fable métaphysique, avec des trouvailles et des inventions inspirées. Mais il y a une soif d’ingéniosité à chaque page qui en fait un livre unique. Il y est question de casser les œufs, de géants et d’homuncules, d’îles volantes, de nourrir les hommes grâce à leurs excréments ou de récupérer les rayons du soleil dans les concombres. Et aussi, en filigrane, la dénonciation de l’oppression anglaise sur la nation irlandaise. Savez-vous pourquoi les chevaux intelligents du dernier voyage se nomment les houyhnhnms? Tout simplement parce que ce mot reste imprononçable en anglais. Bien fait pour eux. Voilà l’esprit de Swift.
75. Montesquieu- Considérations sur les causes de la grandeur des romains et de leur décadence – 1734. Avant l’Esprit des lois, Montesquieu écrit cette analyse profonde de ce que sont et peuvent les institutions dans l’ensemble de la société. De l’histoire, certes, mais surtout de la politique moderne. Montesquieu est le premier à faire le lien de pertinence entre la santé d’une société et l’état de ses institutions. Pour lui, la cause de la décadence est le décalage croissant entre les institutions de Rome (il nous parle de la fin de la république) est l’affaissement des vertus nécessaires à la bonne gouvernance d’une république. Quand la société est en phase avec ses institutions politiques, et tant que celles-ci répondent à celle-là, tout va bien. C’est simple et droit. Évidemment, nous, gaulois réfractaires, ça nous parle d’une façon étonnamment moderne. Et c’’est aussi un livre qui aura permis de structurer l’histoire en éclairant et limitant la notion de chronologie. (A lire du même auteur : De l’esprit des lois, évidemment).
76. Saint-Simon. Mémoires (1740-1750). Le maître du portrait littéraire, mais du portrait impitoyable. Nul n’est obligé de lire les dix mille pages environ de ces Mémoires, qui traversent l’histoire de l’apogée du règne de Louis XIV jusqu’au balbutiement des Lumières. On sautera les digressions, sans intérêt de nos jours, sur les généalogies nobiliaires. Mais Saint -Simon est sans égal pour relier la psychologie, l’invisible des personnalités qu’il côtoie, avec les moments de l’histoire. Son récit, à cet égard, de la mort de Louis XIV, vous marquera. Il sait peindre en quelques traits et maîtrise la formule de caractère avec génie. Journaliste avant l’heure, photographe des travers de la société, peinte en couleurs (hautes), et conteur intelligent, moraliste et aristocrate sans concession : on ne sera pas étonné de comprendre pourquoi Proust, admiratif, en fut si influencé.
77. Denis Diderot- Les bijoux indiscrets- 1748. En d’autres temps, on aurait dit qu’il s’agit d’un livre à ne pas mettre entre toutes les mains. Diderot nous invente l’histoire de Mangogul, un sultan qui s’ennuie tant que sa maîtresse, Mirzoza, est à bout de ressources pour le divertir. Alors intervient le génie Cucufa, pour fournir un gadget incroyable : un anneau, dont il suffira au sultan de tourner en direction d’une femme le chaton (sans mauvais jeu de mots…) et elle parlera « par la partie la plus franche qui soit en elle, et la mieux instruite des choses ». Bref, les sexes des femmes se mettent à raconter tout ce qu’ils vivent, ou ce qu’ils aimeraient bien vivre, et voilà notre sultan qui ne s’ennuie plus. Il fallait le trouver. On l’aura compris, Mangogul c’est Louis XV, et Mirzoza, la Pompadour. Sulfureux, certes, mais délicieux. Et surtout, dans cette déviation par rapport à ses raisonnements philosophiques de si haute altitude, le grand Diderot nous donne un conte social sur le plaisir des femmes, et un roman magistral sur l’inconscient et la morale. Somme toute, même si c’est par une voie qu’on n’attendait pas, Diderot libère la parole des femmes, qui ont bien des choses à dire. Et c’est une première. (A lire du même auteur : Lettre sur les aveugles, Le neveu de Rameau, La religieuse)
78. Henry Fielding. Tom Jones -1749. Dans ce vaste roman, qui, parmi les premiers à le faire, puise en partie dans l’autobiographie, Fielding entend décrire le détail de la nature humaine telle qu’elle est et non telle qu’elle devrait être. Ainsi, malgré une facette qui emprunte au picaresque, la dimension morale est souvent malmenée, pour interpeller le lecteur, le prendre à partie, voire lui annoncer ce que vont vivre ou découvrir les personnages. C’est très anglais, mais il y a déjà du Balzac dans ce volumineux roman, qui se lit très agréablement. Tom Jones est un modèle du héros social qui progresse dans la société, ne partant de rien (c’est un enfant trouvé) et toujours obligé de combiner à chaque étape de sa vie, la chance, le talent, et la bienveillance. C’est souvent drôle, modérément, et insolent, régulièrement inventif. Ce roman – un des plus réussis de tous les temps- est une pierre angulaire.
79. Cao Xue Qin-Le rêve dans le pavillon rouge- 1754- 1791. Quatrième roman-monument de la littérature classique chinoise d’après Mao Tse Toung, retenu par l’UNESCO au patrimoine du genre humain. C’est au début l’histoire… d’une pierre, qui nous parle du monde et de ses humains. Le récit perd vite cet angle pour aligner une nuée de situations et de sentiments, alors que les années passent. Mais le roman ne comporte pas moins de 480 personnages, tous parfaitement individualisés. On disait de Mao qu’il l’avait lu cinq fois (peut-être mais en ce cas, pourquoi la révolution culturelle ? Lire n’est pas comprendre, donc…). C’est un roman immense, de beauté et de raffinement. La recherche du temps perdu extrême orientale, qui se déploie sur plusieurs générations. La traversée de l’enfance, puis sa nostalgie, l’amour, le temps qui va, s’évanouit et revient ; et les complications de la société, que symbolise ce vaste parc qui s’épanouit, se dégrade avec les ans, puis se régénère à nouveau. Quand vous aurez lu les deux mille pages du Pavillon, vous serez tristes d’avoir fini, et aurez l’envie vague mais récurrente, d’y revenir un jour.
80. Voltaire. Traité de la tolérance-1763. On retient de Voltaire surtout ses contes, auxquels lui-même accordait si peu d’importance. Mais l’esprit scintillant de François Marie est bien plus vif quand il s’élève contre l’injustice et quand il prend cause pour ce qui l’exige. La langue est toujours limpide –c’est Voltaire- et toujours nourrie de cette ironie distante de la nature des hommes : Voltaire n’était pas un démocrate, mais il a dans le libre arbitre une confiance d’acier. Il saisit et démontre, parmi les premiers, combien la tolérance est une idée moderne. En janvier 2015, à la suite de l’attentat contre Charlie hebdo, l’ouvrage de Voltaire se place au sommet des ventes des librairies un peu partout dans le monde. CQFD…Qui dit mieux ? (A lire du même auteur: beaucoup de choses, Le dictionnaire philosophique, Zadig et autres contes)
81. Ueda Akinari- Contes de pluies et de lunes- 1776. Ueda Akinari, considéré comme le maître classique du conte fantastique japonais, eut une vie absolument romanesque, et c’est peut-être ce qui lui permit cette inspiration fantastique si délicate. Ce recueil de neuf contes, adapté de contes chinois, déroule des fantômes et des esprits, des regrets et des amours comme la nostalgie des vies antérieures ou inaccomplies. N’allez pas chercher dans le titre une symbolique orientale codée ; Akinari écrivait ces merveilles chaque fois que la lune lui paraissait mouillée dans son halo, ce qui dans l’imaginaire japonais, était le moment propice pour l’apparition des fantômes. Pourtant, jamais ces contes ne sont terrifiants. Adaptés splendidement au cinéma par Mizoguchi.
82. Edward Gibbon – Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain – 1776 à 1788 : dans cet ouvrage encyclopédique, l’auteur retrace l’histoire de l’empire romain et entend déterminer les causes de son déclin. C’est écrit comme un vaste roman, avec des personnages bons et mauvais, des batailles et des intrigues. Parfois, à l’instar des historiens antiques qui l’inspirent et dont il partage la fantaisie, Gibbons nous raconte des scènes, des dialogues, des discours comme s’il avait été là. Et on finit par le croire. En parallèle, il propose une histoire de l’Europe et de l’église pour la même période. Ne vous y trompez pas : ce qui intéresse Gibbon, ce n’est pas tant Rome (et Byzance, il pousse jusqu’en 1453) que l’Europe et ses monarchies qui s’affaissent. Et pour lui, la cause de ces mouvements est simple : la décadence des sociétés ou des empires n’existent pas, il n’y a que la faiblesse des hommes soumis à leurs passions.
83. Chen Fou. Récits d’une vie fugitive. v 1780-1790. Peu connu en Occident, Chen Fou est un écrivain tout en modestie. Ces Récits en six chapitres, sont sa seule œuvre connue. Tout y est dit de l’amour conjugal et la douleur contenue du veuvage d’un lettré pauvre mais heureux, qui trouve une éternelle inspiration dans l’errance, et le souvenir de l’être aimé. Voilà…
84. Emmanuel Kant- Critique de la raison pure-1781. Je garde personnellement une forme de tendresse pour cet ouvrage lumineux mais assez peu commode, il faut le dire, pour avoir réussi l’exploit, jadis en classe terminale, d’obtenir une note excellente à un devoir sur ce texte que je n’avais pas lu encore, sauf sa préface ; du coup, je me suis senti obligé, devant la grandeur de l’ouvrage et de son auteur, d’essayer de le lire et le comprendre, et c’est ainsi que d’une certaine façon, il est devenu un compagnon de jeunesse. Œuvre majeure de Kant et de toute l’histoire de la philosophie, ce livre est de ceux qui tracent une ligne entre un avant et un après. Kant établit les possibilités et limites de la raison, pour renouveler l’approche rationnelle. Il fait ainsi un procès -construit très intellectuellement- de la critique, telle qu’elle est comprise en cette fin du XVIIIe siècle : à l’heure où tout le monde, de nos jours, se veut légitime à dénigrer n’importe qui/ quoi/comment, on peut mesurer la modernité de cette pensée. Écrit dans un langage complexe, ardu, qui ne ménage pas l’entendement du lecteur, ce livre rebâtit le modèle de la pensée, ni plus ni moins. Il vous expliquera, si vous dépassez l’abstraction incroyable de son écriture (et c’est pas gagné) ce que c’est vraiment que juger ; juger une idée, un fait, une personne, une œuvre…
85. Pierre Choderlos de Laclos- Les liaisons dangereuses -1782. Cet ouvrage va plus loin qu’aucun autre de son temps dans l’exploration des travers psychologiques ; et il y est efficace. Composé seulement de lettres –ce n’est qu’un échange épistolaire, genre assez apprécié au XVIIIe siècle – cette œuvre vous captivera tant elle décrit si bien les sentiments cachés, les jalousies intérieures, et les relations amoureuses. Presque érotique. Mais surtout, un cynisme sans frein de ces nobles oisifs, qui n’ont rien d’autre à faire de leur vie que ruiner celle des autres pour se distraire. Il y a dans le malaise de cette perversité quelque chose qui monte, qui monte et qui fait deviner l’incendie en approche…Laclos était officier d’artillerie : il sait viser et faire mouche.
86. Jean-Jacques Rousseau- Les Confessions- 1782. Ce livre majeur est une première dans l’exploration du Moi qui irrigue toute la littérature européenne depuis la renaissance. L’auteur se livre entier, dans tous les aspects de sa vie, avec ses défauts et ses qualités. Et des miracles de style pour avouer sans avouer…Ce n’était pas chose courante à l’époque, Rousseau s’en trouve révolutionnaire, sans trop le savoir. Vous vous attacherez sans comprendre pourquoi à cet étrange écrivain qu’est Jean-Jacques, si brillant par ailleurs. Il est comme cela, Rousseau : il énerve et émerveille en même temps. (A lire du même auteur : les rêveries du promeneur solitaire ; Émile, ou de l’éducation)
87. Nicolas Edme Rétif de la Bretonne. Les Nuits de Paris ou le Spectateur nocturne 1788-1794. L’œuvre de Rétif, un peu oubliée, est immense. Scriptomaniaque, cet écrivain sans mesure nous a laissé des milliers de pages, qu’on ne lira jamais intégralement. Ces Nuits sont à parcourir avec fantaisie, comme elles sont écrites. Le narrateur arpente la ville une fois le soleil couché : il y rencontre toute sorte de figures nocturnes, tantôt avenantes, tantôt inquiétantes. Les situations en sont souvent immorales : peu importe, tel un justicier de la vertu, notre Rétif – c’est écrit à la première personne, on suppose que c’est lui -a vite fait de les sermonner et les ramener à la raison. Mais ce qui est amusant, c’est l’inversion avec laquelle il joue, notre noctambule auteur. Car ces libertins qu’il traque et corrige à chaque aventure, c’est lui-même. Rétif n’était ni prude ni dévot, ses mémoires en attestent. Alors il se fait plaisir, et renverse le miroir ; ça sert un peu à ça, la littérature…
88. Alphonse Donatien, Marquis de Sade- Justine, ou les Malheurs de la Vertu- 1791: difficile d’évoquer ce siècle sans citer le divin marquis. Fruit d’un esprit malade et tordu en tous sens, cet ouvrage est assez pornographique. Mais il doit être lu absolument, car il est aussi philosophique. Et d’une écriture presque parfaite. La jeune fille Justine est trop mise à l’épreuve, qui la mènent à des scènes de plus en plus crues, pour qu’on y croit. Mais Sade en montrant toute sorte de fantasmes- souvent très en couleur, parfois pas très finaud – exhibe ce qu’il y a de mauvais en nous : cette fascination, si moderne, de la souffrance. C’est ce qui fait que son œuvre nous obsède, il faut bien le dire. Encore un écrivain dont le nom sulfureux a produit un adjectif, d’usage moderne. Beaucoup auraient aimé égaler cette performance. Mais on n’est jamais sadique par nature.
CHAPITRE V. LE XIXe SIECLE.

Ce siècle est grand, car l’horizon imparti s’élargit considérablement. Il bouillonne et innove dans tous les sens. Marqué dans toute l’Europe de façon romantique par l’épopée Napoléonienne, puis la révolution industrielle, assoiffé d’imaginaire et de fantastique, ce siècle changera le sens même du livre et de la littérature. Il rameute toute sortes de mythes et en fait des chefs d’œuvres nouveaux. On honore l’humain et on le redoute en même temps, pour peu qu’on veuille le changer. Le roman devient le genre majeur, il explore les ressorts de ce qu’on ne nomme pas encore la psychologie, mais que ses écrivains décryptent admirablement ; la folie devient une obsession. Mais ce siècle littéraire se prend de passion pour l’écorché de la société, qu’il scrute comme un médecin ; l’écriture et ses génies essaiment alors sur toutes sortes de formes, dont certaines n’étaient que des approches aux siècles précédents. L’écrivain devient polyvalent, et produit du roman, du conte, du théâtre, de la poésie, de l’essai, philosophie, récits de voyage etc. Il est observateur de sa société, et en même temps, libèrent les passions les plus intimes. Romantique, et réaliste en même temps. Ce siècle de géants n’est pas raisonnable. Mais c’est un âge d’or.
89. Johann Wolfgang von Goethe- Faust- 1808. Pendant que l’Europe se déchire dans les guerres napoléoniennes, ce géant d’entre les géants produit ce mythe absolu. On pourrait gloser mille pages sur le sens de ce chef-d’œuvre. Jusqu’où doit aller le libre arbitre face à la tentation du mal ? Le contrat de Faust, c’est la condition humaine, ni plus ni moins. Le propre de l’homme est de transgresser la morale qu’il s’impose, pour aller chercher l’infini et assouvir son complexe de puissance. Le prix en est élevé…Mais tout n’est pas perdu : le mal aussi a ses limites, et commet des erreurs. Et puis, il y a l’amour, qui sauve tout. Goethe n’a pas inventé Faust, et la légende errait en Europe du Nord depuis le XVI è siècle : Marlowe en a laissé la première adaptation littéraire. Mais il place le mythe au centre de la littérature romantique naissante. Il y a un avant et un après Faust. Combien d’œuvres du siècle qui commence en seront marquées ? Plus tard, tous les thèmes modernes peuvent s’y refonder : le rêve, la science, l’écologie. L’homme reste un incorrigible apprenti sorcier, et le diable le sait.
90. Jacob et Wilhelm Grimm- Contes de l’enfance et du foyer- 1812-1815 : c’est l’autre nom pour les Contes des frères Grimm. Encore un monument rassemblant des contes qui ont bercé des millions d’enfants à travers les âges. Les frères Grimm – bibliothécaires de leur métier – ont accompli toute leur vie un énorme travail de collecteur (de légendes, d’histoires, de contines de toutes sortes – pour produire plus de deux cents contes, dont la plupart a été écrite à quatre mains, ce qui assez rare dans l’histoire. Peu d’invention, ni de composition originale, mais une réécriture de bien des histoires enfouies dans la mémoire européenne, et qui ressortent transfigurées, comme leurs chimères. C’est déjà le romantisme allemand, avec ses diables, ses fées, ses voyageurs mystérieux, ses forêts maléfiques etc. De la peur, un peu, et beaucoup d’onirisme bien avant Freud.
91. Ernst Theodor Amadeus Hoffman -Contes nocturnes (1817). Disons que c’est le modèle du romantisme allemand : nous ne sommes plus chez les Grimm. Ces textes ne sont pas des contes pour enfants saturés de fées et de merveilles. A présent, des forces créatrices se libèrent et ouvrent des portes nouvelles. Ce sont les fruits d’une imagination puissante, toujours à la lisière qui sépare le réalisme – ce qui existe – du fantastique – ce qui n’existe pas. Hoffman fut une somme de talents multiples (dessinateur, peintre, chanteur et compositeur de musique) : ces histoires observent l’âme et les abîmes qui la guettent ; elles sont donc parfois empreintes de terreur et de mort, mais plus souvent de fantaisie. Freud avait forgé la notion d’’inquiétante étrangeté pour les qualifier. C’est ce qui fait leur charme.
92. Mary Shelley – Frankenstein ou le Prométhée moderne (1818): théorie de l’homme artificiel : malgré son romantisme échevelé, le sujet du roman n’est autre que la science. La science dont on repousse tant les limites à force de certitude, que ça finit par déconner absolument. Au départ, d’ailleurs, la créature n’est pas monstrueuse vraiment : mais son organisme imparfait se dégrade irréversiblement, et elle est alors d’autant plus rejetée. Normal, son créateur est lui-même déficient, parce que mortel. Donc, elle devient méchante, et méchante, elle est condamnée. Boucle bouclée… Outre la trame fantastique de ce roman qualifié de gothique dès sa parution, l’ouvrage se distingue par sa construction en tiroirs. On est très près du monument précédent- Faust et le culte de la transgression. Décidément, le début de ce siècle formidablement littéraire explose tout de suite les frontières de la raison.
93. Giacomo Casanova – Histoire de ma vie – 1822: Personnage du XVIIIe dans son essence même, mais livre du XIXe , qui n’aurait pu exister et être lu sans l’esprit de ce nouveau siècle. La transmission jusqu’à nos jours de ce volumineux ouvrage aura été très laborieuse. Il a en effet fallu attendre 1960 pour accéder à une édition et une traduction, complètes, de ce témoignage exceptionnel (et même 1993 pour une traduction non déformée). Tout le XVIIIème s’y retrouve, et pourtant, c’est un livre qui devra attendre pour se faire connaître, comme s’il avait fallu et l’Empire, et le romantisme, et le réalisme pour lui donner son public. Voici Venise, et des carnavals, des fêtes, des courtisanes et des aristocrates, des voyages et des carrosses. C’est plus un aventurier qu’un écrivain, et ça se ressent parfois. Sans doute beaucoup d’exagération sur ses exploits, et d’autoglorification, avec une narration très autocentrée et plus qu’immodeste, mais ça rebondit, et ça captive tout du long : on prend quand même pour le formidable filé de cinéma qu’il nous laisse.
94. Emmanuel de Las Cases. Mémorial de Sainte Hélène- 1822 (à 1842). Nietzsche disait qu’il n’y avait que deux livres pour comprendre le siècle (c’est-à-dire, le XIXe) : le Mémorial, et les Entretiens de Goethe avec Eckermann (cf. infra). Ce Mémorial (document de plus de 2 000 pages) reste le témoignage le plus complet sur la légende, et la déchéance de l’Empereur. Cet énorme ouvrage réunit tous les ingrédients du romantisme, sans comprendre une seule phrase romantique, dans la parole du héros dominant et vaincu de son temps. Tout n’y est pas exact, et même franchement réinventé : Napoléon protecteur des libertés, continuateur de la révolution, acteur de la volonté populaire etc : on n’y croit pas vraiment… Mais voici le récit d’une épopée par son auteur, en direct, comme ça, sur le mode de la conversation, avec des notes jetées au fur et à mesure. Il y est plus souvent question de diplomatie ou de législation que de batailles. On est ébloui par la précision du verbe de Napoléon, pourtant non-écrivain. Et le contraste entre le souffle de l’aventure, et la médiocrité de l’existence quotidienne sur ce bout d’île, est en soi la leçon absolue de la condition humaine.
95. Stendhal- Le Rouge et le Noir – 1830. Encore un roman qui nous déroule la quête d’une ascension sociale. En fait, ce roman en deux parties est un double roman. Mais ce qui détonne dans le paysage romanesque existant jusque-là, c’est que le moteur de la progression sociale de Julien, c’est l’amour. Stendhal est un conquérant. La passion sans cesse exacerbée, et domptée en même temps au service d’un nouveau modèle de héros. Non content d’être probablement le suprême styliste de la langue française – avec Proust sans doute – Stendhal innove en approfondissant les ressorts de la psychologie sentimentale comme aucun autre avant. On ne comprend pas bien le titre : certains avancent que le rouge représente l’armée et le noir le clergé, qui sont les deux pôles vers lesquels Julien Sorel tend. Mais ça n’a aucune importance. (A lire du même auteur, La Chartreuse de Parme, évidemment, mais aussi Lucien Leuwen, et le Rose et le Vert, tous deux inachevés)
96. Théophile Gautier- Les Jeunes France- 1833. Superstar des lettres de son vivant, Gautier nous semble bien mineur, aujourd’hui. Il fut pourtant la personnalité littéraire la plus influente de son temps. C’est peut-être lui qui incarne le plus cet esprit inventif de son siècle. La suite de ces « Jeunes France» aligne plusieurs histoires mais toutes centrées sur de jeunes hommes romantiques, rarement héroïques mais souvent fatigués, à la fois blasés et angoissés de ce siècle imprévisible qui ouvre des horizons de toutes parts. C’est en quelque sorte, on l’a compris, un autoportrait scintillant que nous livre Gautier, dans un style un peu dépassé, mais tellement XIXe…. (A lire du même auteur : Le capitaine Fracasse, évidemment, et le Roman de la momie…)
97. Alexis de Tocqueville – de la Démocratie en Amérique – 1835 : à la suite d’un voyage in situ, analyse d’une incroyable lucidité, de la démocratie à travers la jeune démocratie américaine. Tocqueville n’est alors qu’un magistrat, et les Etats-Unis un état pas vraiment fini. Le terme de démocratie est encore assez rare dans le discours politique. Tocqueville, en passant au crible les institutions et les mœurs de la jeune Amérique, en fait l’épicentre de la pensée politique occidentale jusqu’à nos jours. C’est visionnaire : on y voit, avec deux siècles d’avance, tout ce qui se déroule de nos jours sous nos yeux. Et plus particulièrement les causes mises à nu de cette grande lassitude de la démocratie qui hante nos sociétés modernes : ce livre a tout saisi des pièges dans lesquels s’achemine toujours la démocratie, et il n’y a pas une seule contradiction observée de nos jours dans ce difficile système politique qui n’est pas été décrite et pensée dans ce livre.
98. Alphonse de Lamartine- le Voyage en Orient- 1835. « J’ai toujours été oriental» écrit Lamartine. Le voyage oriental est alors presque un pensum littéraire (Gautier, Flaubert et surtout Nerval). Ce monumental ouvrage décrit avec ferveur et précision un long périple de l’Égypte au Liban. Les descriptions de paysages en sont des leçons de style. Mais ce qui passionne Lamartine, ce sont ces peuples et ces hommes. Il en fait un portrait continu et attentif, mais jamais complaisant. Choqué de l’esclavage encore si commun, ou de la place mineure des femmes, il sait néanmoins comprendre l’Islam et ce différentiel de civilisation. Ce voyage sera hélas marqué dans son souvenir par la disparition de sa fille, inspirant par ailleurs le très touchant poème qui lui est consacré (Gethsémani…). Chaque page est celle d’un esprit relevé, d’un authentique voyageur.
99. Elias Lönnrot- Le Kalevala. 1835. Lönnrot n’a pas composé ce monument ni inventé sa teneur : il a rassemblé avec passion, à travers un kaléidoscope perturbé par de nombreux siècles, toutes les légendes orales et ancestrales de la mythologie finlandaise – si riche et si belle, ça vaut son pendant grec -pour en faire le grand poème de l’identité de son peuple. Ce long texte est organisé sur six séries de chants, chacune consacré à un héros. Ceux-ci assurent des quêtes et des voyages pas possibles, avec des fées, des sorcières, des créatures incroyables, des dieux hostiles ou généreux. On y trouvera des parallèles étonnants avec nos mythes grecs (descente de Lemminkainen aux enfers, les épreuves de Vainanmoinen etc). Mais c’est surtout l’histoire de la Finlande et de ce peuple résilient qui se fait jour. Le Kalevala est un phénomène unique de la littérature. A lire en écoutant Sibelius, bien sûr.
100. Johann Peter Eckermann. Entretiens avec Goethe- 1836. Il ne reste que peu de choses de l’œuvre d’Eckermann, pourtant illustre de son vivant, sauf ce monument. Situation ironique, évidemment, car son nom n’aura traversé les siècles qu’avec cette signature d’un faire-valoir. Cela dit, Eckermann aura eu le talent d’interviewer Goethe, et ça mérite un infini remerciement. La première des trois parties est peut-être même de Goethe, quasi-intégralement. Tout au long de ces conversations si bien retranscrites. – et réécrites, c’est bien de la littérature- le génie vieillissant embrasse l’horizon de son époque. Nous connaissons ainsi son opinion sur Napoléon, Byron, Schiller, la politique et la littérature de ce temps. C’est une mine, et cette lecture procure une présence presque physique de l’esprit du siècle. Une version complétée fut rééditée en 1848.
101. Alfred de Musset – La confession d’un enfant du siècle- 1836. Un des premiers romans autobiographiques, largement inspiré de la relation de Musset avec Georges Sand. Le thème en est cependant ce vide existentiel qui traverse la société après le souffle de l’épopée napoléonienne, et avant que le romantisme et sa formidable créativité n’en ait encore pris le relais. Partant d’une déception sentimentale, le roman conjugue comme le jeu d’une tresse, la souffrance amoureuse avec le portrait social de la France Louis-Philipparde. Le titre est merveilleusement explicite de la teneur du roman. Ce vague à l’âme permanent, à la première personne, déjà spleen et si peu heureux sans être tragique, est un peu la sève littéraire de ce siècle.
102. Charles Dickens- Oliver Twist – 1838. La pauvreté et la misère d’Oliver Twist, jeune orphelin, constituent la matière du roman : c’est une histoire de pauvre, comme souvent avec Dickens. Sanctionné pour avoir osé demander davantage de nourriture dans un orphelinat sinistre, alors les dirigeants dudit orphelinat s’empiffrent toute la journée, Oliver est placé chez un croque-mort, puis prend la fuite. Il côtoiera le crime, les bas-fonds, les pauvres et encore les pauvres, le revers impitoyable de l’Angleterre victorienne. Mais c’est un roman de la résilience autour de l’identité familiale ; sans famille, on n’est rien dans cette société-là. Un happy end apaise ce récit cruel qui nous jette de la misère en gros plan à chaque page mais aussi des rebondissements, des aventures et de l’espérance. Un des rares romans de Dickens qui n’est ni long ni trop conventionnel.
103. Nicolas Gogol – les âmes mortes – 1842: Il y eut un temps ou la Russie fut un phare de la littérature occidentale. Narrant les mésaventures d’un petit escroc de province, autour d’une trouvaille douteuse de rachat d’impôt sur la tête des serfs décédés, ce roman est également une dénonciation corrosive de la médiocrité de la société tsariste assez archaïque du XIX è siècle. C’est très russe : bourré de pauvres, de bureaucrates, et éclairé d’ironie et d’humour, mais en même temps, universel. Ce roman est inachevé, il n’aura donc jamais de dénouement, et le sort final de l’escroquerie ne sera jamais connu. Ce n’est pas grave. On le lira avec plaisir, et on en gardera un portrait assez complet des pesanteurs de la petitesse humaine.
104. Honoré de Balzac. Le Colonel Chabert- 1844. De Balzac, difficile de n’en retenir qu’un. Ce sera donc celui-ci, l’histoire d’un mort qui ne l’est pas et qui revient du cauchemar de la guerre. Entre temps, le monde a tourné et il n’y a plus de place, en pleine restauration, pour un héros déchu, qui aura tout donné et aura tout perdu. Bouleversant d’humanité, et de dureté, ce roman nous restitue le goût amer de ce reflux qui a suivi l’épopée napoléonienne. C’est la magie de Balzac, dans un roman de vétéran, de nous rassembler comme cela, dans son style fluide et puissant, le mythe et le réalisme du XIXe siècle. (À lire du même auteur : tant de chef d’œuvres…)
105. William Makepeace Thackeray – la Foire aux vanités – 1846: ce vaste roman sans héros est une critique mordante de la bonne société victorienne compassée dans ses hypocrisies sociales. Le roman malmène la fierté (maladive) du peuple anglais, et comme son contemporain Balzac, Thackeray explore les travers de l’homme en société pour inventer la modernité du roman. On peut préférer à Dickens, car c’est plus fluide, vivant et coloré, mais moins puissant cependant.
106. Chateaubriand – Mémoires d’Outre-Tombe – 1849: malgré la splendeur de son esprit et de son inspiration, Châteaubriand, pape du romantisme français est un perdant magnifique, toujours à contretemps de son temps, comme il le dit lui-même : monarchiste contre la révolution, libéral contre Napoléon, progressiste contre la restauration. « J’exècre l’orgueil des vainqueurs » nous dit-il. Il sait mêler le moi avec l’Histoire. Dans cette vie qui se déroule, passent les émotions et le souci de grandeur jamais assouvi d’un immense écrivain (même si Chateaubriand était de très petite taille, mais c’est une autre histoire). Ici commence le romantisme dans les lettres. Peu importe qu’elle soit ratée en regard de ses ambitions d’origine : la destinée est l’âme du mouvement. Et quel style !
107. Hermann Melville- Moby Dick- 1851. Melville était marin. Mais surtout écrivain. D’où sa passion dans cet ouvrage pour la mer, et l’animal qui est au centre de ce livre : le cachalot blanc (animal probablement imaginaire). Les thèmes, outre l’aventure marine, sont ceux de la société, et au-delà, de la métaphysique des âmes. Il analyse la fixation obsessionnelle de l’ego sur le désir et le manque, et la souffrance à dépasser sa condition. De quoi ce cachalot albinos est-il le symbole tourmenté ? De tout ce qui pousse l’homme à sortir de la raison par volonté. Le succès n’a pas été immédiat, mais a plus tard été reconnu comme un chef d’œuvre de la littérature. (A lire du même auteur : Mardi, Taipi, Bartleby…)
108. Gérard de Nerval- Aurélia ou le rêve et la vie -1855. Longtemps sous-estimé – il faut attendre Proust pour que le qualificatif de « génie » soit reconnu à ce pauvre Gérard- il explore les zones indiscernées entre la folie et la raison. Nerval est le premier à cultiver l’hallucination comme un procédé littéraire majeur. Schizophrène, il est un double écrivain : auteur de délicatesse et de rêverie voyageuse d’une part, écrivain de vertige et de l’abîme d’autre part. Gérard se consumera dans le brasier de son esprit, mais il aura changé la littérature. Bien plus tard, il enthousiasmera les surréalistes, qui y puiseront une partie de leur essor. (À lire du même auteur : Le Voyage en Orient ; les Filles du Feu ; les Illuminés)
109. Gustave Flaubert- Salambô- 1862. Un péplum en technicolor, qui lâchent par nuées des passions et des batailles, mais dans une forme de granit. Flaubert écrivit ce récit historique, sur une période peu explorée par ses confrères (Carthage entre les deux guerres puniques) parce qu’il s’ennuyait. C’est un fait que le lecteur ne peut pas s’ennuyer dans cette œuvre tout en mouvement, ou l’action alterne avec l’intimité. Il y a dans ce grand cinéma une cohérence qui en rend la lecture addictive : parce que tout y est si vrai – les mercenaires, le Sénat, les armées, les paysages et les amants- qu’on s’y croit dedans. Cette restitution du détail qui dynamise la situation, fait que « Salammbô » est unique dans le roman du XIXe siècle. Flaubert pouvait passer une semaine sur un demi-paragraphe, pour aboutir à l’écriture parfaite. A la lecture, on ne ressent rien de ce labeur : c’est cela, la belle littérature. (À lire du même auteur : Madame Bovary, L’éducation sentimentale ; Bouvard et Pécuchet)
110. Lewis Carroll – Alice au pays des merveilles – 1865. Le génie de Carroll (mathématicien, ne l’oublions pas…) tient dans son absurdité. De l’absurdité, il tire un délire particulièrement bien écrit qui nous interpelle. Rien à voir avec un conte pour enfant, car Alice nous met mal à l’aise dans une légère brume d’anxiété qu’estompe un humour très anglais, évidemment. On pourrait penser que ce livre a été écrit sous LSD, tant la forme et le sens se bousculent dans un kaléidoscope sans fin. Parfois, on ne comprend rien, et c’est tant mieux. Et généralement, on y revient. (À lire du même auteur : Sylvie et Bruno, largement aussi réussi).
111. Léon Tolstoï- La guerre et la paix- 1865- Voilà une œuvre immense, comme seul le XIXe siècle était capable d’en produire, et seule la Vieille Russie aussi. Nous voici immergés dans la Russie Tsariste du temps des campagnes napoléoniennes : les niveaux de lecture sont multiples, de l’action pure vers la réflexion métaphysique, tout en déclinant des aspects psychologiques, économiques, militaires etc. le souffle épique se combine avec la magie des détails, ou de l’inutilité de cette foule de personnages parfaitement caractérisés. Le lecteur est saisi assez vite, il traverse des bals somptueux et des intrigues, des batailles épiques – Tolstoï est d’ailleurs assez sévère sur la guerre et ses passions meurtrières – des amours contrariée au gré des conventions sociales etc. On ne résume pas ce livre, dont Tolstoï rédigea pas moins de six versions. Disons, s’il fallait en isoler l’idée majeure, que c’est une œuvre sur les pièges et les choix de la destinée. Incontournable, donc.
112. Victor Hugo- l’Homme qui rit- 1869. Le plus touchant, et sans doute le plus moderne des romans de l’Immense… Voici un homme défiguré d’un rictus grimaçant, sensé en faire un clown. Certes, on rit, mais on rit de lui. Jusqu’à ce que le destin le replace au centre de la société : alors, comme par miracle, les conventions sociales – et leur corollaire, le regard impitoyable de l’ordre social- s’effacent et se recomposent autour de cet homme. Et puis, il y a l’amour, qui- comme chez Goethe- sauve tout. Hugo, ça va très loin dans le saisissement de la souffrance des hommes – celle qu’ils s’infligent entre eux, ces imbéciles. C’est une défense de la différence. Et une histoire splendide et voilà tout. (À lire du même auteur : tant de chef d’œuvres qu’on en perd le sens…).
113. Arthur Rimbaud- Une saison en enfer- 1873. Dérogeons aux quelques principes énoncés dans notre introduction sur la nature des œuvres retenues. Il serait bien impensable de ne pas citer Rimbaud dans ce paysage. De Rimbaud, on a tout dit, et on en dira encore. La « Saison » c’est une forme nouvelle de poésie, tout en procédant d’une dimension romanesque souterraine qui invente à nouveau la poésie, la poésie qui ne sera jamais plus pareille par la suite. C’est aussi le récit d’une souffrance illuminée de l’intérieure, dont le sens tourne et se retourne sans jamais s’accomplir complètement. On y revient encore et encore, on le lit toute sa vie : Rimbaud est un mage, qui transfigure tout ce qu’il effleure. A lui seul, il est éternel roman.
114. Jules Vernes- l’Île mystérieuse- 1874-1875. Jules Vernes est l’écrivain majeur des 7 à 77 ans. Il est tout à fait lisible à tout âge. La langue est claire, le récit toujours soutenu et quelle belle imagination de roman ! Dans ses romans (c’est un homme, rappelons-le, qui a très peu voyagé), il nous parle de la volonté qu’imprime le progrès sur le monde, et ses héros, qui sont rarement seuls, surmontent l’adversité du destin ou de la nature. « L’île mystérieuse » c’est exactement ça : la conquête du progrès, et la reconstruction, dans un ailleurs insulaire pas franchement accueillant, d’une communauté humaine meurtrie par la guerre. Vernes envoie parfois de longs développements didactiques, à peu près scientifiques mais très souvent complètement inventifs, pour alimenter le récit de ce cheminement. Mais il nous donne de l’aventure, de l’imaginaire, et des horizons qui s’ouvrent à chaque page. Et surtout, il y a une conscience qui veille…(A lire du même auteur : impossible de tout lister, au moins vingt-cinq ou trente livres…)
115. Auguste Villiers de l’Isle Adam- Contes cruels- 1883. Il n’est pas question dans ces contes, de cruauté physique : Villiers n’est pas Sade. Ces contes ne sont cruels que pour la morale bourgeoise de ce XIXe finissant, qui est tout ce que l’auteur exècre et qu’il malmène fort. Les personnages positifs de ces histoires sont donc des prostituées, des bourreaux, des mythomanes ou nécrophiles et bien d’autres profils encore… Mais au-delà de cette constante, ces histoires sont d’une large diversité ; le bourgeois y est plus un état d’esprit qu’une position sociale, confronté à des situations qui déséquilibrent ses certitudes étroites. Un écrivain original, un peu sous-estimé aussi sans doute, mais au style flamboyant.
116. Friedrich Nietzche- Ainsi parlait Zarathoustra – 1883-1885. Lire Nietzsche, c’est se confronter à une pensée illuminée écrite dans une forme sans égale. Le sous-titre est édifiant : « Livre pour tous et pour personne ». Nietzsche s’exprime par aphorisme, ou symbole et apologues. Bref, on peut se contenter d’une approche littéraire du discours de Zarathoustra, comme se plonger dans la polysémie intensive du texte. Cela peut ressembler à un conte, qui trace une histoire. Et aussi à un long poème. Mais la dimension philosophique de cette œuvre est vaste, et son auteur y voyait comme une sorte de 5e évangile. Justice, égalité, morale, amitié, vertu, divinité (« Dieu est mort, tous les dieux sont morts » … c’est dedans), État… Bien d’autres choses encore. Pourquoi donc Zarathoustra (alias Zoroastre) ? On peut penser qu’il aura été le premier – pour peu qu’il ait existé – à s’interroger sur le bien et le mal. Ce questionnement sur les origines a généré ainsi un des plus riches ouvrages philosophiques de tous les temps.
117. Joris-Karl Huysmans- A rebours-1884. L’originalité de ce roman est – sans doute pour la première fois dans l’histoire du roman – qu’il ne s’y passe rien. Un personnage se retire dans l’oisiveté. La volonté continue de se refermer sur ce qu’il y a de plus cher, de plus beau, est le ressort du roman. Voilà tout. Mais ce qui est intéressant, c’est que le personnage central, et quasi-unique, réalise en fait la même enquête que celle que vous avez devant les yeux. Il sélectionne des auteurs – vaste érudition de des Esseintes, un peu ostentatoire – et nous déballe ainsi un vaste catalogue d’œuvres anciennes ou contemporaines, pour en accomplir son ultime collection. C’est très fin de siècle et c’est ce qui plaît – ou pas. Huysmans n’est peut-être pas un écrivain majeur, mais c’est un écrivain rare, et c’est beaucoup.
118. Robert Louis Stevenson- l’Étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde- 1886. On connaît tous à peu près cette histoire un peu terrifiante. Le docteur Jekyll est un savant philanthrope, très préoccupé par les mauvais penchants de la nature humaine, qu’il souhaiterait rectifier par la science, et sa propre double personnalité, met au point une potion pour séparer son bon côté de son mauvais, et ainsi, bien sûr, éliminer le mauvais. Ça ne se passe pas comme prévu. C’est ce dernier qui, nuit après nuit, en commettant des crimes et des violences, prendra finalement le dessus et le transformera en monstrueux Mister Hyde. C’est la face cachée de l’homme qui l’emporte quand on fait joujou avec un peu de chimie sur l’esprit, et la nature humaine ne se contrôle pas. Nabokov y voyait un des romans les mieux composés de toute la littérature ; c’est un fait que l’imagination de Stevenson, marquée d’une étonnante modernité, ne doit pas estomper qu’il s’agit d’un écrivain supérieur. Ce siècle littéraire a commencé avec Faust et Frankenstein, il s’achève avec Mr Hyde.
119. Guy de Maupassant- Le Horla- 1887. Ce recueil de quatorze nouvelles est bien sûr dominé par le conte-titre. Maupassant est le maître du texte court – certains de ses contes font moins de trois pages… Le Horla nous décrit la déchéance d’un homme en proie à l’angoisse : on ne saura pas si la cause de cette terreur est bien cette présence immanente et inquiétante qui le ronge, ou un trouble psychique funeste. D’abord, le doute, puis le tourment qui mène droit à la folie. L’évolution est déclinée de façon clinique, miroir des troubles psychiques que Maupassant ressent à cette période de sa vie. Les treize autres nouvelles sont plus empreintes de réalisme social, mais ciselées chacune comme des bijoux. Le tout peut tout à fait être lu comme un panorama de la littérature de ce siècle si vaste.
120. Émile Zola- La Bête humaine- 1890. Avec Zola, pour la première fois dans l’histoire du roman, le prolétariat entre en masse dans la littérature, et par cela, dans nos consciences, sans fard et sans fioriture (même si « Les misérables » nous avaient offert quelques clodos célestes, mais romantiques) … Ses personnages ne sont pas toujours (et même rarement) beaux et bons, mais ils sont vrais. Le peuple est là, dans toute sa splendeur, dans toute sa laideur…La locomotive à vapeur, puissante, bruyante, inquiétante, comme une allégorie continue de cette force qui rend les hommes fous : le désir. Il fallait l’oser, dans cette époque de moralité si conformiste. (A lire du même auteur : Germinal ; La faute de l’Abbé Mouret ; la débâcle ; La terre etc.)
121. Rudyard Kipling – le livre de la jungle – 1894: Des animaux qui parlent, pensent, jugent, du bien et du mal, mais ce n’est pas La Fontaine. Kipling est un esprit progressiste – et maçonnique – mais qui reste néanmoins colonial. L’anthropomorphisation de ces animaux est très peu orientale. D’ailleurs, Kipling ne connaît rien aux animaux sauvages et cette zoologie l’intéresse peu. Il nous parle de survie et de réconciliation avec le monde sauvage, de communauté de valeurs entre espèce. Nous avons des panthères bienveillantes, des éléphants sages, des singes inquiétants, et des buffles complices. Un tigre boiteux menace-t-il tout cette société ? Il faut bien un méchant pour fédérer les bonnes volontés. Ce tigre n’est pas mauvais parce qu’il est tigre. Mais parce qu’il est dégénéré en mangeur d’homme. Alors comment maintenir la paix ? L’homme – Mowgli- est la réponse.
122. Herbert George. Wells- L’ile du Docteur Moreau-1896. Toujours cette obsession du XIXe siècle de la transformation monstrueuse de l’humain. Voici des animaux, et médicalement, le docteur Moreau va tordre cette matière pour en faire des hommes. Évidemment, comme Frankenstein, comme Jekyll, ça va échouer. La nature animale revient toujours, et les pauvres créatures restent des monstres sans avenir et condamnés à la souffrance et à la terreur. Moreau est le modèle du savant cinglé qui a un compte à régler avec l’humanité et qui part en vrille loin de la raison élémentaire. L’homme ne fabrique pas l’homme, et on perd vite son humanité à ce jeu-là. Seule la nature a la main sur cette affaire. (A lire du même auteur : La guerre dans les airs ; La machine à remonter le temps ; La guerre des mondes…)
123. Giacomo Leopardi- Zibaldone – 1898 (1817). Toute sa vie durant, Leopardi a écrit ses pensées au jour le jour, sur la poésie, le langage, la littérature, la musique, l’art, la philosophie ; mais aussi sur l’Italie, Napoléon, la politique, la démocratie ; et encore les femmes, les paysages, l’âme, la vie et la mort, les couleurs ou les saveurs ; bref, sur tout ce qui anime un esprit immense, qui est sans doute trop peu connu en France. Publié seulement près de soixante ans après la mort de son auteur, le Zibaldone est un livre sans égal. Lire ce monument, c’est s’engager dans une aventure étrange, mais gratifiante. Bien sûr, on ne lit pas les centaines et centaines de réflexions qui s’échelonnent sur l’ensemble – de l’aphorisme de deux lignes jusqu’à la dissertation de vingt pages. Mais on parcourt l’ouvrage au gré de son humeur, on s’y perd, s’y retrouve et revient. Nietzsche, fasciné par l’altitude de cette poésie pensante, comparait Leopardi à Goethe. C’était plutôt bien vu. Il est captivant d’engager la lecture d’un livre de trois mille pages en sachant pertinemment qu’on ne le finira jamais. Expérience unique, à connaître au moins une fois dans une vie de lecteur.
124. Joseph Conrad – au cœur des ténèbres– 1899 : Un des romans les plus puissants de l’époque moderne, et un des plus grands écrivains de cette croisée des siècles. Un jeune officier est envoyé en territoire inconnu, au fin fond d’une Afrique obscure et vierge, pour retrouver un autre officier colonial, dont ses autorités sont sans nouvelle, sorte d’électron libre englué dans cette torpeur tropicale qui l’a vraisemblablement rendu fou. C’est métaphysique absolument. L’Afrique équatoriale et coloniale comme métaphore de l’âme humaine, il fallait y penser. Vous serez séduit par le style puissant et dense de Conrad-marque des autodidactes, et après, vous en lirez d’autres. Immanquable. (A lire du même auteur : Fortune ; La folie Altmeyer ; Nostromo ; Lord Jim ; la flèche d’or etc. etc.).
CHAPITRE SIXIEME : LE VINGTIEME, ENFIN…

Le XXe siècle restera comme celui de l’universalité absolue de la littérature. Entre toutes les nations et toutes les cultures, la connexion s’effectue sans limite grâce à des moyens encore impensables quelques décennies avant. Les livres se démultiplient et se traduisent, les continents, les peuples et les cultures s’intéressent les uns les autres, et les opinions se lisent et se découvrent par-delà toute forme de distance. Ainsi s’effectue d’abord par le livre, la plus grande connexion entre toutes les nations et les cultures ; les écrivains et leurs œuvres à la radio, puis la télé, puis, internet – ce dernier vecteur, pour le meilleur et pour le pire. Tout le monde se parle. Les Japonais traduisent Nerval et Stendhal, et ça leur donne envie. La jeune culture américaine s’y met aussi, puis c’est l’Afrique qui s’envole : elles ont tant de choses à dire. Jamais le genre humain n’aura autant produit de livres, jamais les livres n’auront autant rencontré de lecteurs sur toute la planète. Les préoccupations évoluent et se feront souvent plus sombres. Le XXe siècle aura aussi été un des -ou LE ? -plus violent : jamais l’espèce humaine n’aura autant détruit l’espèce humaine. L’inspiration de l’écrivain se déplace donc de la radioscopie des sentiments, explorés au siècle précédent, vers le sociétal, et l’idéologie, désormais omniprésente. Le totalitarisme, la politique, la liberté des consciences, voire même le destin de l’humanité, hantent l’écriture et le discours littéraire, partout, dans toutes les langues et les cultures. La psychanalyse, la psychologie conditionnent les destinées transcrites. Partout, la guerre et l’oppression tourmentent l’inspiration. La littérature scrute la société comme jamais. Mais aussi, on invente d’autres mondes, aux lois et aux histoires différentes, parfois vers de lointaines étoiles imaginaires, et qui nous ressemblent cependant. Nourri d’angoisse et d’espérance, questionnant l’avenir de l’humanité, l’écrivain devient un personnage de ses propres romans et c’est nouveau.Allons-y, donc : le XXe siècle. Il aura fallu être TRES sélectif dans ce foisonnement des chefs-d’œuvre.
125. Natsume Soseki. Le mineur- 1908. Le roman est un phénomène nouveau dans le japon littéraire du XXe siècle. C’est comme si les écrivains de ce mini-continent, heureux de cette découverte importée d’Occident, se trouvaient alors fiévreux en ce début de siècle de l’exploiter. Le mineur est de ce point de vue un coup de maître : roman réaliste et sans concession sur le sort du prolétariat nippon, mais aux intuitions fantastiques, nuancées de personnages étranges, et de références à Dante. La mine est une allégorie de la condition humaine et de cette destinée mystérieuse à toujours pencher vers l’enfer. Soseki est un pionnier du roman, et une référence pour tous les écrivains du Japon qui suivront : il aura, par cet étonnant mineur, montré le chemin, et, sans mauvais jeu de mot, le filon. (A lire du même auteur : Oreiller d’herbe/Le Voyageur/Clair-obscur/ Le pauvre cœur des hommes)
126. Jack London-Martin Eden- 1909. Martin Eden, en partie autobiographique, est un roman sur les limites du possible. Le destin plie devant la volonté de l’écriture, et celle-ci devient un mode libératoire hors de la condition de prolétaire. Mais la progression stoppe devant les conventions sociales. Ouvrier et marin, London a dû donner de sa personne pour bâtir une personnalité d’écrivain autodidacte. Toute la trame se ressent d’un vécu authentique, et défie les conventions sociales. Mais même écrivain, on reste peuple : c’est la moralité de Eden.
127. Alain Fournier- Le Grand Meaulnes- 1913.Fournier n’aura pas eu le temps d’être le grand écrivain qu’il devait être, la guerre l’a fauché avant. C’est un roman triste et beau, chargé des brouillards de la nostalgie et des opportunités délaissées qui fondent le sort de toute une vie, où des jeunes gens cherchent en vain le bonheur dans des échappées trompeuses. Les rêveries de la jeunesse se perdent dans l’écheveau des amitiés et de l’amour unique. Et à la fin, reste la beauté de l’amour qui tremble encore dessous la cendre. Ce roman brumeux est l’œuvre littéraire de langue française la plus lue dans le monde, après le Petit Prince. Sans doute à lire avant d’avoir vingt ans si on le peut.
128. Marcel Proust- A la recherche du temps perdu- 1913-1927. Proust est le plus grand styliste du XXe siècle, sans rival. Vous n’avez jamais vu un style aussi élaboré et délicieusement appréciable. Le cliché des longues phrases qui s’étendent sur une page est plutôt avéré, mais en partie (parfois, Proust sait faire court, voire incisif…). L’histoire en elle-même n’est pas ce qu’elle paraît. Ce qui se raconte ici, à travers une richesse de situations sans précédent jusqu’alors, c’est la genèse d’une œuvre littéraire, et au-delà, de la littérature du XXe siècle. C’est toujours raffiné et spirituel, Proust, et on se grandit à chaque séquence de sa lecture. Le peuple foisonnant des personnages est d’une inventivité qui déferle, et amuse (Oui, c’est souvent drôle, Proust…). Ne craignons pas les mots : le plus grand des grands du siècle dernier. Il faut prendre son courage à deux mains lorsque l’on découvre pour la première fois l’épaisseur des bouquins, mais vous ne le regretterez pas. La Recherche changera votre vie, et votre relation à la littérature. (A lire du même auteur : Sur la lecture/ et parcourir l’immense correspondance)
129. James Joyce- Ulysse- 1922.Réputé illisible, le livre est rayonnant, mais ardu. Il a été beaucoup critiqué, (V. Woolf y vit « un ratage complet»), et même interdit aux États-Unis. Sur la forme, James Joyce adopte un point de vue original, qui est celui de décrire de l’intérieur les pensées de ses personnages, en retraçant de façon transposée et symbolique, le parcours initiatique de l’Odyssée, rien que cela. Joyce disait qu’on pourrait reconstruire Dublin pierre à pierre grâce à son roman. Avec Proust, Joyce est un des deux pôles de la littérature moderne du XXe siècle. Mais plus alambiqué… À connaître, à défaut d’aimer. Disons que c’est expérimental, et qu’on peut le lire pour se faire une idée plus large de l’art du roman au XXe siècle.(A lire du même auteur : Dedalus ; Gens de Dublin)
130. Romain Rolland. L’âme enchantée. 1922-1933. Rolland est un peu oublié maintenant, et sous-estimé. C’est bien dommage. Prix Nobel, pourtant, couronnant toute une œuvre d’humanisme et de progressisme. Annette est une femme-héroïne d’un temps d’avance, qui brise les chaînes et décide de construire sa vie seule, dans un temps où il ne convient pas que les femmes vivent ainsi. Cette destinée s’échelonne dans un roman fleuve des trois premières décennies du siècle dernier – en gros, de la grande guerre jusqu’à la montée du fascisme. Femme et mère célibataire, tout entière éclairée de sa mission de mère, Annette s’exposera à tous les travers de la société jusqu’à défier le tragique. Un de mes plus attachants souvenirs de lecture. (A lire du même auteur : Beethoven)
131. Sigmund Freud-Le rêve et son interprétation- 1925. Pulsions, exigences sociales, surmoi, moi, ça, morale, religion, civilisation. On ne peut pas vivre au XXIe siècle sans connaître ce qu’a apporté Freud à la réflexion contemporaine. Même si nombreux sont ceux qui disent que Freud n’avait rien compris et n’a écrit que des inepties, il a eu au moins le mérite de mettre l’accent sur un domaine méconnu jusqu’alors : le sens de nos songes. C’est avec lui que se développent finalement la psychologie, la psychiatrie, la réflexion sur l’inconscient. Avant la parution de ce livre majeur, les rêves n’étaient que des évasions du réel à la disposition des écrivains. Non, nous dit Freud : ils ont toujours un sens, et c’est eux, les rêves, qui nous disent quelle est notre vie. Et il le démontre. Seuls ceux qui ont peur de leurs rêves auront peur de leur interprétation.
132. Franz Kafka- Le Château- 1926.Fidèle à lui-même, Kafka livre une œuvre obscure et terriblement intéressante. Il est question là encore de bureaucratie, mais aussi du pouvoir, des grands sur les petites gens. K. arrive dans un village, pour y travailler comme arpenteur. Les difficultés commencent, et le quotidien comme la médiocrité des gens déploient toute leur puissance pour que ça ne s’accomplisse pas. Qu’est-ce que ce mystérieux château, qui domine le village ? Il n’y a pas de réponse unique aux énigmes de la société moderne et déshumanisée. Le livre n’aurait jamais dû paraître et même être détruit selon les souhaits de Kafka, mais heureusement un ami a refusé de le détruire et s’est chargé de le publier. Roman inachevé, comme l’ambition du personnage central. Ironie kafkaïenne du sort…(A lire du même auteur : Journal)
133. André Gide- Voyage au Congo- 1927. De Gide, de ce géant, il y a beaucoup d’ouvrages à retenir. Ce sera celui-ci. Gide n’est pas particulièrement politique. Mais il nous dévoile dans son itinéraire celui d’une désillusion profonde (comme il le fera, avec autant de vigueur quelques années plus tard, à Moscou). Quelle est cette civilisation qui annihile et consume des peuples entiers versés dans l’innocence originelle ? Très peu politique, mais moraliste et humaniste. C’est un regard sur une Afrique dévorée et rabaissée en dessous de la ligne des cupidités médiocres des coloniaux, si fiers de l’être. Parfois, traversé de beaux émerveillements. (A lire du même auteur : La porte étroite, Les caves du Vatican, L’immoraliste ; et on explorera çà et là le si riche Journal)
134. Mazo de la Roche- Jalna- 1927-1960.Jalna, qui connaît ça aujourd’hui ? C’est un monument. Il faut le dire, cette immense saga aura été une folie de lecture dans mon adolescence : aujourd’hui, comment expliquer la lecture en continu, en quelques mois seulement, des seize (oui, seize=16 !) volumes de cette suite ? Personnellement, pas de réelle réponse…Totalement oubliée aujourd’hui en Europe et pourtant naguère si fameuse dans les années soixante-dix, Mazo de la roche reste toujours glorifiée au Canada, son pays. L’histoire de cette famille (les « Whiteoaks ») coloniale, terrienne et anglosaxonne sur un siècle, autour d’un manoir dont le nom, Jalna, est souvent pris pour celui d’un personnage central, est sans égale. Toutes les saga anglosaxonnes sont très petites et bien pâles en comparaison, oubliez les Forsythes, les Bridgerton, les Downtown Abbey etc qui ne valent pas pipette. Seize volumes donc, écrits et publiés sans aucun ordre chronologique, sur plus de trois décennies, sans aucun faux-pas dans l’ordre et le détail de la narration (même Proust s’est parfois pris les pieds dans le tapis…), ce qui est une performance. On y traverse tant de choses : l’idée de fondation, les amours contrariées, les conflits de générations, les préjugés sociaux et de classe, les névroses ; les guerres, guerre de sécession et deux guerres mondiales, dont les échos lointains ébranlent l’ordre colonial et familial, et ce mystère où se concilient tant de bouleversements avec une étrange continuité de valeurs et de références. De La Roche aura eu une vie intime mystérieuse, qu’on ne saisit pas encore de nos jours, et une œuvre colossale (Jalna, c’est moins de la moitié de sa production…). Peu d’auteurs ont autant écrit. En tout cas, à redécouvrir. Et cette immense parcours de lecture m’aura définitivement donné – sans doute par l’endurance exigée jusqu’à son terme- l’envie de lire encore, toujours, et éternellement.
135. Howard Philip Lovecraft- L’appel de Cthulhu et autres nouvelles- 1928.Votre impression à la lecture est juste : Lovecraft est complètement cinglé. C’est ce qui procure, malgré un style parfois limité, cette sensation d’inconnu et de révélé en même temps. La création d’une mythologie terrifiante au cœur du XXe siècle, nourrie de secrets et d’initiation, vient perturber notre foi dans la raison et notre système de valeurs rationnelles. Mais de toutes ces monstruosités, quel est le sens ? La raison n’est jamais acquise, et dans le combat contre la folie, c’est toujours la folie qui gagne.
136. William Faulkner- Tandis que j’agonise- 1930.Faulkner démontre une intelligence de l’écriture lumineuse. Rarement un écrivain a su adapter le style à la parole intérieure de l’âme, tout en restant à l’écoute de la misère des hommes. Il s’agit d’un voyage funéraire, une famille emporte dans son cercueil le corps de la mère, et sur la route et ses pauvres péripéties, se croisent les intimités de chaque personnage. Jusqu’à ce qu’ils se perdent un peu eux-mêmes dans ce sillage. Et ça brûle du soleil du sud.
137. Aldous Huxley – le meilleur des mondes– 1931: Tout est définitivement organisé pour que rien ne soit plus remis en cause : fameux roman d’anticipation dystopique qui décrit de manière prodigieuse l’avènement d’une société fortement hiérarchisée ou les êtres humains sont conçus artificiellement et conditionnés biologiquement et psychologiquement. À force de rechercher l’absence de problèmes, le monde tel qu’il s’est configuré s’est privé d’humanité. Comme Orwell, Huxley avait parfaitement pressenti l’évolution de nos sociétés, dans un autre sens sans doute, mais peut-être plus effrayant encore.
138. Virginia Woolf – Les vagues-1931.Six paroles se croisent et se nouent en flots continus, sans jamais rompre avec le monologue et sans jamais échanger un mot entre elles. Elles traversent une vie sextuple, depuis les balbutiements de conscience du premier âge, jusqu’au renoncement du dernier grand âge. Qui sont-elles ? Il faut avancer dans la lecture pour découvrir leur histoire commune, leur amitié, l’absence…Woolf écrit toujours sur un mode intérieur, mais reste une styliste incroyable de l’âme humaine et de ses convenances, comme de ses échappées. Un des plus beaux livres de mon Panthéon. (À lire du même auteur : La traversée des apparences, Orlando, Promenade au phare, la fascination de l’étang (recueil de nouvelles) ; et le formidable Journal).
139. Louis-Ferdinand Céline- Voyage au bout de la nuit- 1932. Dans ce monument, Céline s’attaque à tout le monde : l’humanité en prend pour son grade. Mais aussi la guerre, cet « abattoir international en folie », le colonialisme, la vie urbaine et ses médiocrités. Sur la forme, Céline utilise un vocabulaire oral, presque argotique, et fut pour cela beaucoup dénigré. Ce n’est pas notre style préféré, mais certains aimeront peut-être davantage : il est incontestable qu’il invente par ses phrases vaporeuses et essoufflées, autant que Proust et Joyce, ses contemporains, un style étonnant au service de la littérature. C’est un tournant. Quoi qu’il en soit, il faut absolument avoir lu ce livre si on veut comprendre la littérature de ce siècle, même si Céline, vous le savez déjà, fut un salaud intégral. Constat sans appel.
140. Junichiro Tanizaki – Éloge de l’ombre-1933. Contempteur de la civilisation occidentale et de ses obsessions de clarté, Tanizaki décline en quelques dizaines de pages toutes les vertus de ce qui n’est pas clair : l’ombre devient une valeur bienveillante, en phase avec la nature profonde de l’âme, et un trait d’union entre l’esprit et le reste du monde. Un appel discret à la méditation et au discernement. Exceptionnellement oriental, le livre n’en est pas moins universel. (A lire du même auteur : Bruine de neige (quatre sœurs)/ La vraie vie du seigneur de Musashi/Journal d’un vieux fou/La confession impudique)
141. Michel Leiris- L’Afrique fantôme- 1934.De ce qui était censé être le carnet de route d’une expédition qui n’était pas la sienne, Leiris écrit dans une subjectivité revendiquée, un éloge de l’Afrique sous un regard radicalement opposé à celui qui domine alors : l’œil colonial. Cette « aventure mentale » (sic) que traverse Leiris pendant deux ans, dévoile à l’esprit occidental des années trente un univers insoupçonnable de mythes, de rites et d’humanité que cet esprit ne voulait pas voir. La description de cet univers y est d’une précision rigoureuse qui lui donne une portée décisive, avant Lévi-Strauss. L’Afrique, coloniale ou pas, ne sera jamais plus considérée de la même façon. (A lire du même auteur: La Règle du jeu)
142. Ernst Jünger –Journaux- 1939-1948. De Jünger, écrivain humaniste ET Nationaliste, on oubliera les boucheries complaisantes des Orages d’acier, pour se tourner vers ses Journaux de la seconde guerre mondiale, bien plus révélateur de l’immensité de l’écrivain. Ces journaux sont en effet un mélange d’observations de la nature, de comptes rendus de ses fréquentations littéraires dans les salons parisiens, de réflexions désabusées sur le sens de la guerre, et enfin de remarques d’une lucidité cinglante sur sa position d’officier en temps de guerre : La description de l’angoisse de son départ –complètement volontaire de sa part– vers le front russe est significative de ses contradictions. On retrouve également son horreur de ce qui s’est emparé de l’Allemagne, sa haine d’Hitler (qu’il ne désigne que sous le nom de Kniebolo) et de ses partisans et des SS qu’il croise (qu’il désigne du nom de lémures) ; mais aussi, sa honte devant les étoiles jaunes qu’il croise dans les rues. Ses pages sur la fin de la guerre, la débâcle de toute la société allemande, et les ruines de l’après-guerre, sont aussi exceptionnelles d’acuité et de vérité. Écrivain allemand et européen, c’est un inclassable, dont le cheminement intellectuel et littéraire consacre une dimension universelle. (À lire du même auteur : Les falaises de marbre. Les abeilles de verre. Les chasses subtiles).
143. Ernest Hemingway. Pour qui sonne le glas- 1940. Un très beau livre, dont la trame confronte en permanence le conflit intérieur du héros malgré lui, et la grandeur de sa cause. L’engagement moral – ici, la guerre d’Espagne – coûte cher aux sentiments humains. Un jeune américain, Jordan, professeur d’espagnol, engagé dans les brigades internationales, a pour mission de faire sauter un pont. Pendant trois jours, il attend, prépare le sabotage, et observe les combattants espagnols. Rien ne va se passer comme le sens moral de l’Histoire l’aurait souhaité, et l’amour, rencontré ici comme un revers de la guerre, ne sauvera rien. Roman de la destinée, roman majeur de ce siècle.
144. Jean-Paul Sartre – Les chemins de la liberté (3 vol.) 1945-1949. Sartre romancier est un peu négligé de nos jours, lui qui fut une conscience centrale du siècle en question. Ces «Chemins » sont une trilogie de romans (L’âge de raison/ Le sursis/ la mort dans l’âme). Tout est choix et tout choix engagera la responsabilité de façon irréversible. Les destinées d’une multitude de personnages, jeunes –l’âge des choix et des perspectives – se croisent et s’échangent Avec une modernité déconcertante, Sartre décline de façon très romanesque des thèmes que l’on ne sait qualifier encore de « sociétaux » : l’avortement, l’homosexualité, le pacifisme et le bellicisme, l’ambition sociale et la lutte des classes; mais aussi des échos intimes de la personne humaine face à l’histoire qui remue : la guerre, la peur, la liberté, l’oppression, le nazisme et l’esprit de résistance…. Mais quelle est la part du libre arbitre dans tout cela ? (A lire du même auteur : Les mots/ Huis clos/ Les séquestrés d’Altona/La nausée)
145. Antoine de Saint-Exupéry- Citadelle- 1948. Le genre de livre nourri de tant de sagesse qu’on peut l’ouvrir à n’importe quelle page pour s’y retrouver. Certes, c’est illisible en continu, ou presque. De quoi ce livre nous parle-t-il, que veut-il nous dire, sur ses six cents pages ? Du bien et de l’art de conduire la vie des hommes dans leur propre Cité. Et quoi d’autre ? De l’esprit de tolérance, sans doute aussi. Un livre qu’on découvre, explore, relit et redécouvre ; c’est cela, Citadelle. Qui nous protège et fortifie, à la mesure de son titre. (À lire du même auteur : Le Petit Prince – évidemment ; Pilote de guerre)
146. Jorge Luis Borges – Fictions – 1944: Borges, c’est un des plus grands du XXe siècle, de ceux que l’on compte sur les doigts d’une main. Ses textes sont toujours courts, et économes. Ce qui l’intéresse, c’est l’infini des possibles que permet l’écriture et le langage : il réinvente tout du monde que nous constatons, en accédant à des imaginaires rigoureux qui inversent le sens du réel. Écrivains, livres, bibliothèques, critiques, territoires et histoires, variations d’histoires, autant d’entrées dans des univers parallèles… Tout cela existe-t-il ? Oui, parce que c’est de la littérature.
147. Curzio Malaparte – Kaputt- 1944. C’est un roman autobiographique, roman par le mode de narration, mais plutôt autobiographie par sa matière. D’abord fasciné par le fascisme, et même un bref moment dignitaire de ce régime, Malaparte – nom d’état civil qu’il s’est choisi par référence à Bonaparte- en sera vite déçu puis opposant intransigeant. Son parcours de reporter de guerre alimente chaque page de Kaputt, livre sans modèle, teinté d’humour froid et de descriptions criantes de réalisme, et constitue un témoignage de guerre cruel et parfois morbide. Mais pour Malaparte, l’horreur de la guerre et la cruauté humaine sont acquises, pas la peine de produire une Nième œuvre de littérature. Ce sera donc une déclinaison de dîners mondains, de conversations intellectuelles parmi des aristocrates décalés soucieux de préserver à tout prix un art de vivre bourgeois loin de l’écho des massacres ; le récit de chasse humaine des dignitaires du ghetto de Varsovie est presque suffocant. Des nazis goûtent des vins fins et la musique de Bach, pour se détendre de leurs massacres. Il va ainsi très loin dans l’âme humaine, petite et précieuse, qui entend à tout prix préserver les petits plaisirs de la vie loin du désastre. Ce qui est inhumain, c’est cet écart entre l’écrin de la vie sociale à tout prix, et la mort de masse.
148. Hermann Broch – La mort de Virgile-1945.L’histoire de ce roman, c’est la mort de Virgile, point. La fièvre, l’agonie, le délire, l’apaisement final et cette ultime échappée de l’âme qui conclue l’existence. On pourrait penser qu’une nouvelle de six pages aurait suffi à « traiter » le sujet. Eh bien non, Broch en déploie sept cents. C’est que faire mourir Virgile en littérature, ce n’est pas une mince affaire. Le sens de la création esthétique, et donc de la vie, est invoqué à chaque page, dans cet océan du verbe qui déferle – certaines phrases font six pages, alors on s’accroche. Mais croyez -le, ça vaut le coup, car la Mort de Virgile est un livre qui marque et dont la beauté, comme une vaporeuse rémanence, ne vous quittera plus. (À lire du même auteur : Le tentateur ; Les somnambules)
149. Thomas Mann- Docteur Faustus- 1947. C’est la biographie fictive d’un musicien imaginaire, mais génial, Adrian Leverkühn. Celui-ci, fort ambitieux et conscient de sa supériorité, vend son âme au diable –comme Faust, donc, on y revient toujours -en échange non plus d’une connaissance universelle, mais d’un génie sans limite qui lui garantit en toute aisance, son accomplissement d’artiste. Possédé par son démon totalitaire, il invente une théorie musicale qu’il pense unique et supérieure, et appelée à remplacer toutes celles qui l’ont précédée. Cette ambition irrationnelle, basée sur l’esprit de système, le conduit vers une impasse humaine et sociale, la folie et le suicide. Vous l’avez deviné, cette trame, c’est bien celle de la culture allemande aspirée par le nazisme. Déchéance physique, décadence intellectuelle, effondrement spirituel sont le prix à payer du pacte diabolique. Terrible triptyque. Mais qui s’en souvient encore de nos jours ?…(A lire du même auteur : La montagne magique… évidemment)
150. Albert Camus – La peste- 1947. Un rat mort, trouvé comme ça, sur le palier, puis plusieurs rats morts, puis de nombreux rats morts. Et bientôt, des êtres humains, qui tombent à leur tour, quand les survivants regardent ailleurs. La peste est un fléau, qui frappe en l’occurrence l’Algérie française. Vous pouvez y lire également sous un angle historique cette maladie comme la peste brune, qui représente l’avancée du fascisme. C’est un paradigme, bien sûr, que cette épidémie qui corrompt tout ce qu’elle touche, et qui fait peur au point que le réflexe, c’est d’en parler le moins possible, sauf quand il est déjà très tard, trop tard. Plus jamais ça. Jamais. Et pourtant, regardons autour de nous, notre époque et ses idées noirâtres qui montent et suintent de toute part. La Peste est bien une maladie chronique ; elle reviendra toujours. (A lire du même auteur : le mythe de Sisyphe-La Chute- L’étranger).
151. Georges Orwell- 1984- 1949.Ce livre est un « tube » du XXe siècle, si on peut emprunter à ce langage. Sans doute parce que le premier, Orwell a décelé dès l’après-guerre, que l’angoisse totalitaire était la première et plus destructrice névrose du siècle. Il en décrypte, par le prisme romanesque, toute l’horlogerie, et les détours. Avant Soljenitsyne, il comprend la portée du phénomène, et combien l’idéologie qui l’inspire n’en est que le prétexte.
152. Julien Gracq – Un balcon en forêt-1958. Probablement le sommet de l’art littéraire contemplatif de Julien Gracq. En automne (1939) un jeune aspirant rejoint son poste dans la forêt des Ardennes. Il y passe ses journées dans la forêt, en contemplation du monde, à la fois indifférent et anxieux de l’orage qui vient. L’espace et le temps se colorent d’une patine poétique, où le style de Gracq atteint des sommets. Le plaisir de la solitude, la beauté de la nature, et même une douce histoire d’amour ne parviendront pas à sauver le monde rêveur ainsi reconstitué. (A lire du même auteur: Le rivage des Syrtes; le roi pêcheur)
153. Marguerite Yourcenar – Mémoires d’Hadrien – 1952. Un très grand livre. Yourcenar, la première, a l’idée de s’introduire dans la mémoire d’un monarque éclairé, – exceptionnelle personnalité, peu connue encore à l’époque du roman- pour en inventer la méditation, dans une sorte de grand regard circulaire sur un monde qui s’évanouit. L’Empire bascule lentement de l’autre côté de son apogée, et c’est un homme vieilli, endolori, qui dit adieu aux plaisirs de la vie, et aux angoisses de la puissance, mais dont chaque souvenir est une ode à la Vie.
154. R Tolkien – Le Seigneur des Anneaux- 1954-1955.Tolkien décrit son livre comme un conte pour adulte. C’est bien ce qu’il est. La fantasy y atteint un sommet d’imagination et de narration. Un monde entier est bâti autour de concepts habituels du merveilleux – des magiciens et des princesses, des trésors et des sortilèges – mais étonnamment, cela nous parle comme un roman réaliste. Linguiste de métier, Tolkien y invente des langages et des syntagmes qui contribuent à bâtir le romanesque de ce roman fleuve. Bien sûr, il y a des bons et des méchants, le bien fragile face au mal tenace. Mais dans tous ces peuples improbables de légendes, c’est bien nous qui nous reflétons.
155. Romain Gary – Les racines du ciel- 1956.Au milieu du XXe siècle, personne ne se sent concerné par la protection de la nature et sa faune sauvage. Gary consacre un roman entier aux éléphants. Quelle curieuse idée, en ce temps-là, où la vie sauvage pullule encore sur la terre d’Afrique. C’est la lutte de Morel, une sorte de rebelle aventureux, qui s’acharne à sauver le vivant, en menant des actions spectaculaires contre les chasseurs, en faveur des éléphants. En parallèle, les conflits d’intérêts des uns et des autres : pour les éléphants, pour la puissance coloniale, pour la sauvegarde des traditions, pour la marche en avant de l’homme vers la modernité, pour l’intérêt à court terme. Pour l’honneur de l’Homme tout simplement… Et si les éléphants de Gary n’étaient qu’un simple reflet de nous-mêmes, en plus sages ?
156. Boris Pasternak- Docteur Jivago- 1957. Écrivain russe de l’époque soviétique plutôt moins ennuyeux que la plupart de ses compatriotes et contemporains (c’est de la provocation) Pasternak était trop inventif et raffiné pour l’Union Soviétique. C’est une saga, c’est-à-dire la trajectoire disloquée d’une famille dans la tourmente et le chaos de la révolution, puis de la guerre civile. Un roman très humain, presque sentimental parfois, d’une facture XIXe siècle dans un siècle de fer qui lui refuse sa place.
157. Chinua Ashebe-Le monde s’effondre- 1958.Le premier roman africain, qui éveille le continent. Ashebe nous parle, à travers le regard et le destin d’Okonkwo, notable de son clan, de la vie courante dans le sud du Nigéria avant la colonisation, et l’arrivée des Britanniques au XIXe siècle, avec le train dévastateur de leur économie, leur religion, leur technologie et cette soif de tout s’accaparer par principe. Évidemment, c’est un choc culturel : ces gens d’une société si paisible, vivent dans un monde à leur image, un monde de forêt, de rivières, de saisons et plantations, de rites et de dieux accessibles. Mais ce monde antérieur, condamné sitôt effleuré, n’est pas idéalisé : les conflits internes y sont nombreux, et la brèche est ouverte dans l’unité du clan quand est exigé un ultime sacrifice humain qui suscite la révolte de la jeunesse. Ce roman est l’archétype du roman africain, et perçu, lu, diffusé comme une référence. Il servira de modèle, et contribuera à faire du Nigéria la grande nation littéraire que ce pays est devenu de nos jours.
158. Yasunari Kawabata- Les belles endormies- 1961.Roman sur la confrontation intérieure de la jeunesse et de la vieillesse par le prisme du désir. Un vieil homme découvre, sur l’invitation d’un ami, une étrange maison de plaisir. Celle-ci permet exclusivement à des vieillards de passer la nuit avec une jeune fille endormie – suffisamment droguée pour ne se douter de rien – dans les bras. Ainsi, dans ces nuits de sensualité immobiles et platoniques, le vieil Eguchi, dans la tiédeur de ce jeune corps contre lui, médite sur sa vie, ses amours anciennes, la mort aux aguets et la régression de la vieillesse. Métaphore rêveuse sur la beauté (« si prompte à se défaire » comme l’écrit ailleurs Kawabata) les Belles endormies est un livre de pudeur et de tendresse, très emblématique de l’âme littéraire japonaise. (À lire du même auteur : Tristesse et beauté ; Pays de neige ; la danseuse d’Izu ; Kyoto ; Le grondement de la montagne; Nuée d’oiseaux blancs).
159. Doris Lessing- Le carnet d’or- 1962.Encore un livre emblématique de ce siècle. Une jeune romancière, Anna Wulf ,a remporté un succès d’édition avec son premier roman. Puis, l’inspiration s’est enfuie. Hantée par le syndrome de la page blanche, elle a le sentiment que sa vie perd son sens. La tristesse l’accable, et dans la crainte de la folie, elle note ses expériences dans quatre carnets de couleur, chacun consacré à un thème, pour alimenter une résilience éventuelle. À chaque carnet correspond un pan d’autobiographie d’Anna, sous des angles différents : le féminisme, le militantisme, la jeunesse et ses illusions, etc. Mais c’est le cinquième, couleur or, qui sera la clé de sa guérison, de sa renaissance. C’est un roman d’une intelligence formidable, qui sait faire le lien entre les couleurs de l’intime – la dépression, la solitude, l’amour – et les aspérités du politique – l’apartheid, le communisme, le colonialisme. Une sorte « d’ombilic » de la littérature contemporaine, on peut le dire ainsi.
160. Philip K. Dick- Le Maître du Haut Château- 1962.Un livre majeur de la diachronie, ou uchronie, ou dystopie etc comme on veut et peu importe. Un monde des années soixante, où les forces de l’axe- (Allemagne et Japon, rappelons-le pour les incultes), victorieuses à l’issue de la seconde guerre mondiale, dominent le monde. Une résistance s’organise dans ce monde de cauchemar. Peu d’espoir, mais une rumeur s’écoule peu à peu ; et si ce monde n’était pas le vrai ? Ailleurs, se dit-il, le nazisme aurait été vaincu. Mais quel passage entre ces vérités ? Un roman étonnant, plus métaphysique qu’on a bien voulu le connoter dans les années soixante, qui a marqué son temps. Le maître du haut Château parle de nous et notre temps. K. Dick est un grand et authentique écrivain américain. (À lire du même auteur : Siva ; Les machines à illusion ; De quoi rêvent les moutons mécaniques ? …)
161. Masuji Ibuse- Pluie Noire- 1965. Au cœur du XX è siècle et ses folies, il y a le cauchemar atomique. Difficile pour le roman de notre temps de l’éviter. S’il ne faut retenir qu’un roman sur cette horreur, ce sera celui-ci. La pluie noire, c’est celle des retombées radioactive sur les survivants (ou non d’ailleurs) de l’explosion sur Hiroshima, et les années de souffrance interminable qui accable les survivants. Mais c’est peut-être aussi celle de la noirceur des hommes. Roman tantôt clinique de la destruction- la longue description de la dévastation du monde et des corps qui suit l’explosion est à la limite du soutenable- mais aussi irrigué d’une humanité délicate, celle des cœurs et des sentiments qui renaissent sous les cendres, Pluie noire est un hymne absolu et sans concession à la Paix.
162. Louis Aragon- La mise à mort- 1965. Roman miroitant de sens et de figures, à la texture et la narration très difficiles, mais d’un lyrisme et d’une musicalité de langage qui vous emmènent de page en page. La mise à mort appartient à la dernière période créatrice d’Aragon romancier, qui le conduit dans le nouveau roman avec une aisance déconcertante. Accrochez-vous, renoncez à tout saisir de cette écriture éblouissante, et vous en sortirez ravis. L’intrigue générale tourne autour du personnage d’Alfred, amoureux de Fougère, une célèbre cantatrice et jaloux d’Anthoine, qui est en quelque sorte son double : lorsque Fougère chante, Alfred devient Anthoine. Il fallait le trouver…Ce sont les deux narrateurs, qui se persécutent mutuellement : le thème central du roman, c’est la mise à mort d’Anthoine par Alfred. Les digressions imagées, le changement de nom des personnages et les multiples références intertextuelles rendent la lecture hardie. Aragon a d’ailleurs jugé nécessaire l’écriture d’une postface qui insiste sur le thème du miroir, dominant dans l’œuvre : La mise à mort apparaît alors comme une réflexion à la fois autobiographique – le passé surréaliste, l’engagement communiste et ses désillusions, l’amour fou d’Elsa…- et méta poétique sur l’œuvre de l’auteur. À cette lecture, on peut se dire que si Aragon avait été moins dispersé, moins dilettante et moins stalinien, il eut pu être le plus grand écrivain français du XXe. (A lire du même auteur : Défense de l’Infini; Les voyageurs de l’Impériale; Aurélien ; La semaine sainte; Blanche ou l’oubli; Le mentir-vrai)
163. Frank Herbert- Dune-1965.Dune, c’est une planète de sable. Ça se passe en l’an 10191, il y a des empires, des dynasties, des noblesses cupides, et donc des guerres et des assassinats et des intrigues et des complots affolés par l’obsession du pouvoir, démultipliés à l’échelle de millions d’étoiles. Des déserts infinis, peuplés de vers sous-terrain géants – mais vraiment géants, genre deux kilomètres de longs…On y parle même de Jihad, bien avant que ce mot soit reconnu dans notre champ sémantique ordinaire. Toutes ces ambitions sont mues par l’obsession de l’épice, une substance rare et onéreuse dont l’absorption permet la navigation spatiale à travers les années lumières – et donc, le commerce, et donc, la richesse. C’est un livre de grand souffle, référence de ce genre naissant qu’on a appelé la science-fiction –terme dont le sens échappe encore d’ailleurs à tout entendement- et qui influencera bien d’autres écrivains, mais d’une invention et d’une cohérence encore inégalées.
164. Kenzaburo Oé- Dites-nous comment survivre à notre folie- 1966.Oé est un des plus grands écrivains japonais du siècle passé, pas de discussion sur ce point. Inlassable pacifiste, toute son œuvre est alimentée par deux traumatismes, que ce recueil de (quatre longues) nouvelles traduit entre autres : l’horreur nucléaire d’Hiroshima en 1945, et la naissance d’un fils handicapé mental (en 1966) qu’il baptisera, joliment, Hikari (lumière). Très influencée par la littérature française, notamment Sartre et Céline, ainsi que Quignard (il sait les lire dans le texte) ses livres sont dénués de cet exotisme ou cet esthétisme qui plaisent souvent au lecteur occidental. Son œuvre est même méfiante vis-à-vis des valeurs traditionnelles du Japon, trop souvent dévoyées par le nationalisme. Oé ne craint pas ce revers des pulsions humaines, qu’il décrypte ne permanence mais qui le préoccupent dans tous ses livres : le nationalisme, le fanatisme, le conformisme, la guerre et ses mythes. Sa lecture est parfois ardue, du fait de l’incroyable densité sémantique de ses récits. Pourtant, intégralement nippon, il est aussi universel et parle au monde entier. De ce point de vue, son prix Nobel (1994) fut bien plus mérité que d’autres à la vocation restreinte. (À lire du même auteur : M/T ou les merveilles de la forêt. Le jeu du siècle. Le Faste des morts. Notes d’Hiroshima. Lettre aux années de nostalgie).
165. Mikhaïl Boulgakov – le Maître et Marguerite – 1967 :il y eut une brève période, dans les années vingt, ou la jeune URSS a connu quelques libertés dans l’élan intellectuel suivant la révolution. Imaginons le diable qui se pointe dans ce monde-là, encore enthousiaste mais déjà obsédé par la rationalité et la confiance dans le progrès humain. Œuvre foisonnante, à la fois histoire d’amour, critique politique et sociale, comédie burlesque, conte fantastique, ce roman nous parle de bien des choses, de la mort du Christ jusqu’aux aléas du communisme…En fait, avec humour, un portrait du XXe siècle, qui rejoue Faust quelques années avant Staline.
166. Vladimir Nabokov. – Ada ou l’ardeur- 1969. Le surestimé «Lolita » à masqué le chef d’œuvre de Nabokov, celui qu’il plaçait au-dessus de tout dans son œuvre. Histoire d’amour étrange et littéraire, ce roman à plusieurs degrés, réaliste et surréaliste en même temps, d’un raffinement de style inouï, vous marquera profondément, et fait partie de ces livres dont, à peine achevée la lecture, laisse le sentiment de sa nostalgie. (À lire du même auteur : Feu pâle, chef d’œuvre de conception intellectuelle inouïe, où le roman est la glose du poème en distique qu’on lit en même temps ! Balaise…Mais aussi Pnine ; Le Don ; Autres rivages).
167. Yukio Mishima. La mer de la fertilité- 1970.Mishima a terminé la dernière page de cette tétralogie, puis le même jour, il s’est suicidé. Il avait prévu ça comme ça. L’œuvre, démultipliée sur des niveaux progressifs, commence par une histoire d’amour tragique, mais se nourrit et s’amplifie puissamment du thème de la réincarnation pour traverser la plupart du XXe siècle – le roman se termine curieusement quatre ans après la mort programmée de Mishima. Le lecteur est plongé dans le flot de cette quête où des âmes se poursuivent et se cherchent, peuplée de symboles et de références au bouddhisme. C’est beau et profond. Sans doute le plus grand roman du génial Mishima, lui-même sans doute le plus grand écrivain japonais. (À lire du même auteur : le tumulte des flots ; le marin rejeté par la mer ; Le pavillon d’or ; Le soleil et l’acier.)
168. Alexandre Soljenitsyne- L’Archipel du Goulag – 1974. 227 témoignages de prisonniers ont composé ce livre. Nous sommes bien dans l’Union soviétique, et son système de travail forcé. « Ce livre ne contient ni personnages ni événements inventés. Hommes et lieux y sont désignés sous leurs vrais noms. » d’après les propres mots de l’auteur. Il faut le lire pour comprendre l’atrocité de ce système, au sein duquel on trouve les tribunaux expéditifs, l’arbitraire, la mort de masse. Le Goulag n’est pas une déviation du système, mais son fondement. Jamais un livre n’aura autant impacté l’histoire. Mais ce serait un tort de réduire Soljenitsyne à sa dimension de révolté : ce fut d’abord un des plus puissants écrivains du siècle, passionné par sa langue et sa culture, métaphysicien et conteur. (À lire du même auteur, Le pavillon des cancéreux).
169. Georges Pérec – la vie mode d’emploi – 1978 :ouvrage écrit selon la règle de la contrainte (inspirée par l’Oulipo) qui permet une inventivité infinie. Le roman n’est que celui d’un immeuble et ses appartements, et de ses objets : dans cette longue description des choses et de leur histoire, se dessine peu à peu une dimension romanesque, où l’humain n’est qu’un facteur, relégué derrière ses passions et son matérialisme. Un tour de force puissant d’invention, de construction (une boucle étonnante) et de style. (À lire du même auteur : Les choses ; la disparition…)
170. Vassili Grossman- Vie et destin- 1980.Roman épique dont le manuscrit fut détruit par la censure soviétique en 1962, puis publié à partir des brouillons recueillis en occident en 1980, Vie et Destin assume sa filiation avec Guerre et Paix. Il décline une critique radicale du stalinisme, et ose la symétrie, vécu à l’appui, entre nazisme et communisme. Il y a du souffle et beaucoup d’humanité dans sa description de la condition de la société soviétique pendant la guerre. Articulé autour de la bataille de Stalingrad, fresque des grandeurs et sauvageries humaines, ce grand livre délivre beaucoup de philosophie en maintenant malgré tout une forme de confiance en l’homme. Il aura marqué un tournant dans la critique romanesque du système totalitaire.
171. Norman Mailer – Nuit des temps. 1983.C’est toujours puissant, Mailer. Nuit des temps et probablement le meilleur roman historique qu’on trouvera dans ce florilège. Nous voici emportés avec un réalisme saisissant dans la nuit de l’Égypte ancienne. La particularité du roman est une construction en tiroir où le récit métempsychotique de chaque vie antérieure nous ouvre à la narration d’une autre vie antérieure, jusqu’au règne de Ramsès II. Les mœurs, les peurs, les désirs de ces hommes si anciens, les évènements nous semblent familiers, depuis Kadesh, ou la mystérieuse nuit du cochon, jusqu’au rituel funéraire d’embaumement, qu’on vit du point de vue du mort- il fallait assumer une telle entreprise…Monumental. (A lire du même auteur: Des nus et des morts)
172. Pascal Quignard –Les tablettes de buis d’Apronenia Avitia- 1984. Comme nous le démontre Quignard dans la plupart de son œuvre, et particulièrement les Petits traités il est toujours temps d’apprendre à vivre loin du tumulte d’un monde social qui s’aliène tout seul. Ces « tablettes de buis » sont un roman qui est écrit pour ne pas en avoir l’air. Une introduction biographique détaillée nous relate la vie et le parcours d’Avitia, patricienne romaine de la fin de l’Empire. Puis, nous lisons les notes de ces tablettes de buis retrouvées. Il s’agit d’un journal – on pense bien sûr à Sei Shonagon ; des impressions, des souvenirs de plaisir ou de tristesse, des courses à faire, des moments de rire, des rêves. Apronenia aime les parcs, les brumes sur l’Aventin, les fruits dans les cuisines, la peau des hommes aimés. Tout cela est vécu, si proche et si lointain. On y est. Tout juste note-t-elle les rumeurs et quelques lointaines fumées de la Ville éternelle qu’on pille… On lit ce roman miniature d’une traite, et, après avoir partagé le goût de la vie d’Apronenia, regrettant de n’avoir pas vécu comme elle, oubliant qu’elle n’a jamais existé, on n’a qu’une envie : reprendre la lecture à son début et profiter des bonheurs simples de l’existence. (À lire du même auteur, Les petits traités ; Carus; Les ombres errantes ; Les heures heureuses)
173. Marguerite Duras – La douleur- 1985. Ce texte court est sans doute le plus personnel -et le moins apprêté – de cet auteur. Toute la souffrance et l’attente de la survie en cinquante pages. Marguerite tente au printemps 1945 de sortir son époux de l’enfer des camps – dont la vision est encore imparfaite en cette période. Un beau récit d’amour, tenace et surhumain.
174. Emmanuel Dongala. Le feu des origines. 1987.Mandala Mankuku est un révolté. En raison des circonstances merveilleuses de sa naissance, Mandala traverse sans vieillir les décennies et les siècles du continent africain. Sa vie, qui est la matière du roman, suffit à raconter l’histoire de ses contrées (Tchad ? Congo ? Peu importe) depuis une Afrique traditionnelle, ignorée du monde mais pas idyllique pour autant, puis dans la déchirure du colonialisme. Il en épousera toutes les circonstances, sans jamais perdre le sens de ses racines. Alors, assagi et fatigué de l’histoire, il ne restera plus à Mandala qu’à transmettre aux jeunes générations, ce « feu des origines» qui fait que l’esprit reste libre et fidèle. Dongala est critique, évidemment, pas rancunier envers l’Europe coloniale ; il est nostalgique d’une Afrique ancestrale, mais sans illusion sur les faiblesses et responsabilités du continent envers son propre sort. Un très beau livre, et une contemplation fascinée par les reflets des civilisations qui se confrontent en s’ignorant. (A lire du même auteur : Johnny chien méchant ; Les petits garçons naissent aussi dans les étoiles ; La sonate à Bridgetower)
175. Salman Rushdie- Les Versets sataniques- 1988. Quelle œuvre ! roman complexe qui s’inspire de faits réels, de faits historiques et de faits imaginaires, qui établit des ponts entre Inde et Grande-Bretagne, passé et présent, imaginaire et réalité. Il faudra s’y reprendre à plusieurs fois pour saisir toutes les variations de cette narration éblouissante. Il y a plein d’histoires dans cet écheveau narratif singulier, où des divinités partagent leur destinée avec des hommes. Comme on le sait, la référence à des versets inspirés par d’autres dieux que l’Unique fut prise au pied de la lettre par certains musulmans intégristes qui prononcèrent une fatwa contre l’auteur obligé dès lors de se terrer – et qui a failli récemment succomber à la haine. Mais toujours debout, Rushdie ne renonce pas et continue d’écrire et écrire encore ; rien que pour cela, ces Versets sont à lire.(A lire du même auteur: Quichotte)
176. Claude Simon -L’Acacia -1989.L’œuvre de Simon est sous certains aspects, un condensé de la littérature du XXe siècle. Dans un style d’une incroyable densité, nourri d’une esthétique du collage, marque de l’écrivain, Simon rassemble tout de sa littérature et son existence ; il décrit dans ce livre en même temps la jeunesse de ses parents, qu´il n´a pas connue, et sa propre vie, revenant sur l’obsession de la débâcle de juin 1940 qui aura tant alimenté sa réflexion. Simon ouvre la fin de son roman sur le commencement de l’écriture, tout en annonçant sous forme implicite sa propre mort, mais en comparant sa vie avec un arbre – l’acacia – qu´il regarde de sa fenêtre ; cet arbre frémissant dans des jeux de lumière, c’est la vie, c’est l’âme, et la littérature. (À lire du même auteur : L’Herbe ; Histoire; La route des Flandres)
177. Francis Fukuyama- La fin de l’Histoire et le dernier homme- 1992. C’est probablement le livre que tout le monde descend à tour de bras aujourd’hui mais que personne n’a lu. Jugé trop souvent sur son seul titre, il vaut bien mieux que ça. Alors que notre époque se noie dans des idées noires et autoritaires, et que le consensus sur la démocratie s’effondre devant les extrémismes mentaux tous plus arriérés les uns que les autres, ce livre trouve une vigueur nouvelle. Mettre la démocratie libérale au centre des systèmes, reste la moins mauvaise théorie politique de ces cinquante dernières années. Et seul son avènement universel permet d’envisager –sous réserve des aléas de la bêtise humaine – la fin de l’histoire et une humanité de raison, en paix avec elle-même. Fukuyama ne dit rien d’autre que cela.
178. Jacques Attali – Verbatim- 1993-1995 (3 Vol.)Un verbatim est le relevé sans ajouts ni modification des propos tenus lors d’entretiens ou discussions. C’est François Mitterrand qui avait demandé à Jacques Attali de tenir ces écrits. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce livre n’a pas d’équivalent, c’est ce qui le rend intéressant. Souvent critiquées pour leur teneur – on glisse vite du verbatim intégral à la chronique- ces centaines de pages n’en restent pas moins passionnantes ; l’esprit de réflexion politique y tient une part importante, dans des évènements qui nous parlent moins peut-être à présent, mais dans une période ou tant de choses se sont nouées et dénouées : la gauche au pouvoir (une première dans l’histoire de la Ve république), le regain de la guerre froide, la fin programmée du bloc communiste à l’est, la progression de l’idée européenne, les frictions de la réforme social-démocrate contre le libéralisme etc. Certaines conversations sont entièrement reproduites, tandis que d’autres sont rapportées en mode indirect. Chaque entrée dans le livre correspond à une journée passée à l’Élysée ou en déplacement, permettant de suivre au jour le jour les dix premières années de présidence de François Mitterrand. Au total, c’est une somme de témoignages sans égal sur l’exercice de l’État à la fin du XXe siècle, et malgré tout, plutôt bien écrit. On peut prendre le pari que dans quelques centaines d’années- si l’esprit humain existe encore, ce n’est pas gagné – on relira ces chroniques du pouvoir et d’un temps ancien comme on lit Tacite aujourd’hui, comme une restitution chirurgicale de la réalité du terme « Gouverner ».
179. Collectif- Le Livre noir du communisme- 1997. Malgré un titre racoleur, et malgré les divergences et polémiques qui ont séparé ses auteurs, ainsi que quelques moments de parti pris parfois grossiers – on passera son mauvais et macabre chapitre introductif – force est de constater que ce monumental ouvrage d’histoire est le seul travail rationnel – documenté, argumenté, daté, sourcé, chiffré- qui a cherché à analyser les causes du désastre absolu que fut, finalement, le communisme au XXe siècle, et de ses innombrables massacres, et inventions répressives de toutes sortes. Les auteurs, tous issus de la mouvance et du militantisme marxistes, ont le mérite de sortir de l’éternel « oui, mais… » qui s’agite tout de suite dès qu’on évoque cet échec. Notons que le titre est une référence explicite au livre d’Ilya Ehrenbourg et Vassili Grossman, sur l’extermination nazie des juifs en URSS, et qui fut censuré par le pouvoir soviétique après la guerre. Moins efficace que l’Archipel du goulag, ce Livre noir est une somme qui a décrit à un moment important, ce qu’il fallait décrire à bras le corps, parce que tous les partis ou mouvements communistes ont été incapables de le faire quand il en était encore temps.
180. Moses Isegawa – Chroniques Abyssiniennes-1998. Peu connu en Europe – ah, c’est un roman africain qui parle de l’Afrique…- l’Ougandais Isegawa (non, non… Ce n’est pas un Japonais…) peint une saga familiale dans une Afrique face à elle-même, à la fin du XXe siècle : émerveillée de son indépendance, ravie d’un nationalisme fervent, qui devient vite aussi stupide que celui des colonisateurs. Un jeune adolescent, Muzegi, grandit et devient adulte, en même temps que son pays essaie de le faire. Finalement, ce n’est pas aussi glorieux que ce qu’on espérait, même si la vie de Muzegi s’en sort mieux. La famille du jeune homme est acariâtre, peu aimante et sans affect : miroir de cette nouvelle Afrique, au sort si mal engagé ? Amin Dada, le sida, la corruption, la répression, puis la guerre – contre la Tanzanie- mettent à mal toutes ces espérances. Il y avait tout pour réussir, et l’échec est total. Ainsi va la vanité des hommes. Mais il y a quand même quelque chose qui maintient la perspective : l’humanité, qui, elle, est inaltérable. Magnifique Ouganda pour conclure le florilège de ce siècle, et vive l’Afrique !
CHAPITRE SEPTIEME : LE XXIe SIECLE, DÉJÀ !

Bien sûr, la littérature a survécu au XXe siècle. Survivra-t-elle au XXIe, à la folie fiévreuse des réseaux sociaux, de l’intelligence artificielle, et de tout ce qu’on ne connait pas encore mais que les dérives de l’humain cerveau vont nous pondre dans les années qui arrivent ? Aura-t-on encore le goût des livres, de les lire et les écrire dans un monde à 50°C, dominé par des gouvernements régressifs et autoritaires ? En tout cas, bientôt un quart de siècle qu’il est entamé, le XXI, et il y a toujours de quoi lire, et du génie dans les lots sur tous les continents. Sans doute trop d’ailleurs, car le foisonnement de publications inutiles, au contenu autocentrés sur les drames intérieurs et la victimisation des uns par les autres, finiront peut-être par nous épuiser. On ne sait plus trop où sont les Virgile, Shakespeare et Proust de ce siècle déjà fatigué avant d’avoir vécu vingt ans, mais surnagent encore des talents, et surtout, l’envie de littérature. Ce qu’on peut noter, et c’est un motif de satisfaction pour tous les amateurs, c’est que jamais la production littéraire n’aura été aussi diversifiée. Écrire n’est plus toujours un acte d’élite, c’est un peu le prix à payer, mais du coup, c’est fou ce que les livres ont envahi nos vies. On écrit, on publie sur toutes sortes de matière, sous toutes les formes, toutes les langues, et on traverse ainsi toutes les littératures, de toutes les langues, les continents, les genres et les sujets. Renonçant à la rationalité des causes et des effets, méfiante de tout ce qui est apparent, la conscience chavire et l’intelligence fatigue. L’imaginaire y a une part bien plus importante qu’aux siècles précédents, et pourtant, les livres résistent, comme d’inextinguibles témoins des beautés de l’esprit. Boudeuse et fiévreuse, la littérature semble avoir un peu délaissé le vieux continent, pour aller inspirer les Amériques, et faire palpiter l’Afrique. Peu importe du moment qu’on écrit de belles œuvres, qu’on les traduit, puis qu’on les lit, des œuvres dont beaucoup vivront encore dans les siècles. Voici donc quelques ouvrages de notre temps, qui devraient rester un peu dans la mémoire.
181. Ian Kershaw- Hitler- 2000. Commencer notre XXIe siècle par ce nom maudit ne doit pas effrayer. Cette monumentale biographie est un livre majeur, indispensable pour essayer de comprendre. Kershaw pose d’emblée la formulation la plus exacte de l’énigme Hitler : Pourquoi Lui ? On y voit de près toutes les facettes du personnage-titre, débile mental, volubile maladif et thaumaturge surpuissant, qui asservit tout ce qu’il touche. Force est de constater qu’au terme de ce millier de pages archi-documentées et multi-référencées, il n’y a pas une réponse unique et surtout, rationnelle. Il faudra vivre avec cet abîme de la conscience. Mais il n’y a pas une seule page de ce monument qui ne soit pas passionnante. N’ayez pas peur, on termine cette lecture avec plus d’humanité qu’on y est entré.
182. Yann Martel- L’Histoire de Pi-2001. Si vous n’avez pas idée de l’expérience très vive que peut procurer la traversée des océans, sur un radeau, en compagnie d’un tigre, lisez Pi. A la suite du naufrage d’un cargo transportant, outre sa famille, les animaux d’un parc zoologique, c’est l’épreuve que traverse ce jeune garçon. On est bien sûr saisis de cette aventure, dont il est difficile de se détacher. Un conte à plusieurs niveaux de lectures, onirique, symbolique, métaphysique, psychanalytique, ou tout simplement le plaisir de lire une fable à tiroir, le tout animé d’une narration parfaite, tel est Mais d’ailleurs, Pi a-t-il vécu, ou rêvé ? Ce qu’on vient de lire, c’est la vie vraie, ou la réalité espérée d’un songe ? Allez savoir. Une forme d’éloge de la fragilité de l’homme, qui nous dit simplement que parfois, on peut essayer de lui faire confiance pour assurer son destin. A noter que beaucoup de lecteurs sont persuadés qu’il s’agit d’une histoire vraie. Magie de la littérature.
183. Dan Simmons- Ilium- 2003. Iliade transposée dans un univers de science-fiction, bon, on pourrait croire que c’est simpliste. Cet étonnant transfert procède d’une inventivité fulgurante. Un lointain (ou pas) système solaire, après qu’un virus (nommé Rubicon) a anéanti l’humanité (bon débarras…). Des êtres étranges et évidemment surnaturels ont pris la place des dieux grecs, ce qui ne changent pas grand-chose pour les mortels. Une cervelle géante et immonde qui envahit le cosmos, des néo humains falsifiés par des nanotechnologies qu’ils gardent pour eux, et des androïdes abandonnés par les précédents, mais passionnés de littérature : ceux-ci ont l’obsession de recomposer la vie sur terre dans la stricte conformité aux grandes œuvres littéraires (Homère, Proust…). Il y a aussi des érudits (pour la plupart, d’anciens universitaires humains morts mais ressuscités, (les scholiastes) qui sont envoyés dans ce théâtre fou pour garantir la conformité de ce qui se passe aux textes qui en sont la référence. L’un d’eux est le personnage central et narrateur du roman, et accessoirement, malgré sa médiocrité physique, l’amant d’Hélène de Troie. Voilà, tout ce roman ne se résume pas, mais se lit fiévreusement. Et en plus, en le lisant, on relit l’Iliade avec un regard nouveau, qui fixe rigoureusement le cadre de la narration. Jusqu’à ce que tout dérape, évidemment. Allons-y, c’est génial, affolant, et érudit en même temps. (A lire du même auteur : Olympos- la suite d’Ilium mais moins réussie-).
184. Robert Silverberg- Roma Aeterna- 2003. C’est un roman uchronique, qui va nous raconter comment l’empire romain n’a jamais disparu, ou plutôt, à quoi ressemblerait l’histoire si etc. En général, les romans uchronique se situent sur une époque particulière, un siècle, une guerre etc. Silverberg nous déroule à sa façon deux mille ans d’histoire continue de cet empire, qui avance, évolue, traverse des crises et des conflits, mais survit. Pourquoi donc, comment est-ce possible ? Le christianisme y est inconnu, ne serait-ce que parce que les Juifs n’ont jamais réussi à quitter l’Égypte des pharaons. Donc, point de Judaïsme non plus. Quelques siècles plus tard, un envoyé spécial de l’Empereur élimine un prophète d’Arabie avant qu’il ait eu le temps de commencer son prêche et de fonder l’islam. Voilà donc un espace dégagé pour que se reproduise et prospèrent les religions non-monothéistes. En outre, les successions de Caracalla et de Théodose sont très différentes de notre histoire, ce qui occasionnent une série de conséquences en chaîne, les vikings ont bien découvert l’Amérique (beaucoup plus au sud, vers le Mexique), mais reviennent faire part de leur découverte, si bien que Rome y envoie ses légions etc. La technologie évolue plus lentement que dans notre continuum. Vers l’an 2650 A.U.C. (Ab Urbe Condita : depuis la fondation de la Ville), qui correspond à la fin de notre XIXe siècle, le téléphone existe et l’automobile fait son apparition. Ce n’est pas un récit historique, ni un roman ; mais un enchaînement de nouvelles où Silverberg développe à chaque fois une période particulière de cette Histoire parallèle. Lecture assez étonnante, qui nous montre bien par quelle horlogerie discrète l’histoire est ce qu’elle, ou comment il s’en faut de peu qu’elle soit autre chose.
185.Philip Roth-Le complot contre l’Amérique- 2004. A l’heure où on peut s’interroger sur la fiabilité du lien qui attache l’Amérique à la démocratie, ce roman prend une valeur insoupçonnée. Nous sommes dans une uchronie inquiétante : les Etats-Unis sont présidés par Lindbergh, proches et alliés ou presque du nazisme. Les autorités y mènent clairement une politique antisémite et les juifs y sont menacés. Il y a bien sûr un secret qui sous-tend un tel revirement, mais là n’est pas le principal. Ph. Roth savait mener comme nulle autre ce genre de narration, qui nous éloigne et nous rapproche en même temps de nos peurs. Un complot en effet, ou comment tout simplement, l’antisémitisme survient toujours quand on le croit ailleurs.( A lire du même auteur : Némésis-Pastorale américaine)
186.Jared Diamond – Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie – 2005. Diamond entreprend avec beaucoup de pédagogie à partir d’exemples choisis sur plusieurs civilisations ou ethnies, à différentes époques, (Ile de Pâques, Pitcairn, Anasazis, Mayas, Vikings, …) d’expliquer avec rationalité leur effondrement par une pluralité de facteurs. Sa théorie isole ainsi plusieurs processus récurrents à chaque effondrement : une évolution climatique (tiens…tiens…), un bouleversement économique, dont les causes peuvent elles-mêmes être très diverses selon les cas, (rupture des flux commerciaux vitaux, perte de la production, crise agricole…) une incapacité d’adaptation à ces changements, totale ou partielle. Mais le sous-titre est très éclairant : il n’y a pas de fatalité : ce sont bien les sociétés et leurs gouvernances défaillantes, qui décident de leur fin, ou, au contraire, d’en stopper le mouvement. C’est analytique, prospectif et très inspirant. Après avoir lu les 700 pages passionnantes de cet essai, vous ne verrez plus sombrer votre civilisation de la même façon, c’est sûr.
187. Chimananda Ngozie Adichie- L’autre moitié du soleil- 2006. Au Nigéria, ce sont les femmes qui portent la littérature, et Adichie en fait plus que sa part. A travers le regard de la jeunesse, le regard d‘un enfant et ses deux sœurs aînées, c’est la dévastation de la guerre du Biafra sur une famille aimante arrachée à l’unité de son quotidien. L’autre moitié du soleil c’est celle d’un soleil d’espoir, à l’est de l’Afrique, qui a cru à la liberté d’un état nouveau. On commence avec l’euphorie de l’indépendance et la fierté joyeuse d’une grande nation ; et on s’achemine vers le cauchemar de la guerre civile et la terrifiante famine, et ses enfants « aux bras d’allumettes » dont l’image encore hante notre conscience. Et le souvenir honteux de notre silence. Un livre incontournable de la littérature africaine, si moderne, si universelle. (A lire du même auteur: Americanah).
188. Régis Jauffret- Microfictions I, II, et III- 2007-2022. Sur ces trois volumes, mille cinq cents histoires courtes (deux pages grand maximum), toujours inspirées par les défauts du genre humain : cynisme, méchancetés, envies et jalousies, mais aussi parfois, innocence et naïveté. Elles donnent toute un message ou une morale différente, et ne se ressemblent jamais. A la première personne, mais aussi d’autres personnages en silhouette opposées au narrateur. Pourtant, il y a bien une continuité dans ce fourmillement, et on pourrait y deviner le fil d’un roman en continu, dont le thème serait l’impossibilité de l’homme à être heureux. Régis Jauffret, dont on doit admirer ici la discipline d’écriture, observe le genre humain contemporain comme un entomologiste scrute l’existence minuscule des insectes. C’est original et jubilatoire, mais c’est surtout une forme nouvelle, et joliment moderne, dans la littérature romanesque.
189. Haruki Murakami – 1Q84- 2009-2010. Murakami est un écrivain universel bien plus que japonais. Avec lui nul exotisme oriental, mais de la littérature qui épouse les contours du monde entier. On ne doit pas se laisser impressionner par les trois volumes de cinq cents pages, car la lecture en est très addictive, et portée électriquement par des personnages incroyables : une tueuse à gage-masseuse qui soulage les douleurs, un prof de mathématique écrivain qui ne publie rien, un maître de secte inquiétant et élégant, une jeune fille quasi autiste et autrice d’une œuvre géniale mais incompréhensible, une vieille dame, un ethnologue, un garde du corps etc. C’est un monde dédoublé (plus que parallèle) avec deux lunes dans le ciel, qui tient lieu de cadre à cette longue et captivante histoire. Le titre est une référence évidemment au roman d’Orwell : l’action se passe en 1984 ; une des deux protagonistes, Aomamé, expérimente cette année-là une réalité déformée qu’elle nomme elle-même 1Q84 ; d’autres personnages feront le même constat plus loin dans le récit. A la différence du roman d’Orwell, la menace ne provient pas d’un Big Brother central, mais de personnages surnaturels et maléfiques, les « Little People » qui font entendre leur « voix » par l’intermédiaire de la secte des « précurseurs » et de leur Gourou, pour pénétrer dans la pensée des gens sans que ceux-ci en aient conscience. C’est déroutant et passionnant, la lecture avance toute seule, irriguée par l’invention fourmillante de l’écrivain ; c’est avant tout un roman d’immersion, outre le fait d’être une œuvre majeure de ce siècle commençant, et qui en pointe tous les dangers. Allez-y, plongez, vous ne regretterez rien de vos heures de lecture, et vous verrez comme le reste du monde vous indiffèrera…(A lire du même auteur: La mort du Commandeur; Chroniques de l’oiseau à ressort; la cité aux murs incertains)
190. Umberto Eco – Le cimetière de Prague – 2010. On sait avant la première page, que ce sera un montage savant et tout en équilibre. D’ailleurs, Eco ne se revendiquait pas comme écrivain, mais comme sémioticien. Le récit part du journal d’un faussaire, Simon Simonini, lequel se trouve perturbé par l’irruption d’une sorte de double intrusif qui va l’assister à rédiger ses mémoires. Ce Simonini déteste tout : les juifs, les femmes, les francs-maçons, les étrangers, les démocrates etc. Il est surtout doué pour le mensonge, talent qu’il va mettre au service de tous les complots et manipulations de la fin du XIXe siècle et début XXe. Car pour ce triste sire, tous les malheurs du monde s’expliquent : c’est la faute des juifs. Ainsi cheminant dans les paradoxes de sa haine, Simonini érige logiquement l’antisémitisme en complot ultime. Ce livre, il faut le dire, n’a pas vraiment une thématique très grand public, et bon nombre de lecteurs se lasseront peut-être de sa polyphonie. Mais à l’heure où le complotisme est roi, où tout le monde invente ses torrents de contre-vérités en toute liberté (vaccins, reptiliens, finances, Q-anon, État profond, on en passe…) l’érudition d’Eco vient éclairer de sa sagesse les ressorts intérieurs de la bêtise et la méchanceté de l’homme dans les systèmes de société devenus trop complexes pour la raison, et y trouve, bon an mal an, dans une formule romanesque savante, une explication littéraire.
191. François-Xavier Fauvelle – Le Rhinocéros d’or- 2013. Ce livre d’histoire est une somme de trente-quatre essais consacrés chacun à un thème, une région ou une époque données, couvrant une grande partie de l’histoire de l’Afrique sur une longue période qui correspond, peu ou prou, à notre moyen-âge occidental. C’est une révélation de ces temps secrets, dont on ne connaît rien…Ainsi donc, ce continent a une histoire ?…Bien sûr, la documentation qui a permis cette reconstitution est fragmentaire- l’auteur le reconnaît sans difficulté -mais la lecture file bien, toute en souplesse comme se déroule ces épisodes d’un continent qui reste mystérieux, et magique. Le titre est déterminé par la découverte stupéfiante, en 1932, d’une minuscule statuette de rhinocéros, en or modelé, qui a lui seul, révèle l’existence d’un royaume puissant mais disparu en Afrique du Sud, comme une métaphore de la réappropriation de son passé par le continent africain tout entier.
192. Boualem Sansal- 2084- Si vous voulez vivre ce qu’est le cauchemar d’une dictature religieuse universelle, qui ressemble comme deux gouttes d’eau à un régime islamiste qui n’aurait plus aucune limite ni libre arbitre devant sa terreur, lisez 2084. Bien sûr, le mot Islam n’est jamais écrit, mais personne ne sera dupe du modèle visé. Il n’y a plus beaucoup de trace d’humanité et d’humanisme dans cette société écrasée sous les commandements religieux, ou l’esprit ni la culture ne sont même plus l’ombre d’un souvenir, et la terreur si dense qu’on n‘y fait plus très attention. Car à force d’obéir, il n’y a plus que le vide. Heureusement, et c’est la leçon de ce livre puissant, du vide naît toujours l’espoir. On ne sort pas de cette lecture complètement indemne, mais en chérissant un peu plus notre fragile liberté.
193. Yves Bonnefoy – L’écharpe rouge -2016. Un homme vieillissant met de l’ordre dans ses archives et découvre une enveloppe vide dont l’adresse porte la mention de Toulouse. Il se souvient alors d’une ombre dans une maison, portant une écharpe rouge. Défilent ensuite d’autres images et souvenirs : comme un collage surréaliste, les images s’ajustent les unes aux autres : Yves Bonnefoy, dans cet ultime ouvrage, s’interroge sur les origines de sa vocation, et, du lecteur, en fait le témoin. À partir de textes anciens, inachevés, et retrouvés, dont la finalité et le sens lui semblent oubliés, il va recomposer un puzzle, pour en faire une œuvre unique, majeure et dernière. Tous les registres de la création poétique sont invoqués : précipité de l’inconscient, énigme fondatrice, mémoire et codes secrets de son monde intérieur. Ce texte magique offre une réflexion sur le silence et la poésie, comme un point d’orgue à l’œuvre d’un des plus grands poètes français du siècle passé.
194. François Mitterrand – Lettres à Anne- 2016. Oubliez l’homme de pouvoir, le chef d’État, le manœuvrier politique et tous les clichés semés depuis des décennies sur le personnage. Découvrez un homme amoureux, un écrivain doué, qui écrit ces lettres en puisant uniquement dans l’intimité de ses sentiments ; aucun souci de paraître, ou tout simplement d’être publié, de « faire » littérature. Mille-deux-cent-dix-huit lettres, rédigées dans le secret d’une intimité indicible, pour clamer l’amour et le bonheur d’être amoureux, sur trente-trois ans d’existence. La face cachée de la lune, en quelque sorte, mais étonnamment rayonnante. Lisant ces lettres, on pense avec compassion à toutes les femmes qui n’auront jamais eu la chance de recevoir une seule lettre d’amour comme une seule de celles-ci.
195. Richard Powers- L’arbre monde- 2018. Après des années de vie en ermite dans la forêt à étudier les arbres, une jeune botaniste fait la découverte du siècle : les arbres ne sont pas ce que l’on croit, car ils communiquent entre eux. Toute l’évolution s’en trouve bouleversée et la relation élémentaire de l’homme à la nature. La trajectoire de plusieurs personnages – psychologue, photographe, étudiant…- alimentent ce roman symphonique autour de ce thème, pour converger vers les séquoias millénaires de Californie où se joue le sort de l’humanité. Powers situe cette éco fiction à des niveaux métaphysiques étonnamment accessibles, en passant au crible tous les aspects de l’aveuglement humain face à la ruine programmée de la nature.
196. Sylvain Tesson- La panthère des neiges- 2019. Il n’y a pas d’histoire dans ce récit, rien que l’esprit de contemplation. L’espace, et l’altitude, et la blancheur des cimes. Et aussi, une attente irremplaçable, celle d’une vision qui ne se découvre qu’à ceux qui la méritent. Le léopard des neiges est une des plus belles créatures vivantes, mais si peu visible à ceux qui la cherchent…Le félin mystérieux, caractérisant l’éloignement du monde comme une discipline, est ici un idéal, devant lequel l’être humain redevient, pour une fois, modeste. Tesson a parfaitement saisi cette évanescence, et met son écriture lyrique au seul service de ce merveilleux fantôme, avec justesse et dépouillement. Un songe dans la neige et la brume, les mots qui vont avec.
197. Mohammed Mbouga Sarr- La plus secrète mémoire des hommes- 2021. Avec une énergie de narration tourbillonnante, de récits enchâssés en mise en abîmes décalées, ce livre incroyable nous remue tout au long de sa lecture. Il n’est question que de littérature, à partir d’un roman devenu mythique, puis disparu (« le labyrinthe de l’inhumain ») dont la quête est le ressort du roman. Celui-ci se déploie à travers un siècle d’histoire du XXème siècle et ses malédictions (les boucheries de la Première guerre mondiale, la Shoah, la colonisation et son sillage, le racisme, n’en jetez plus), confrontant vérités et illusions. Mais ce roman touffu, difficile parfois, à la chronologie sinueuse, est avant tout un conte kaléidoscopique sur la littérature, la liberté d’invention de l’écrivain, la toute-puissance de la critique, et le piège de la gloire. Prix Goncourt 2021, mérité, et, pour une fois, attribué à un livre durable dont on parlera encore dans cinquante ans.
198. Shuzo Numa- Yapou, bétail humain- 2022.Alors ça, ça ne ressemble à rien – je sais, on l’a déjà dit ici plusieurs fois, mais là, vraiment…On ne sait même pas qui a écrit sur plus de trente ans ce curieux roman, qui ne se déroule qu’en trois jours. Parabole de la déshumanisation de la société moderne, qui a particulièrement frappé le peuple japonais : des individus, dans un monde futur luxueux auprès duquel celui d’Huxley semble une comptine pour enfant, sont transformés en objet du quotidien, tout en gardant une part de conscience de leur sort. Ils servent ainsi de bidets, de stylo, de fauteuil, d’aspirateurs, au service d’une élite oisive, exclusivement de race blanche, dominée par les femmes. Dans cette souffrance rentrée, mais finalement, pleinement acceptée, et ce déferlement de masochisme, on pense à Sade. C’est une façon littéraire unique d’illustrer talentueusement l’incroyable capacité de soumission du peuple Japonais, dans son histoire jusqu’à la dictature militariste qui a mené cette civilisation si délicate, au désastre. Après tout, notre temps est celui où pour la première fois, on a décidé qui était humain, et qui ne l’était pas ou plus. Au-delà, c’est un avertissement face à l’appétit sans limite de notre matérialisme. De ce monument douloureux, publié dans son intégrale seulement en 2023, on n’est pas sûr encore de l’identité de(s) auteur(s).






 Le square des Batignolles est un moment gravé. Ses pelouses incolores serpentent entre ses cours d’eau. Les buissons aux feuillages fatigués plantent leur volumes diffus avec les faux rochers stratifiés aux tons de cendre. Dans les bacs de sables blancs, on entend jouer les enfants, et leur rire effacé. Mais au centre du plan d’eau, émergeant de l’eau couleur de bronze, se dresse la masse sculpturale des vautours. Souvent, le bonheur du lieu, de l’odeur d’air frais et d’herbe mouillée, sous la lumière pâle qui ocelle à travers les feuillages, stoppait net en moi à la vue de ces quatre volatiles de pierre noire, de si haute stature. Je les voyais comme une partie hostile de mon monde à moi, et de ces élans secrets qui me saisissaient, rêves d’échappées dans les passages que tracent entre eux les arbres qui me semblaient, à l’image du platane pluri centenaire, des géants. Une voix lointaine sonne alors, « Allez, on y va »…Je me suis bien amusé sur le manège. C’est la silhouette droite de mon grand-père. Le petit garçon met sa main dans la sienne, et marchant sur les feuilles mortes, on s’en va.
Le square des Batignolles est un moment gravé. Ses pelouses incolores serpentent entre ses cours d’eau. Les buissons aux feuillages fatigués plantent leur volumes diffus avec les faux rochers stratifiés aux tons de cendre. Dans les bacs de sables blancs, on entend jouer les enfants, et leur rire effacé. Mais au centre du plan d’eau, émergeant de l’eau couleur de bronze, se dresse la masse sculpturale des vautours. Souvent, le bonheur du lieu, de l’odeur d’air frais et d’herbe mouillée, sous la lumière pâle qui ocelle à travers les feuillages, stoppait net en moi à la vue de ces quatre volatiles de pierre noire, de si haute stature. Je les voyais comme une partie hostile de mon monde à moi, et de ces élans secrets qui me saisissaient, rêves d’échappées dans les passages que tracent entre eux les arbres qui me semblaient, à l’image du platane pluri centenaire, des géants. Une voix lointaine sonne alors, « Allez, on y va »…Je me suis bien amusé sur le manège. C’est la silhouette droite de mon grand-père. Le petit garçon met sa main dans la sienne, et marchant sur les feuilles mortes, on s’en va.












































































 Ne parlez pas aux jeunes des difficultés de leur âge. La plupart est peu disposée à en entendre les couplets, qu’elle aura déjà cent fois écoutée : que leur fait votre compassion, quand vous avez de loin passé l’époque des recherches d’emploi, des angoisses aux lendemain d’examen, des solitudes douloureuses et de l’abysse du chômage ? Leur nature les porte autant à la fierté que celle de leurs aînés… Vous voulez ouvrir une porte, et faire entrevoir un cheminement meilleur que celui tracé par ces années malaisantes ? Évoquez donc le poids des âges et la vieillesse qui monte, son cortège sombre de faiblesses et de maladies, représentez-leur ce qu’il en est de voir partir ses amis et tous ces instants heureux avec eux réduits à de simples souvenirs, tracez donc, avec la précision de l’expérience, la finitude du temps qui vient ; mais surtout, en toute circonstance, n’oubliez pas de dire ce qu’est la sensation d’avoir beaucoup vécu, son inégalable goût de cerise, et l’écho harmonique de la mémoire illuminée… Alors, vous aurez su parler aux jeunes, les éclairer utilement sur la vérité de l’existence, et quand bien même un sur cent vous aura écouté, croyez que celui-là, pour les temps qui s’ouvrent à lui, sera bien devenu sage.
Ne parlez pas aux jeunes des difficultés de leur âge. La plupart est peu disposée à en entendre les couplets, qu’elle aura déjà cent fois écoutée : que leur fait votre compassion, quand vous avez de loin passé l’époque des recherches d’emploi, des angoisses aux lendemain d’examen, des solitudes douloureuses et de l’abysse du chômage ? Leur nature les porte autant à la fierté que celle de leurs aînés… Vous voulez ouvrir une porte, et faire entrevoir un cheminement meilleur que celui tracé par ces années malaisantes ? Évoquez donc le poids des âges et la vieillesse qui monte, son cortège sombre de faiblesses et de maladies, représentez-leur ce qu’il en est de voir partir ses amis et tous ces instants heureux avec eux réduits à de simples souvenirs, tracez donc, avec la précision de l’expérience, la finitude du temps qui vient ; mais surtout, en toute circonstance, n’oubliez pas de dire ce qu’est la sensation d’avoir beaucoup vécu, son inégalable goût de cerise, et l’écho harmonique de la mémoire illuminée… Alors, vous aurez su parler aux jeunes, les éclairer utilement sur la vérité de l’existence, et quand bien même un sur cent vous aura écouté, croyez que celui-là, pour les temps qui s’ouvrent à lui, sera bien devenu sage.



 Dans cet empire de brouillard où tant de vérités nous sont enfouies, nos esprits ont besoin en tout instant de comprendre, savoir, et découvrir, et c’est ainsi que Thrason est indispensable à notre gouverne affaiblie. Car Thrason est réputé très savant, doué de toutes sortes de sciences; on le sollicite sans se lasser.
Dans cet empire de brouillard où tant de vérités nous sont enfouies, nos esprits ont besoin en tout instant de comprendre, savoir, et découvrir, et c’est ainsi que Thrason est indispensable à notre gouverne affaiblie. Car Thrason est réputé très savant, doué de toutes sortes de sciences; on le sollicite sans se lasser.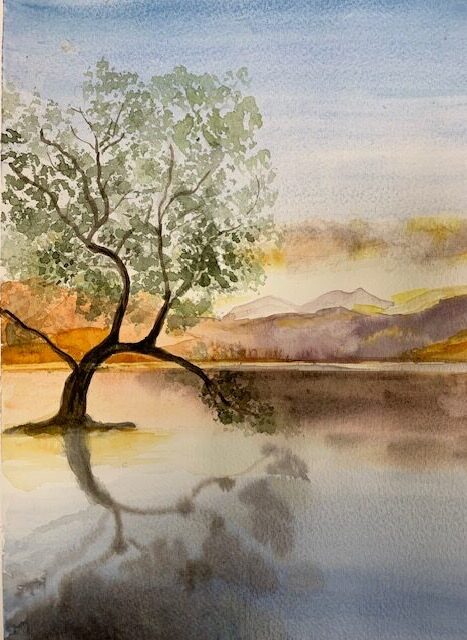







 Allons Théramène, respirez un peu, sortez donc un moment de votre bureau, de vos charges et vos réunions ; voyez comme le temps est généreux aujourd’hui, ouvrez la fenêtre, et non, plutôt la porte, et passez-y pour sortir dans la rue. Délaissez un instant seulement, vos tracas et votre carrière. Sentez-vous un peu d’air ? Quittez donc le lieu de votre travail, reculez encore ; ôtez donc cette cravate et votre veste de costume. N’êtes -vous pas mieux ainsi, ne sentez-vous quelque chose changer déjà ? Non, pas encore… Allez jusqu’au bout de la rue, mieux encore, changez de quartier, et laissez là votre carte de crédit, vos clefs de voiture, et tous ces apprêts qui font votre position. Sortez de la Ville, prenez un train, oubliez toutes vos affaires, continuez jusqu’à la campagne… Ne distinguez-vous rien autour de vous ? Reculez encore, vous dis-je…D’une manière radicale, négligez vos projets, votre immobilier, votre hiérarchie : celle-ci vous oubliera vite, croyez-moi. Déchargez-vous de tous ces poids qui ont imprimé leur ligne sur votre peau, dans votre vie. Ne restez pas là, traversez la mer, puis l’océan, gagnez d’autres territoires, lointains, nouveaux, insoupçonnés. Vous voici aux antipodes…Que voyez-vous alors, que sentez-vous à présent ? Toujours rien ? Cheminez encore, envolez-vous, et à travers les nuées, regardez le sol, les collines et les champs, et les villes et les bâtiments, comme tout cela est petit. Mais ce n’est pas assez ; allons, Théramène, ne cessez pas cet élan, vous atteignez à présent les étoiles et les immensités de l’espace. Contemplez ainsi ce minuscule fourmillement qu’est devenue votre société. Alors, que dites-vous, là ? C’est bien cela : dans cette nudité nouvelle qui vous saisit et vous délivre, vous retrouvez enfin – au vu lointain de ce qu’il en reste – la sensation de votre humanité.
Allons Théramène, respirez un peu, sortez donc un moment de votre bureau, de vos charges et vos réunions ; voyez comme le temps est généreux aujourd’hui, ouvrez la fenêtre, et non, plutôt la porte, et passez-y pour sortir dans la rue. Délaissez un instant seulement, vos tracas et votre carrière. Sentez-vous un peu d’air ? Quittez donc le lieu de votre travail, reculez encore ; ôtez donc cette cravate et votre veste de costume. N’êtes -vous pas mieux ainsi, ne sentez-vous quelque chose changer déjà ? Non, pas encore… Allez jusqu’au bout de la rue, mieux encore, changez de quartier, et laissez là votre carte de crédit, vos clefs de voiture, et tous ces apprêts qui font votre position. Sortez de la Ville, prenez un train, oubliez toutes vos affaires, continuez jusqu’à la campagne… Ne distinguez-vous rien autour de vous ? Reculez encore, vous dis-je…D’une manière radicale, négligez vos projets, votre immobilier, votre hiérarchie : celle-ci vous oubliera vite, croyez-moi. Déchargez-vous de tous ces poids qui ont imprimé leur ligne sur votre peau, dans votre vie. Ne restez pas là, traversez la mer, puis l’océan, gagnez d’autres territoires, lointains, nouveaux, insoupçonnés. Vous voici aux antipodes…Que voyez-vous alors, que sentez-vous à présent ? Toujours rien ? Cheminez encore, envolez-vous, et à travers les nuées, regardez le sol, les collines et les champs, et les villes et les bâtiments, comme tout cela est petit. Mais ce n’est pas assez ; allons, Théramène, ne cessez pas cet élan, vous atteignez à présent les étoiles et les immensités de l’espace. Contemplez ainsi ce minuscule fourmillement qu’est devenue votre société. Alors, que dites-vous, là ? C’est bien cela : dans cette nudité nouvelle qui vous saisit et vous délivre, vous retrouvez enfin – au vu lointain de ce qu’il en reste – la sensation de votre humanité.